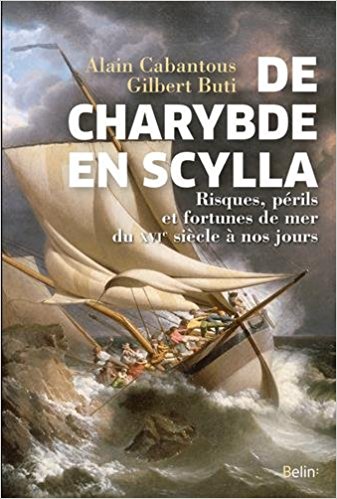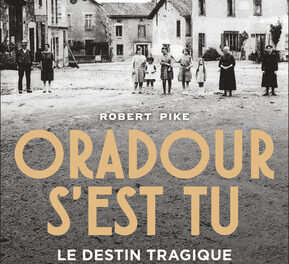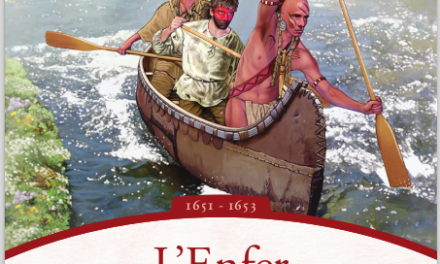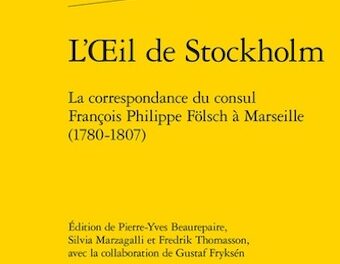Le monde des gens de mer est de ceux que l’on croit bien connaitre, alors que la réalité nous est masquée par un écran de mythes et de légendes tenaces que le présent ouvrage s’efforce de dissiper. Cette synthèse a pour thème les « risques, périls et fortunes de mer » qui font des métiers de la mer un ensemble d’activités caractérisées par leur extrême dangerosité, la violence des éléments pouvant à tout moment conduire au pire, même aujourd’hui comme le soulignent les auteurs qui ont choisi de brosser un tableau portant sur la longue durée, du XVIe siècle à nos jours, soit des grandes expéditions maritimes de la première mondialisation aux courses au large en solitaire actuelles, afin d’analyser les relations multiples et farouches entre les populations maritimes et un espace à la fois hostile et qui leur est nécessaire.
Les auteurs sont deux historiens spécialistes de l’histoire des gens de mer, dans leurs dimensions démographiques, économiques, sociales, religieuses et culturelles. Alain Cabantous, historien moderniste français né en 1946, agrégé d’Histoire, chargé de recherche puis directeur au CNRS de 1983 à 1995, est l’auteur d’un thèse pionnière soutenue en 1987 à l’Université Lille III sous la direction de Pierre Deyon. Portant sur « Les populations maritimes françaises de la Mer du Nord et de la Manche orientale : étude sociale comparative, vers 1660 – 1793 » cette étude globale du monde des gens de mer fut publiée en 1991 sous le titre 10.000 Marins face à l’Océan, Les populations maritimes de Dunkerque au Havre, 1660-1794. Professeur à Paris X Nanterre en 1995 puis à Paris I Panthéon Sorbonne de 1998 à 2009, il est l’auteur de nombreux ouvrages d’histoire maritime ou d’histoire du Christianisme. S’appuyant sur une connaissance approfondie des sources d’histoire maritime, il a innové dans l’étude globale des sociétés maritimes et de leurs pratiques culturelles ou religieuses, à travers des ouvrages tels que La Vergue et les Fers, Mutins et Déserteurs dans la Marine de l’Ancienne France, XVIIe – XVIIIe siècles, Tallandier, 1984, Le Ciel dans la Mer, Christianisme et Civilisation maritime, XVIe – XIXe siècle, Fayard, 1990, Les Citoyens du Large, Les Identités maritimes en France, XVIIe – XIXe siècles, Aubier, 1995.
Gilbert Buti est un historien moderniste français spécialiste des économies maritimes et des société littorales en Méditerranée, agrégé, il est l’auteur d’une thèse soutenue en 2000 à l’EHESS Paris, sous la direction d’André Zysberg, et portant sur « Activités maritimes et Gens de mer à Saint-Tropez (milieu XVIIIe siècle – début XIXe siècle). Contribution à l’étude des économies maritimes ». Professeur émérite de l’Université d’Aix-Marseille, membre du laboratoire TELEMME de cette même Université, il est l’auteur de nombreux ouvrages d’histoire maritime. Gilbert Buti et Alain Cabantous avaient précédemment publié Être marin en Europe occidentale (1550-1850), Rennes, Presses de l’Université de Rennes, 2016.
L’étude propose d’analyser les « risques, périls et fortunes de mer » en trois étapes successives : les auteurs s’efforcent tout d’abord de délimiter la notion de « risque », terme apparu dans les documents génois au XIIIe siècle, puis de décrire les relations ente les populations maritimes et les dangers de la mer, avant d’aborder les moyens employés pour se prémunir de ces derniers.
L’ouvrage débute donc par la notion de « risque » à travers le regard porté par les populations maritimes. Pour les peuples du Moyen-Orient antique, la mer était un milieu hostile aux limites imprécises, comme le souligne encore Al-Idrisi au XIIe siècle. La mer est parsemée d’îles perçues comme des lieux ambivalents, à la fois paradisiaques et dangereux, telles les îles Fortunées que les explorateurs européens cherchèrent en vain. La mer est le domaine des morts selon les croyances ancrées dans la culture celtique depuis le VIe siècle, d’où la légende du vaisseau fantôme associée à l’idée de vengeance divine. La mer est peuplée d’animaux monstrueux gigantesques, serpent de mer ou poulpe géant, hideux et cruels, que des auteurs, tel Ambroise Paré, tentent de décrire à partir des années 1530. Les textes précisent les moyens employés pour lutter contre les monstres marins, perpétuant des terreurs alimentées aussi par les représentations cartographiques ou architecturales des bâtiments de mer, mais aussi les déclarations de marins qui évoquent notamment la présence de l’homme-poisson. La pérennité de telles représentations est assurée par des notables qui authentifient les témoignages, par des scientifiques aussi, et surtout par la tradition orale, relayée par les journaux et les romans au XIXe siècle, ceux de Melville, Hugo ou Jules Verne. Les terreurs actuelles ont d’autres objets, vagues scélérates ou stérilité de la mer.
Le second chapitre s’attache à dissiper la croyance en une « vocation » des gens de mer. De nombreux marins ont choisi de s’engager pour fuir la misère, et ils l’ont souvent regretté, comme le soulignent de nombreux témoignages. De ce fait, la plupart des marins vivent dans la pauvreté et la précarité, nombre d’entre eux retournant à la terre dès que possible. Cette condition sociale fragile et marginale conduit à suivre l’exemple du père lorsque celui-ci a choisi de rester marin, mais elle explique aussi le faible nombre des gens de mer et la difficulté à recruter des équipages. A la veille de la Révolution, près du quart des marins bretons et 60% des mousses marseillais ne sont pas issus de familles de gens de mer. Pour trouver des équipages, l’Angleterre a mis en place en 1337 la « presse », système d’enrôlement forcé brutal organisé par l’amirauté avec le concours d’hommes de main munis de gourdins, assurant au XVIIIe siècle entre la moitié et les deux tiers des engagements, et resté en application jusqu’au milieu du XIXe siècle, non sans résistances. En France, l’administration de Colbert établit le système des classes en 1670, consistant en un enregistrement des gens de mer et à l’obligation de servir sur les vaisseaux du roi un an sur trois ou sur quatre (Bretagne, Normandie, Guyenne et Picardie), mesure étendue en 1692 aux gens de rivière et remplacée en 1795 par l’Inscription maritime supprimée en 1967. Le recrutement de marins adultes (18 à 55 ans dans la Royale) était complété par le recours aux mousses dès 8 à 12 ans et aux novices, à des marins étrangers, à des invalides ou des marginaux trouvés dans les tavernes. Equipages composites et hétérogènes donc, communiquant avec difficultés, principalement sur les navires corsaires. Il fallait donc du courage pour tenter l’aventure maritime vers l’Orient convoité, surmonter le « mal des vaisseaux », motiver l’équipage, rencontrer des populations inconnues. Aujourd’hui, de nombreux marins prennent des risques dans un souci de dépassement individuel et de goût pour la compétition.
La seconde partie de l’ouvrage commence par l’étude du navire comme plus ancien laboratoire de rationalisation du travail. Pour le marin, le navire est un espace dangereux et inconfortable, marqué par la promiscuité de ses occupants, l’insalubrité et l’humidité, la présence d’une véritable ménagerie destinée à compléter l’alimentation, le tout favorisation les maladies infectieuses. Les principales pathologies étaient dues au manque d’hygiène et à la mauvaise qualité des réserves d’eau douce : la typhoïde, le typhus, le scorbut (remplacé en Méditerranée par la peste endémique). Le saturnisme, lié à l’usage du plomb, se développe au XIXe siècle. Les navires font rarement escale pour déposer des personnes accidentées, ce qui peut conduire à des amputations. L’alcoolisme est responsable de nombreux accidents. La propulsion à vapeur fait apparaître de nouveaux risques liés à la mécanisation du travail. Le corps des marins porte les marques de ces conditions de vie et de travail, ainsi que des tatouages en forme de messages. Mais il porte aussi les stigmates des mauvais traitements et des violences subies, des souffrances psychiques liées à la séparation de ses proches. La mutinerie maritime, souvent née d’un sentiment d’injustice, participe de ces formes de violence, en soulignant l’importance de l’obéissance aux ordres dans un système fortement hiérarchisé. Après 1790 ces révoltes de marins prennent de l’ampleur en touchant des escadres entières et révèlent un climat révolutionnaire de contestation de l’ordre établi.
Le naufrage, il y en aurait eu 13.000 dans le monde entre 1824 et 1962, fait l’objet de représentations dont l’éloignement avec la réalité est culturellement significatif. La peinture (surtout entre 1750 et 1850) le représente comme un événement intemporel codifié : ciels sombres, vagues déferlantes, corps noyés et bâtiments à la dérive. En réalité les naufrages ont lieu majoritairement en hiver et près du littoral, le plus souvent à la suite d’erreurs humaines. Le naufrage est une rupture et une épreuve révélant solidarités ou égoïsme. Les textes littéraires et la presse tendent à instrumentaliser les naufrages en les transformant en événements glorieux (le naufrage du Vengeur du Peuple le 13 prairial an II) ou révoltant (celui de la Méduse en 1816). Les naufrages du Vasa et celui du Titanic furent perçus comme l’expression d’un orgueil excessif de leurs concepteurs. Les naufrages suscitent une abondante littérature après 1820 (témoignages publiés, romans, récits, feuilletons).
Naviguer signifie accepter une prise de risque pouvant conduire à la mort du marin, entre 5 et 20% de décès en cas de guerre au XVIIIe siècle, la mort épidémique faisant plus de victimes que le combat, avec des variations importantes d’un théâtre d’opérations à l’autre. La mort frappe surtout les jeunes et les moins gradés. Mais le nombre de décès en mer diminue fortement après 1860 en raison des changements techniques intervenus, la grande pêche devenant alors l’activité la plus dangereuse jusqu’à nos jours. Le marin risque également la captivité dans des conditions très difficiles, comme le montre l’exemple des pontons anglais ou français du XVIIIe siècle. Il risque aussi de tomber aux mains de pirates ou de corsaires pour être échangé, racheté ou vendu comme esclave. Déclinant au XIXe siècle, la piraterie subsiste aujourd’hui en Afrique et en Asie du Sud-Est. La prise de risque est aussi d’ordre économique pour armateurs et négociants, qui négocient parfois des « prêts à la grosse aventure », les premiers pouvant en cas de conflit s’engager dans la guerre de course.
La mer est aussi une menace pour les populations littorales exposées aux tsunamis, comme à Lisbonne en 1755 ou à Sendai en 2011, aux tempêtes et raz de marée, Xynthia en 2010, à l’érosion des rivages ou aux risques d’ensablement. Mais ces populations pouvaient craindre aussi les razzias exercées par les Barbaresques en Méditerranée du XVIe au XVIIIe siècle, ou les opérations militaires sous forme de débarquement. Les marins pouvaient également transmettre les maladies épidémiques aux populations littorales à partir des ports de commerce : la peste puis le choléra ont emprunté les routes maritimes. Aujourd’hui, la littoralisation des activités conduit à une importante dégradation des rivages sous l’effet des marées noires, des rejets agricoles ou industriels, voire domestiques. La présence de centrales nucléaires sur les littoraux, le réchauffement climatique conduisant à une élévation du niveau moyen des mers, sont des sujets d’inquiétude légitime. Les populations littorales sont démunies face aux flux de migrants clandestins qui transitent par mer dans des conditions inhumaines. Enfin les auteurs soulignent le fait que le mythe des « naufrageurs des mers » forgé entre 1650 et 1830 est largement infondé, mais révélateur du mépris exercé par les élites envers ces populations littorales marginalisées dont on souligne l’étrangeté dans la littérature, alors que de nombreux témoignages évoquent des actes de solidarité envers les marins naufragés…
La troisième partie de l’ouvrage aborde les moyens employés pour réduire les risques de mer. Tout d’abord le recours au Ciel à travers les ex-voto marins depuis l’Antiquité. Le monde chrétien a ensuite procédé à une sanctification des paysages littoraux par l’établissement de sanctuaires juchés sur des hauteurs dans le cadre du culte marial, accompagnée d’actes de bénédiction de la mer et du « baptême » des navires. Les gens de mer procèdent à des démarches propitiatoires avant d’embarquer (messes, confession) et emportent des objets protecteurs (images, médailles), certaines pratiques étant condamnées par l’Eglise catholique. Les permanences l’emportent à travers les siècles, comme la peur de mourir en mer, sans sépulture. Cependant les témoignages montrent qu’en cas de tempête, les manœuvre pour sauver le navire passent avant les pratiques religieuses, surtout après 1750. Alors que les Catholiques voient dans la fureur des éléments l’œuvre du Diable, les Protestants y voient la manifestation de la puissance divine et ils ont recours à des livres de prières pour demander sa protection. Les prières récitées s’accompagnent parfois d’un vœu chez les Catholiques, dont l’accomplissement est souvent conforme à la promesse faite. Ceux qui reviennent sains et saufs ont aussi pour charge de veiller à la mémoire des morts en faisant célébrer des offices en faveur des âmes du Purgatoire. C’est aussi la mission des confréries de gens de mer. Les populations littorales ont utilisé divers moyens pour matérialiser la présence des disparus en mer, tels des murs ou des cénotaphes. La déprise religieuse actuelle a réduit ces pratiques.
Face à l’ampleur des risques encourus, les gens de mer ont bénéficié en France d’un système de protection sociale novateur dans le cadre du système des classe mis en place en 1670 : une rente viagère est versée aux invalides ayant servi sur les navires du roi, complétée par une assistance médicale gratuite à partir de 1673, le financement étant assuré par la Caisse des invalides. Les veuves puis les marins de commerce et de pêche en 1709 ont pu bénéficier de pensions. Le système de la demi-solde fut conservé avec la création de l’Inscription maritime en 1795. Des secours ponctuels pouvaient également être apportés aux plus démunis par la monarchie, ou par des dons de particuliers. De même, un fonds de contributions est établi en Angleterre en 1696 pour secourir les marins sans ressources, mais il est dissout en 1851 et remplacé par une Caisse d’épargne des gens de mer en 1856, dans une logique libérale. Dans les deux pays un système de retraites est finalement mis en place au début du XXe siècle. Pour limiter les risques financiers des expéditions maritimes, armateurs et négociants divisent les armements en parts de navires, ont recours à l’assurance suivant diverses formules. Les confréries de métiers, prud’homies en Méditerranée, avaient pour mission de mutualiser les risques encourus par les marins, préfigurant les sociétés de secours mutuels du XIXe siècle. Des institutions méditerranéennes étaient mises en place pour le rachat des captifs tombés aux mains des Barbaresques. Enfin, le souci d’entraide conduit à mettre en place des systèmes de sauvetage en mer, en Angleterre d’abord dès 1789, puis en France avec la création de la SCSN en 1865. Des navires-hôpitaux permettent de secourir les marins sur les lieux de leur travail depuis la fin du XIXe siècle.
L’objectif prioritaire est aujourd’hui de sécuriser la navigation. Pour cela des travaux hydrauliques sont réalisés sur les littoraux afin de les aménager (plan Delta aux Pays-Bas), digues, jetées artificielles, etc. Pour assurer la sécurité des populations littorales, des tours de guet ont été édifiées à partir du XVe siècle, des milices garde-côtes ont été levées avant la Révolution française. Pour lutter contre les maladies, des lazarets ont été construits ou aménagés sur le modèle de celui de Raguse en 1377. L’outillage nautique est profondément remanié au temps de la marine à vapeur. Les progrès de la circulation sont assurés par l’amélioration des cartes marines et des instruments nautiques, en particulier le chronomètre de Harrison en 1759. Le repérage en mer a été facilité par la multiplication des phares, dont la portée a été considérablement améliorée grâce à Fresnel en 1819, puis l’invention du radar, en attendant la géolocalisation. La sécurité en mer a également été améliorée par la navigation en convois. La législation contribue à renforcer la sécurité en mer, juridictions nationales et droit international étant de plus en plus associés et complémentaires. L’OMI, Organisation maritime internationale, est fondée en 1948 dans le but d’améliorer la gestion des risques. La CNUDEM entrée en vigueur en 1994 jette les bases d’une gouvernance mondiale des espaces maritimes.
Ainsi, cette synthèse portant sur la longue durée a le mérite d’insister sur l’importance des risques encourus par des gens de mer dont la plupart n’ont pas choisi d’affronter les éléments. Naviguer, c’est accepter cette prise de risque au péril de la vie, tout en s’organisant pour en réduire les conséquences. Aussi, l’étude montre que la particularité des métiers liés à la mer conduit à des solidarités et des formes d’organisation spécifiques à la fois innovantes et exemplaires, tout en soulignant les efforts réalisés pour réduire les risques encourus qui ne peuvent aujourd’hui être pensés qu’à l’échelle mondiale.