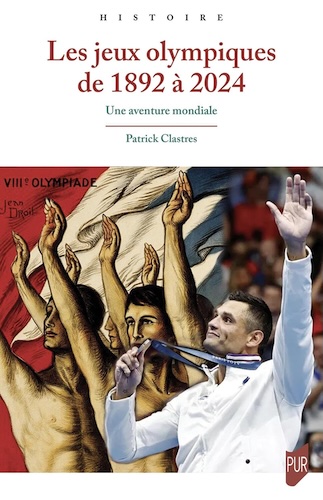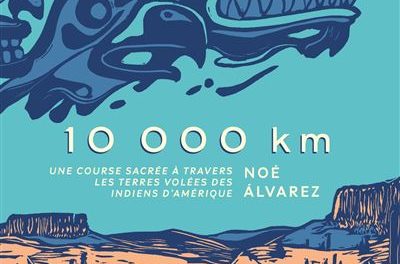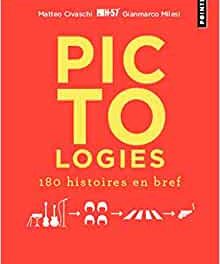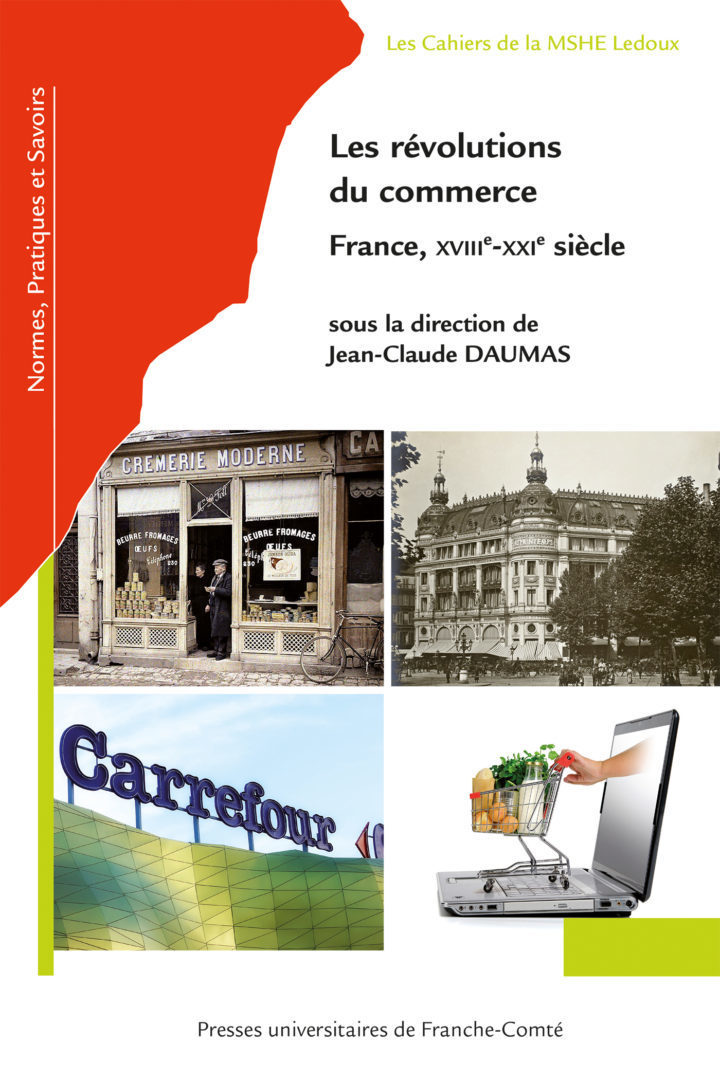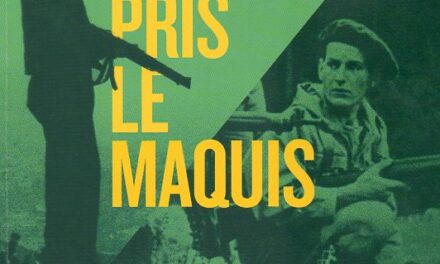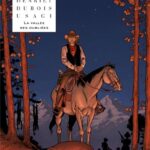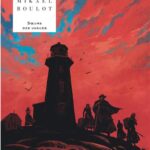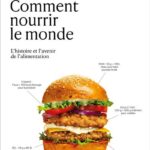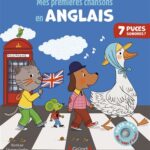La tonique euphorie des JO de Paris 2024 a gravé dans la mémoire collective les émotions indissociables d’une compétition planétaire riche en prouesses sportives, baignant dans une ambiance festive amplifiée et scénarisée par la communion médiatique universelle. Ces olympiades sont le plus récent fleuron d’une fresque dont la dimension légendaire s’est construite au fil de trente éditions en l’espace de 130 ans. Les Jeux Olympiques modernes sont désormais un événement mondial aussi consensuel qu’incontournable. Cet aboutissement est pourtant le fruit d’une généalogie tourmentée, dont l’historien du sport Patrick Clastres dévoile les péripéties insoupçonnables dans cette étude magistrale appelée à faire référence.
Car les JO ont mis longtemps à s’imposer comme un événement global. Ces deux semaines qui concentrent tous les quatre ans l’attention et l’euphorie du monde ont démarré petitement. Le paroxysme éphémère des performances sportives individuelles et collectives, somme de compétition et d’héroïsme, a connu de multiples fluctuations avant d’atteindre la maturité. Dans ce processus, l’idéal réconciliateur de la neutralité du sport est le fictif alibi des rivalités géopolitiques. Patrick Clastres brasse avec aisance et limpidité le nœud touffu des joutes sportives, des affirmation nationales, des confrontations idéologiques et des intérêts économiques. Il met en valeur les figures sportives et institutionnelles marquantes. Il met aussi le doigt sur les jeux de pouvoir dans les coulisses des instances olympiques et les ambitions individuelles qui s’y déploient. Il montre enfin à quel point, selon son heureuse expression, la fausse parenthèse enchantée des JO constitue un « simulacre sportif des relations internationales ».
La succession des trente olympiades est minutieusement déroulée au fil de six périodes chrono-thématiques
L’auteur singularise ainsi le moment des expérimentations de 1896 à 1912, le temps des instrumentalisations de 1920 à 1936, l’âge des mondialisations de 1948 à 1964, l’ère des médiatisations de 1968 à 1984, la période des professionnalisations de 1988 à 2008 et enfin la phase contemporaine des hybridations de 2012 à 2024. L’ampleur cumulée des enjeux édulcore l’innocence de la performance sportive, l’exaltation des records et le culte des champions. Mais cela leur confère aussi une profondeur historique tout aussi passionnante à l’échelle de chaque olympiade que sur la longue durée.
Dans cette perspective, la symbolique du choix des villes olympiques est plus que l’expression d’arbitrages diplomatiques et financiers. Elle exprime l’ordre du monde. L’assise européenne demeure, mais les trois et bientôt quatre éditions de Los Angeles en font la cité la plus olympique de l’histoire des Jeux. Les JO de Melbourne en 1956 sont les premiers de l’hémisphère Sud. Ceux de Tokyo donnent à l’Asie leur première olympiade en 1964. Huit ans plus tard, le drame de Munich fait de la vitrine sportive la chambre d’écho des tensions politiques violentes de la planète. Non sans ambigüités, Mexico, Séoul, Rio, Pékin offrent au monde émergent la consécration de son accomplissement.
On revisite ainsi sous tous leurs angles la légende des JO
Le rappel de l’action du baron de Coubertin met en évidence la vision étroitement élitiste voire aristocratique de ce missionnaire de la paix par la mondialisation sportive. Son invention du pentathlon en 1912 en est la parfaite démonstration. Cette conception rigoriste de la pratique sportive conditionne les débuts de l’olympisme mais est vite remise en cause. Influences et dynamiques divergentes sont présentes dès l’origine. Les JO sont saturés de sens politique dès leur refondation à Athènes en 1896. On découvre avec surprise que les suivants sont pour ainsi dire fictifs. Les prétendus JO de Paris en 1900 passent en fait inaperçus et marginalisent totalement Coubertin et les instances du jeune CIO. L’échéance suivante de Saint-Louis en 1904 est tout aussi artificielle et colore d’olympisme un évènement commercial massivement américano-américain. Il faut donc attendre Londres en 1908 pour que commence enfin à se mettre en place un cadre appelé à se perpétuer.
Son élaboration est graduelle et fluctuante. On assiste à l’invention progressive de ses lieux, ses symboles de ses rites (stade olympique, parade inaugurale des délégations en 1908 aux JO de Londres, anneaux olympiques, etc.). On est étourdi par le ballet incessant par lequel évoluent, apparaissent et disparaissent les disciplines sportives, et au sein de celles-ci les formats et catégories des épreuves. Non sans laisser au bord du chemin épreuves éphémères, sports démodés et disciplines confidentielles (l’auteur de ces lignes avoue humblement n’avoir jamais soupçonné auparavant l’existence du « bandy » et n’est peut-être pas le seul dans ce cas).
La pluralité des enjeux donne une profondeur socétiale et géopolitique importante aux JO
Le long chemin de l’acceptation des femmes et des handicapés, l’émergence des athlètes des jeunes nations décolonisées, l’exclusion de pays considérés comme indésirables pour des raisons politiques en sont autant de visages. La concurrence de jeux mondiaux alternatifs qui émerge à partir de l’entre-deux-guerres reflète la force mobilisatrice de la compétition sportive et son incorporation par le fait politique. L’insertion croissante des athlètes professionnels au sein d’une compétition initialement conçue pour célébrer l’amateurisme n’est pas seulement une question de morale du sport masquant des enjeux de ségrégation sociale sous-jacents. Elle est aussi le baromètre de la montée en gamme du sport business qui accompagne l’amplification médiatique du sport spectacle, dont l’événement JO constitue le sensationnel apogée.
L’élitisme sportif étant un facteur d’émulation des nations, la lutte olympique est évidemment aussi, à ce titre, une modalité pacifique de confrontation entre les États et les systèmes idéologiques soucieux d’affirmer leur supériorité. Les JO nazis de Berlin en 1936 en sont la première déclinaison assumée. Les olympiades de la guerre froide tournent au bras de fer au long cours entre l’Est et l’Ouest, le capitalisme libéral et le collectivisme communiste. Si tant est toutefois que la confrontation ait bien lieu, ce qui n’est le cas ni à Moscou ni Los Angeles par le jeu des boycotts mutuels… Dans le temps présent, la puissance émergente chinoise mène à son tour croisade pour s’imposer au premier rang des puissances sportives.
L’érudition impressionnante de Patrick Clastres est parfaitement servie par une écriture fluide et élégante. Un autre de ses mérites est moins apparent mais infiniment appréciable. C’est celui de n’avoir pas fait allégeance au CIO, organe trop soucieux de son image pour goûter pleinement l’indépendance de ton et d’esprit des historiens qui lui portent intérêt. Sa plume a pu ainsi demeurer entièrement libre d’en observer les stratégies, les accommodements et parfois les compromissions.
On sera plus que jamais convaincu, en refermant ce livre, que le sport est bien plus que du sport, et les JO assurément davantage que des JO. Mais sans y perdre la force magique qui fait leur singularité. On retiendra donc que, de la première olympiade moderne à Athènes en 1896 au feu d’artifice de Paris 2024, chaque édition quadriennale a eu sa couleur distincte, ses originalités propres et ses enjeux spécifiques. Dont chacune est une brique édifiant un monument majeur de l’histoire du sport. Et c’est ainsi que la petite histoire de chaque olympiade tresse la grande mythologie des Jeux Olympiques.