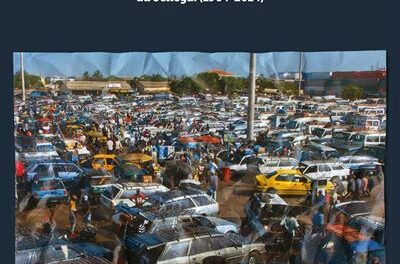Frédéric Martel est un ancien attaché culturel aux Etats-Unis. Il a reçu, pour cet ouvrage, le soutien du centre de recherche de l’EHESS. Il a précédemment publié Le Rose et le Noir, les homosexuels en France en 1968, Le Seuil, 1996. Et Theater. Sur le déclin du théâtre en Amérique, La découverte, 2006. Il anime, par ailleurs, une émission le samedi matin sur France culture : Masse critique, le magazine des industries culturelles.
L’ouvrage qui nous occupe se compose de deux parties : la politique de culture et la société de culture.
La politique de culture
Frédéric Martel propose dans cette partie de s’interroger sur l’une des particularités de l’Etat fédéral américain : l’absence de ministère de la culture. La question de la création d’un ministère de la culture s’est posée sous la présidence Kennedy. Le président et son épouse manifestaient un intérêt certain pour le milieu culturel. Sous l’influence de Arthur Schlesinger et de August Heckscher, le projet de la mise en place d’un conseil présidentiel pour les Arts (idée lancée, au départ, sous Eisenhower) mûrit. Mais, ce conseil ne verra jamais le jour en raison de l’assassinat du président. Toutefois, à l’époque, il n’a pas été question de créer une administration culturelle. Kennedy pensait qu’elle institutionnaliserait les arts et serait préjudiciable à la création et à la liberté de l’artiste. Le président Johnson, même s’il cherche à marquer de son sceau son passage (cf. La Grande Société), reprend les grandes lignes de la politique de son prédécesseur. Il fait donc voter au Congrès la création d’une agence artistique : le National Endownement of Arts. La règle du « matching fund » est l’archétype du fonctionnement de cette agence. L’idée est que pour assurer sa survie et sa liberté, la culture doit être financée non par une source unique mais par des financements variés. Cette technique conditionne l’attribution d’une subvention publique à une institution culturelle à la nécessité pour elle de trouver, de son côté, une somme équivalente par d’autres sources de financement. Ce mode de fonctionnement ne peut donc pas apparenter le NEA à un ministère de la culture.
Ce n’est pas la première fois dans l’histoire des Etats-Unis que l’Etat fédéral aide les artistes. Ceux-ci ont été précédemment aidés lors du New Deal. Il s’agissait alors surtout de donner du travail aux Américains plutôt que de financer la création.
Pendant la guerre froide, la culture américaine se veut un symbole de liberté et une arme diplomatique. S’il est connu que la période a été marquée par le Mac Carthysme (point sur lequel Frédéric Martel s’attarde très peu), en revanche, les agissements de la CIA le sont moins. La CIA a ainsi pu subventionner (secrètement) des artistes pour mettre en avant le concept de liberté dans l’art et pour combattre ainsi l’art officiel stalinien.
L’histoire du NEA fut, dans les années 1960 – 1970, une véritable « success story ». Le budget de l’agence est considérablement augmenté sous Nixon. Sous Carter, le NEA distribue essentiellement ses aides au profit des villes et des communautés (native-americans, noirs, latinos, féministes, gays, handicapés…). Toutefois, les années Reagan et Bush père correspondent aux « culture wars ». On entend par là les initiatives instaurées, contre certaines formes d’art, par des républicains conservateurs et des religieux : campagne contre les œuvres jugées pornographiques, homosexuelles ou portant un regard critique sur la religion. Des représentants au Congrès attaquent le NEA, accusé de subventionner des artistes pervers. Une clause anti-obscénité est même votée par le Congrès. Depuis, les passions se sont calmées mais le NEA n’est plus une force vitale pour les arts.
A travers la bataille du NEA, a eu lieu un débat sur le sens de l’Amérique, sur ses valeurs et son identité.
La société de culture
Sans véritable ministère de la culture, les Etats-Unis ont mis en place un système original de financement. Ce système comprend trois éléments : le secteur public, le société civile et le marché. L’ensemble est cogéré par d’innombrables acteurs indépendants. Ce n’est pas vraiment une politique mais plutôt un mouvement.
La philanthropie joue un rôle particulier dans le système culturel. Elle est très développée. Inaugurée par des magnas de l’industrie, elle s’ouvre aujourd’hui à tous d’autant plus que les fonds versés bénéficient d’exemptions fiscales. La philanthropie permet de financer des grandes institutions culturelles à but non lucratif. Le « fundraising » (levée de fonds) remporte un grand succès aux Etats-Unis.
Cette multiplicité d’acteurs culturels est responsable d’une diversité culturelle qui va bien au-delà des clichés véhiculés. La culture américaine ne se réduit pas à l’industrie d’ « entertainment » (cinéma hollywoodien, musique populaire, pièces grand public de Broadway, best-sellers littéraires). La « high culture » (culture d’élite) américaine se diffuse à travers le monde par le biais de centres culturels, de festivals, de ciné-clubs. Par ailleurs, il existe la « sub -culture » : celle que l’on pratique partout sans que des cadres officiels existent : chorales, clubs de lecture, théâtre de quartier… . Les communautés et les Eglises y tiennent une place considérable même si les institutions culturelles y sont présentes. La culture est alors un moyen mis en œuvre pour sortir les ghettos de leur ségrégation, pour revitaliser les centres-villes.
Le « soft power » (pouvoir « souple » exercé par les valeurs, les modes de vie, la culture et les nouvelles technologies) est donc plus large que l’on peut le penser. Toutefois, force est de constater que la commercialisation de la culture est l’une de ses principales limites. Au nom de la rentabilité, certains mouvements d’avant-garde ne réussissent pas à vivre. De plus, en plus, de grands musées font le choix pour attirer le public et réaliser un maximum d’entrées de monter des expositions grand public (cf. exposition Star Wars). Une grande partie du chiffre d’affaires des institutions culturelles est désormais réalisée par la vente de produits dérivés.
La lecture de cet ouvrage apporte beaucoup. Frédéric Martel a un très bon sens du récit qui permet immerger le lecteur dans l’Amérique des années 1960 à nos jours. C’est une qualité importante pour un livre de cette taille.
L’ouvrage est doté d’annexes très utiles : des graphiques circulaires sur les financements montrant l’importance des dons privés, des tableaux sur les pratiques culturelles des Américains, un lexique des termes américains difficilement traduisibles en langue française, une bibliographie très fournie.
Aussi, c’est un livre dont on pourra conseiller la lecture aux enseignants d’histoire et géographie du second degré. Ceux-ci y trouveront de quoi alimenter leurs réflexions sur les Etats-Unis afin de, peut être, nuancer leur propos lors d’un prochain cours. Une meilleure connaissance des Etats-Unis permet ainsi d’éviter des raccourcis, qui tournent vite à l’anti-américanisme.