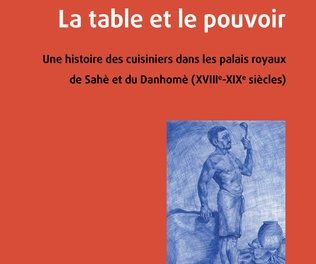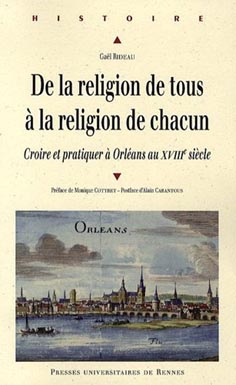
Dans cet ouvrage, tiré de sa thèse, l’auteur se propose d’analyser l’histoire religieuse du XVIIIe siècle de manière « positive », autrement que comme un simple intermède entre la grande époque tridentine et la déchristianisation. Il s’intéresse pour ce faire à Orléans, ville qui connut au XVIIe siècle une intense vie religieuse avant de devenir un pays de mission au XIXe siècle, ce qu’on interprète traditionnellement comme la conséquence de la crise janséniste, particulièrement profonde dans la ville. Son propos est divisé en trois parties, que nous reprendrons ici par convenance.
Les mutations de la réalité paroissiale
Le premier chapitre analyse la manière dont était gérée la paroisse. Il montre que les marguilliers, c’est-à-dire les responsables de la gestion du temporel choisis parmi les membres de l’élite, entretenaient des relations parfois tendues avec le curé ; ce dernier pouvait en cas de conflit jouer le peuple contre eux. L’enjeu était de taille car les comptes de la paroisse devaient être précis et leur gestion représentait un travail important, mais aussi un moyen pour les laïcs de prendre au sein de l’Église un rôle nouveau. Ils accompagnent la transformation financière essentielle de ces décennies, à savoir la croissance des revenus tirés de la location des bancs de l’église, d’abord en viager, puis à l’année, ce qui offre l’avantage, par rapport aux diverses quêtes, de la régularité et donc de la visibilité ; en revanche, ils créent un fossé entre les adjudicataires de ces bancs et les autres couches de la population. L’argent ainsi collecté doit servir au culte divin et à embellir les églises en installant un carrelage uniforme ou en peignant le bâtiment en blanc. Ce chapitre, très intéressant, fait ainsi apparaître une volonté de mise en ordre tant dans les comptes que dans les bâtiments bien agencés avec leurs bancs, le pavage régulier, et le choeur mis en valeur entre autre par des grilles.
Du chapitre consacré à la dévotion paroissiale, qui aborde des aspects divers (prédication, processions, confréries) on peut en particulier retenir deux éléments particulièrement frappants : les évêques successifs réduisent le nombre de jours de fêtes chômés de 47 à 18 entre 1666 et les années 1780, soit en supprimant les fêtes, soit en les repoussant au dimanche que l’on souhaite sacraliser. On peut considérer qu’il y a là aussi une volonté de mise en ordre, d’autant que les jours chômés représentaient une perte de revenus importante pour les travailleurs payés à la journée. L’autre point notable, spécifique à la ville d’Orléans et qui ne vaut pas pour les processions rurales, concerne la fête de Jeanne d’Arc et, dans une moindre mesure, celle du saint patron de la ville, Aignan. Dans les deux cas, la municipalité accroît son emprise sur ces célébrations, dont le tracé se modifie dans la seconde moitié du siècle pour emprunter l’axe de la Rue Royale ; or cette dernière est une réalisation de prestige de la municipalité, dépourvue de connotations religieuses, contrairement aux rues empruntées auparavant. On retrouve ici une prise de contrôle par les laïcs de célébrations autrefois purement religieuses.
L’ouverture des possibles : vers l’individualisation
L’analyse des testaments dans le troisième chapitre fait apparaître des évolutions complexes : la majorité des testaments se concentrent sur les problèmes de succession familiale et, au sens large sur la famille, à laquelle le testateur demande de prier pour lui. Toutefois, l’enseignement essentiel est la multiplication des situations et des cas en fonction des individus, et plus uniquement des groupes sociaux ; elle trouve sa correspondance céleste dans la multiplication des intercesseurs célestes invoqués dans ces testaments.
L’analyse de la querelle janséniste conduit l’auteur à postuler que la postérité de celui-ci réside avant tout dans le développement d’un espace public, conséquence des tensions entre les clercs qui entraînaient pour les laïcs une obligation de choisir : l’adhésion à l’Église n’était plus naturelle, elle devenait un acte réfléchi et donc politique, d’autant que les partis avaient tendance à durcir leurs positions, déboussolant ainsi nombre de modérés. De ce point de vue, bien que cette querelle n’ait duré que quelques décennies, ses conséquences furent sans doute profondes et durables, d’autant qu’elles se conjuguèrent avec l’influence des Lumières ; cette dernière se fit surtout sentir durant les deux dernières décennies de l’Ancien Régime, bien qu’elle soit demeurée modérée et n’ait pas entraîné de forte hostilité à l’Église.
Religion privée et dévotion personnelle
Le modèle de spiritualité proposé aux fidèles est celui du dévot qui approfondit et intériorise sa foi par la prière – une prière dans laquelle l’ange gardien et le Sacré-Coeur tiennent une place croissante dans la seconde moitié du siècle – mais qui s’engage aussi dans le monde, en particulier en instruisant les pauvres. Il contribue ainsi à l’alphabétisation et à la circulation des ouvrages imprimés, dont ont constate la présence dans des milieux de plus en plus divers, puisqu’à partir de 1750 on en trouve même chez des vignerons dans la campagne. L’analyse des inventaires de bibliothèques montre la diversification croissante des titres possédés et un recul relatif des ouvrages religieux au fil du siècle chez nombre de laïcs. L’étude des images et objets religieux dans les mêmes inventaires permet de pousser l’analyse plus loin : là-aussi, la tendance est à une diffusion plus généralisée, en particulier en ville, et le milieu du siècle marque une nette inflexion qui entraîne un rétrécissement des écarts entre les groupes sociaux, de plus en plus nombreux à posséder plusieurs objets. Le plus fréquent est le bénitier, suivi de ceux qui évoquent la Passion (crucifix et diverses formes de croix). À la campagne, en revanche, la croix l’emporte sur le bénitier. Un espace dévotionnel domestique se met donc en place au cours du siècle.
L’ouvrage confirme le décalage fort entre la ville et la campagne, en terme de ressources, de date des innovations… Il montre également que l’imitation des élites fut souvent, mais pas toujours, le vecteur des diffusions des innovations. Il souligne également des points de convergence entre les jansénistes et leurs opposants, qui tous tendent à l’intériorisation par la méditation ou l’oraison, et placent les fidèles en position de choisir les formes que prend leur dévotion, sans pour autant minorer le poids des pratiques collectives.
Peut-on pour autant recommander sa lecture sans réserve? La réponse est malheureusement non, tant elle est ardue : le style est extrêmement abstrait et on a vite fait de perdre le fil durant des pages entières d’analyses quantitatives et arides. Les éléments de la querelle janséniste ne sont par exemple jamais rappelés, l’A. se contente d’y faire des allusions parfois rigoureusement incompréhensibles à qui n’est pas spécialiste du sujet. On aimerait une contextualisation plus générale du cas orléanais : on peut penser que, pour rendre l’ensemble plus clair, il aurait été souhaitable de supprimer une cinquantaine de pages d’analyse minutieuse, et d’en ajouter au moins une vingtaine pour rappeler les débats historiographiques en cours, étoffer les comparaisons entre Orléans et les autres villes (et, pourrait-on ajouter, avec des villes d’autres pays, car il y aurait sans doute à gagner à sortir du cadre français), et développer la conclusion en mentionnant les évolutions de la période révolutionnaire, à laquelle l’A. fait plusieurs allusions pour souligner qu’elles s’inscrivent dans la continuité de l’époque antérieure.
La question est de savoir à quel point il convient de remanier une thèse publiée dans une collection à destination d’un public plus large que la seule communauté universitaire : on peut penser qu’en l’occurrence la réécriture, puisque réécriture il y a, aurait gagné à être plus pédagogique.