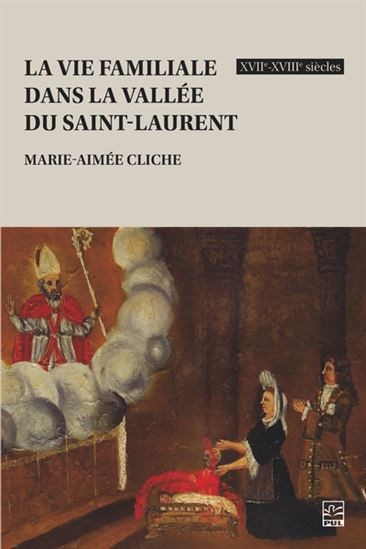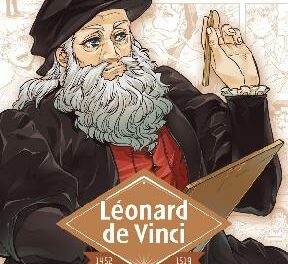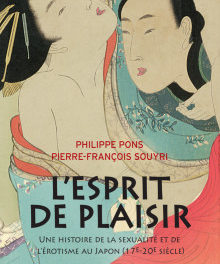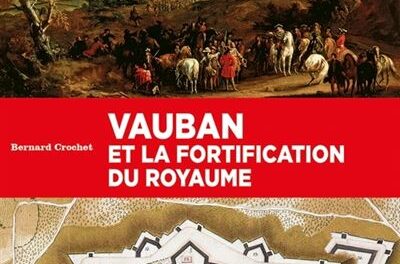Cet ouvrage est un tableau des connaissances sur la vie familiale dans la vallée du Saint-Laurent. Du cadre légal et religieux aux aspects plus intimistes, Marie-Aimée Cliche propose un portrait des habitants de la Nouvelle-France aux XVIIe et XVIIIe siècle.
Dans son introduction, Marie-Aimée Cliche définit le cadre de son étude. Elle rappelle brièvement l’histoire de la population québécoise : au XVIIe siècle un peuple d’immigrants alors qu’au siècle suivant la croissance démographique est, pour l’essentiel, naturelle. Durant le Régime français, avant le traité de Paris de 1763 les immigrants sont évalués à 30 000, et même 67 000 si l’on compte les marins et les soldats. 10 000 se sont installés : 3 900 engagés, 3 500 soldats qui restent car ils peuvent acquérir une terre, 1 100 jeunes filles, 1 000 prisonniers et 500 volontaires. De la centaine d’habitants européens en 1627, on en dénombre environ 250 000 en 1806.
L’autrice place son étude dans le mouvement initié par Philippe Ariès avec son étude, L’enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régimeparu en 1973 au Seuil et disponible en ligne https://archive.org/details/lenfantetlaviefa0000arie, L’autrice fait aussi référence à Stéphane Minvielle, La famille en France à l’époque moderne (Colin, 2010) et pour le Québec à l’article de Denise Lemieux, « La famille en Nouvelle-France », et celui de Gourdon et Ruggiu, « Familles en situation coloniale » .
En Nouvelle-France, la société est très hiérarchisée, encadrée par l’autorité de l’Église catholique, y compris dans tous les aspects de la vie familiale.
Au nom du père
L’obéissance au roi et à Dieu était le fondement de la société.
Les lois civiles françaises faisaient de l’homme le chef de la famille : « en sorte que sa femme lui doit être docile, circonspecte et attentive à lui plaire, en se soumettant de bon gré au pouvoir juste et légitime que les lois divines et humaines lui ont donné sur elle.Extrait du Dictionnaire de droit, en 1734, cité p. 10 ».
C’est la Coutume de Paris qui est applicable en Nouvelle-France. Le mari est maître des biens communs et administrateur des biens de son épouse. Si le chef de famille était loin, une procuration signée autorisait sa femme à agir à sa place. Après 1763, une brève tentative pour instaurer les lois civiles anglaises, les lois françaises continuent à être appliquées. Le patriarcat était la norme en Angleterre comme en France.
Le poids de la religion catholique est fort et s’appuie sur les suites du Concile de Trente et dessine un modèle familial pour les Canadiens. Le clergé, notamment jésuite était chargé de l’encadrement de la population française et d’évangéliser les Autochtones. La dévotion à la Sainte Famille fut grande au Canada, sur le modèle de l’ouvrage paru en 1675, La solide dévotion à la très sainte famille de Jésus, Marie et Joseph, avec un catéchisme qui enseigne à pratiquer leurs vertus, un catéchisme parmi d’autres présentés par l’autrice.
À chacun sa chacune : la formation du couple
La famille est d’abord une entité économique. Au XVIIe siècle, la formation des couples était particulière du fait d’une immigration majoritairement masculine. On voit, malgré les lois, des mariages de filles très jeunes : en 1654, Marguerite Sedilot, fille d’un couple d’immigrants français, n’a que 11 ans et demi. La puberté était fixée à 14 ans pour les garçons et 12 ans pour les filles.
C’est dans ce contexte que fut organisée une immigration sélective des « Filles du Roi » qui selon Yves LandryYves Landry, Orphelines en France, pionnières au Canada : les Filles du roi au XVIIe siècle, Montréal, Leméac, 1992. étaient « des immigrantes, filles ou veuves, venues au Canada de 1663 à 1673 inclusivement et ayant bénéficié de l’aide royale dans leur transport ou leur établissement, ou dans l’un et l’autre ». Il en a dénombré 770Sur ce sujet voir les nombreuses études dont : Catherine de Baillon : enquête sur une fille du roi, (2001), Les Filles du Roy pionnières de Montréal ( 2017), Les Filles du Roy pionnières de la seigneurie de La Prairie (2019), Les Filles du Roy pionnières de la seigneurie de Repentigny (2021), Les Filles du Roy – pionnières des seigneuries de Varennes et de Verchères (2022), Les Filles du Roy pionnières des seigneuries de la Côte-du-Sud (2022).
Les nouveaux installés cherchaient une terre où bâtir la maison puis une épouse, si possible robuste et apte au travail des champs, le début d’une nouvelle vie.
Une ordonnance, en 1670, menaçait d’être privés de toutes sortes de liberté (chasse, pêche et traite avec les sauvages) les hommes en âge de se marier. Ils devaient le faire dans les quinze jours après l’arrivée des navires, il est vrai qu’elles étaient, à leur arrivée, à la charge de l’État.
Les unions, ainsi réalisées, devaient l’être en respectant la hiérarchie sociale, pour les officiers des orphelines de bonne famille.
L’autrice compare avec l’immigration de filles à marier en Virginie et en Louisiane.
Pour favoriser les mariages, fut instituée en 1670, une donation royale de vingt livres aux garçons qui se mariaient avant 20 ans et aux filles avant 16 ans. Malgré cette mesure, l’âge moyen au premier mariage était, en moyenne sur la période, de 22 ans pour les filles et 26 ans pour les garçons, soit un peu plus jeune que pour la métropole.
La formation du couple en temps ordinaire était soumise aux contraintes des mœurs du temps et de la religion. Il fallait éviter les bals, la lecture des romans, les fréquentations se déroulaient sous le regard des parents et des voisins. L’homogamie sociale était forte. L’endogamie géographique n’est pas absente, faible au début de la colonisation, elle devient forte quand la population augmente, les mariages croisés, deux frères épousant deux sœurs, par exemple sont fréquents :
À La Prairie, d’après l’historien Louis Lavallée : « De 1670 à 1759, dans près des trois quarts des cas (72,3 %), le conjoint a été choisi à l’intérieur des 120 kilomètres carrés de la seigneurie, laquelle coïncidait à peu de choses près avec la paroisse pendant la majeure partie du régime français. Quant aux futurs époux « étrangers » (27,7 % des cas), ils venaient presque tous de la région de Montréal. » (p. 49)
L’autrice évoque ensuite la sagesse des filles (peu d’enfants hors mariage) et la question de l’argent, comme motif d’opposition des parents au mariage. Elle aborde aussi la question de l’amour.
Un autre motif d’opposition au mariage était une différence de religion ou une union entre Canadiens et Autochtones, pourtant encouragée au début de la colonisation. Cette situation, mariage ou union libre, concernait, de fait les « coureurs des bois » des Pays d’en Haut, qui permettait d’établir des liens avec la tribu de la compagne.
Les historiens André Lachance et Sylvie Savoi, de 1644 à 1760, ont retrouvé 180 mariages entre Canadiens et Autochtones, en incluant les Pays d’en Haut et les postes de traite du bas du fleuve (p. 69)
Après les oppositions, les moyens de les exprimer et de les combattre, l’autrice décrite « les mariages à la gaumine » ou mariage par consentement mutuel imposé au prêtre, une vingtaine entre 1703 et 1792, « C’était pendant la messe (ou la célébration d’un autre mariage) que les jeunes gens se levaient et déclaraient à haute voix qu’ils se prenaient pour mari et femme, profitant ainsi de la présence du curé et de nombreux témoins » (p. 77).
L’autrice décrit le mariage : le contrat de mariage, la cérémonie du mariage. Le mouvement saisonnier des mariages suit les prescriptions religieuses, les réalités du travail agricole. Les veuves avaient plus de chance de se remarier à condition de respecter un délai après la mort de l’époux.
Ceux qui ne se mariaient pas, moins de 15 % des cas, sont soit des religieux soit un célibat laïque, source d’embarras pour la famille quand c’est une fille.
Il est ensuite question des liaisons hors mariage et des enfants illégitimes, moins de 2 % des naissances. Les sources judiciaires permettent d’approcher la situation des liaisons : filles d’artisans, d’habitants ou servantes, 7,8 % seulement appartenaient à des familles de notables alors qu’ils représentent 25 % des hommes (rappelons que l’âge au mariage était tardif). Ces fréquentations intimes débouchaient souvent sur un mariage, en cas de conception prénuptiale, en cas contraire cela pouvait se terminer devant le juge. L’autrice décrit quelques procès « pour séduction »
Sous le Régime anglais, il semble que, pour les Anglais, les mœurs aient été un peu plus libres
« Seigneur et maître » et « chère compagne »
Ce chapitre aborde la vie intime des couples, à partir des archives judiciaires et de statistiques constituées grâce aux registres d’état civil.
L’Église a un double discours, méfiance à l’égard de la « concupiscence » mais incitation à la procréation. Elle prêche la chasteté, c’est-à-dire la continence dans le mariage, notamment des veuves et veufs. Des récits rapportent aussi ce type de comportement parmi les Autochtones convertis. La chasteté, entre époux, est prônée trois jours avant de recevoir l’eucharistie et bien sûr durant le carême, ce qui semble vérifié dans la courbe saisonnière des naissances. Les terres disponibles étant nombreuses, peu de limitation des naissances avant le XIXe siècle.
Si les recommandations de l’Église ont eu peu d’influence sur la fécondité : 56,8 naissances pour 1000 habitants (1710 – 1760), 52,2 pour 1000 entre 1791 et 1800. Des familles très nombreuses donc, où le plus jeune est plutôt destiné à la prêtrise. La mortalité infantile est élevée et augmente au cours du XVIIIe siècle : 24,1 % des nourrissons nés dans la vallée du Saint-Laurent entre 1621 et 1779. Elle est plus importante dans les familles nobles.
Au XVIIe siècle, les Canadiennes ont plus d’enfants vivants que les métropolitaines (espacement plus court des naissances, l’absence de contraception et une stérilité définitive plus tardive). La situation est assez comparable dans les colonies anglaises.
Pour encourager la natalité, l’édit de 1670 instaure une pension annuelle de 300 livres (400 pour 12 enfants) pour les Canadiens, pères de dix enfants vivants, nés de légitime mariage et n’étant ni prêtres, ni religieux, ni religieuses.
Comme en Europe la mortalité en couche représente, en moyenne, 1,5 % des naissances.
Le modèle de la famille est celui du ménage conjugal, pas de familles élargies. L’accueil du jeune couple chez l’un des parents, vu dans les contrats de mariage, est temporaire.
L’autrice décrit de petites maisons de bois, une seule pièce chauffée par la cheminée. Au sein du couple, les travaux sont différents. Outre le soin du ménage et des enfants, les femmes travaillent au champ.
L’autonomie est plus grande quand la femme dispose d’une procuration, plutôt dans la bourgeoisie, et aussi quand les hommes pratiquent la traite des fourrures. L’autrice donne quelques exemples de femmes entrepreneusesFemmes et économie en Nouvelle France par Catherine Ferland dans RVH Blois – Table ronde, carte blanche aux Rendez-vous d’histoire de Québec.
Toutefois, en matière juridique, la femme reste mineure en droit, telle cette sage-femme qui, pour porter plainte pour insulte, doit avoir l’accord de son mari.
Si le divorce n’existe pas, la séparation des époux est possible comme la séparation de biens si l’épouse pense que le mari dilapide les biens communs (50 séparations sur 130 demandées sous le Régime français). Certaines séparations sont liées à la longue absence des coureurs des bois : « Un de ces maris avait abandonné sa femme depuis plus de sept ans pour s’en aller « aux Outaouais et autres pays » » (p. 171)
La séparation de corps étaient plus difficile à obtenir. Les motifs évoqués sont la maltraitance, une maladie vénérienne du mari, si la femme est adultère… La fuite est toujours possible comme le montre quelques exemples.
Si les disputes et les adultères se retrouvent dans la chronique judiciaire, mais la relation entre mari et femme semble un réel partenariat conjugal.
« Respecter et servir » : être enfant dans un pays neuf
Les chercheurs québécois ont étudié l’œuvre des communautés religieuses enseignantes qui offrent plus de traces que l’éducation donnée en famille. Ce chapitre aborde les différents âges de l’enfance : l’année qui suit la naissance de l’enfant, le premier âge, l’instruction donnée à partir de 7 ans. En cherchant à montrer les relations parents-enfants, l’affection qui leur est portée et l’influence de l’Église sur l’éducation.
Dès la naissance, l’enfant est baptisé. En cas de danger, « même les femmes, les hérétiques, les infidèles » (p. 216) peuvent pratiquer l’ondoiement qui assurait l’accès à la vie éternelle. Au début de la période, l’intervalle entre la naissance et le baptême était en moyenne de 12 jours à cause des difficultés de communication, la dispersion des paroisses et le climat canadien. Ce délai était, aussi parfois, lié à l’attente de la présence des parrain et marraine, théoriquement pubères ce qui n’est pas toujours respecté.
« Les enfants du seigneur étaient choisis pour parrainer l’enfant d’un serviteur, comme Geneviève Boucher, choisie à l’âge de 9 ans, en 1686, pour être la marraine de Gabrielle Picard, fille d’un domestique de sa famille » . (p. 222)
L’autrice évoque les baptêmes catholiques d’enfants de protestantes anglaises amenées captives par des Autochtones et « vendues » à des Canadiens. Elle présente aussi le choix du prénom. L’autrice s’appuie sur les travaux de Danielle Gauvreau sur la mise en nourrice à Québec de 1680 à 1729 et d’Émilie Robert pour l’île de Montréal de 1680 à 1768. La pratique de la mise en nourrice concerne la noblesse et la bourgeoisie marchande et essentiellement la population urbaine. Les nourrices sont concentrées dans un rayon d’une quinzaine de kilomètres autour de la ville. Les décès se concentrent sur les mois d’été, même si la mortalité en nourrice semble plus faible qu’en métropole. Les écrits religieux nous renseignent sur le sécurité et la moralité, mais on sait peu de choses des premières années des enfants. Pour se prémunir des dangers, les parents s’en remettent aux saints, notamment Sainte Anne.
L’éducation est d’abord religieuse, dès les années 1640, les jésuites recommandaient de prier Dieu, soir et matin en famille, de réciter « le chapelet de la sainte Famille ». Les Ursulines ont rédigé des catéchismes tant pour leurs élèves françaises que pour les Hurons. Les autorités incitent les parents à conduire les enfants, à partir de l’âge de raison, à l’office dominical.
Les congrégations, grâce à une aide financière de l’État et de donateurs proposent une instruction élémentaire, gratuite. La contribution des parents était indispensable pour payer la subsistance des pensionnaires. Les « petites écoles » dont la première fut ouverte à Québec par les jésuites en 1635. En 1658, les Ursulines, à côté du pensionnat pour les orphelines et fillettes autochtones, ouvrirent un externat pour aux filles des habitants de Québec. Marguerite Bourgeoys, de la congrégation des Sœurs de Notre-Dame, ouvrit la première école à Montréal, la même année. Ces écoles assuraient l’enseignement de la lecture, l’écriture, le calcul sans oublier les prières. Elles se multiplièrent à la demande des habitantsL’étonnante soif d’instruction des défricheurs par Roger Barrette, dans RVH Blois – Table ronde, carte blanche aux Rendez-vous d’histoire de Québec. Il existait aussi quelques instituteurs laïcs qui allaient de paroisse en paroisse.
Le taux de signatures s’établit à 20 % en moyenne, avec une baisse sous le Régime anglais. Il est plus élevé pour les hommes et en ville.
L’instruction secondaire est réservée à l’élite comme par exemple au collège des jésuites de Québec.
Un enseignement professionnel, hydrographie et cartographie, est dispensé pour les pilotes et des navigateurs. Tandis que la formation aux métiers se faisait par l’apprentissage ou dans le cadre familial, l’autrice évoque l’apprentissage dans le cadre de la domesticité dont les clauses sont présentes dans les actes notariés.
Le climat familial : Si quelques textes font état d’une folle tendresse, qui aurait été inspirée par la façon dont les Autochtones se conduisaient avec leurs enfantsLa Relation du père Lejeune en 1634 raconte l’hiver qu’il a passé avec une famille de Montagnais. (p. 277) : apprentissage de la vie nomade, incitation à faire preuve d’endurance lors des périodes de pénurie., les punitions corporelles étaient la règle. En cas de dépassement, les juges se chargeaient d’en rappeler les limites. L’affection des parents, peu publique nous est connue par quelques témoignages lors du décès d’un enfant.
Pour les petits garçons de 10 ou 12 ans de la campagne, l’enfance était terminée. La réalité était guère différente pour les futurs soldats et officiers, l’âge réglementaire fut fixé à 15 ans pour un emploi de cadet, en 1720.
L’autrice aborde la question de la bénédiction paternelle du Jour de l’an, cérémonie qui apparaît au milieu du XIXe siècle.
« Hors de la famille, point de salut » ?
La famille est l’unité économique de base d’où son importance, notamment pour les nouveaux colons venus rejoindre un parent. Le réseau familial est d’autant plus important pour une l’activité de commerce colonial comme le montre les exemples cités.
La famille permet de venir en aide aux plus fragiles, vieillards, handicapés, veuves chargées d’enfants, non pris en charge par les hôpitaux généraux de Québec et de Montréal.
L’autrice traite longuement du sort des veuves et des orphelins. Quand une femme se retrouvait seule, l’entrée dans l’Église pouvait être une solution. Sans espoir de remariage, de nombreuses veuves rentrèrent dans une congrégation, se séparant même de leurs enfants.
Enfin, elle aborde, grâce aux sources judiciaires, la situation des enfants illégitimes. Certains furent confiés « aux Sauvages », l’ordonnance de 1722 les confie aux autorités pour être mis en nourrice. Pour les garçons, l’engagement auprès d’un maître est une solution. Au milieu du XVIIIe siècle, un début d’institutionnalisation règle leur sort.
On ne saurait passer sous silence le sort des « captifs », ces enfants enlevés à leur famille, lors des guerres avec les colonies anglaises, on parle d’ « enfants canadianisés ».
D’une génération à l’autre
Ce chapitre aborde la question de la transmission d’un patrimoine acquis à la sueur du travail de défrichement entrepris par les immigrants.
La Coutume de Paris, appliquée en Nouvelle-France était égalitaire, du moins pour les roturiers. Sous le Régime anglais, l’Acte de Québec rétablit les anciennes lois du Canada en 1774. L’autrice décrit des successions à la campagne et les stratégies parentales, comme les donations entre vifs. La transmission des biens nobles est illustrée par la succession du sieur Jean-Baptiste Peuvret Demesnu et celle de la famille noble La Durantaye.
Évoquer les successions, c’est aussi poser la question des conditions de la vieillesse : vieillir seul en ville, vieillir dans la famille, « Se donner » à une communauté.
L’autrice fait une rapide comparaison avec la situation dans les colonies anglaises du Sud.
Les serviteurs : des membres de la famille ?
Selon les préceptes du temps, les serviteurs font partie de la famille. Leurs conditions de vie variaient beaucoup selon l’âge, le genre et le statut (libre ou esclave), mais aussi selon le milieu social des employeurs. L’Église proposait un modèle de relation : les rapports maître-serviteur.
Il existait différentes façons de servir : l’engagement, généralement de trois ans pour les candidats au voyage depuis la France, les contrats de veuves, les orphelins placés, sans oublier les esclavesVoir L’esclavage et les Noirs à Montréal 1760-1840, Frank Mackey, Montréal, Canada, Ed. Hurtubise, Cahier du Québec, 2013. Les façons de vivre étaient aussi différentes. L’autrice aborde leur vie religieuse dont le maître est garant, les conditions matérielles différentes selon la taille de la domesticité et de la libéralité des maîtres, et des sanctions.
La vie familiale des domestiques n’était pas possible durant le temps de l’engagement. Les esclaves pouvaient fonder une famille avec l’accord de leur maître qui pouvait séparer la famille en cas de vente d’un esclave. Les relations maître-serviteur pouvaient être bonnes, certains restèrent toute leur vie au service de la même famille. Concernant les esclaves, si certains ont connu plusieurs maîtres, dans d’autres cas le maître organise sa vie familiale et le garde à son service, des exemples montrent l’existence d’attachements affectueux.
En Conclusion, on peut citer l’autrice :
« La vie était dure au Canada au XVIIe et au XVIIIe siècle. Dure pour les colons qui s’éreintaient à déboiser une terre en friche. Dure pour les coureurs de bois qui pagayaient à longueur de journée et trimbalaient des paquets de 100 kg lors des portages. Dure pour les femmes qui trimaient à côté de leur mari, accouchaient à répétition et perdaient un enfant sur quatre. Dure enfin pour les enfants, soumis aux punitions corporelles, mis au travail très tôt dans les milieux populaires, placés en service chez des étrangers pour les plus pauvres. Tous souffraient des disettes, qui frappaient plus durement le peuple, et des épidémies qui fauchaient tout le monde indistinctement. » (p. 451)
Un ouvrage bien documenté qui donne à voir la vie en Nouvelle-France. L’auteur s’appuie sur les travaux d’autres historiens, toujours cités et donne de nombreux exemples qui agrémentent agréablement la lecture.