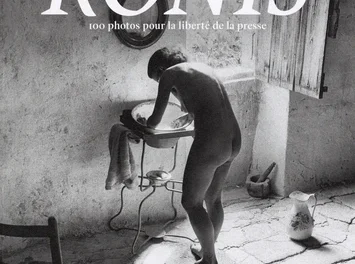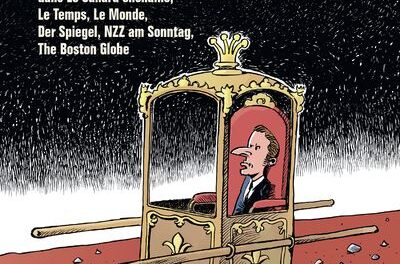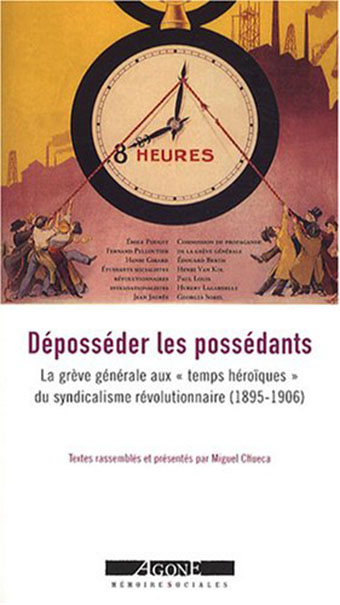
Il peut paraître étonnant de rendre compte d’un ouvrage relativement ancien, puisque celui-ci a paru en 2008. Mais ce qualificatif ne vaut qu’aux yeux du commerce. L’actuel contexte de conflits sociaux, qui n’est pas le premier depuis 2008 et qui ne sera pas le dernier, permet en effet d’en reconnaître toute la pertinence. Car l’expression « grève générale », si elle n’est peut-être aujourd’hui plus guère qu’un slogan que l’on brandit dans l’enthousiasme, en rêvant aux lendemains qui chantent, ou pour mobiliser les foules, mérite qu’on en connaisse les racines. Et c’est bien le mérite du recueil de Miguel Chueca (qui qualifie le mouvement qui porte cette idée de « grève-généraliste »), qui réunit des textes nombreux et riches, lesquels nous permettront de mieux saisir ce qui se cache derrière ces mots, les débats qui ont opposé de grands noms du mouvement social au moment de la marche vers la fusion des courants socialistes qui conduit à la naissance de la SFIO (1905) et de l’apogée du syndicalisme révolutionnaire : Pelloutier, Jaurès, Sorel, etc. Car, oui, il y eut bien un syndicalisme révolutionnaire…
L’idée d’un recueil pourrait effrayer : lire toute une suite de discours, de proclamations, de réflexions n’aurait peut-être pas grand chose de réjouissant. Mais Miguel Chueca ouvre le livre par une longue et très érudite introduction (« Contributions pour introduire à un débat inachevé) ; il a pris soin de présenter chacun des rubriques et d’annoter chacun des textes (dix au total). Outre cela, on trouvera une chronologie « essentielle » (d’une quinzaine de pages, tout de même…) qui dépasse le cadre de l’ouvrage (1879-1909), ainsi qu’un glossaire biographique d’une trentaine de pages. Outre cela, il nous est proposé une bibliographie. Il s’agit ainsi d’un véritable travail d’édition, très soigné, qui rendra bien des services aux étudiants, aux enseignants, et, d’une façon générale, à tout ceux qui s’intéressent à la chose publique.
Une lecture rapide laisserait croire que la grève générale accompagne le mouvement ouvrier depuis toujours : il n’en est rien. Ce n’est guère avant les années 1886-1888 qu’elle est colportée par un compagnon ébéniste, l’anarchiste Joseph Tortelier (1854-1925), qui dit que « ce n’est que par la grève universelle que l’ouvrier créera une société nouvelle, dans laquelle on ne trouvera plus de tyrans ». C’est ce que rappelle Charles Jacquier en préalable au film sur la grève de Grandpuits, dont le propos constitue une excellente introduction au thème qui nous occupe ici.
La période retenue par Miguel Chueca est bornée par deux dates (p. 47), à savoir celle qui correspond à la publication en 1895 de la brochure « Qu’est-ce que la grève générale », par Fernand Pelloutier (secrétaire général de la Fédération des bourses du travail) et Henri Girard (secrétaire du Comité de la grève générale). Elle se referme avec l’article que Georges Sorel fait éditer dans Le Mouvement socialiste en 1906 : « Réflexions sur la violence ». Ces deux textes sont évidemment présents dans le recueil.
Miguel Chueca indique très clairement qu’il a principalement retenu le point de vue exprimé par les partisans de la grève générale, et donc les arguments qui permettent d’en comprendre l’intérêt et les enjeux dans le mouvement social. En contrepoint, il a choisi les contempteurs de cette idée que sont Jean Jaurès, qui donne son opinion en 1901, et du Hollandais Henri Van Kol, qui apporte le regard de la social-démocratie européenne. Ce dernier a des mots très durs à l’encontre de la grève générale : pour lui, il ne s’agit que d’ « une utopie anarchiste », « une fantaisie dangereuse d’ouvriers mal organisés » (p. 179), « un rêve anarchiste » qui « doit impérativement aboutir à une révolution violente » (p. 180). Or, selon lui, elle n’aurait de chances de réussir que dans un contexte où il existe de puissants partis et syndicats. Et encore : à admettre que les prolétaires disposent de tels moyens, ils ne maîtriseraient pas les forces de l’ordre, la justice, la législation. Mieux vaut donc patienter, s’engager dans la voie réformiste et entreprendre la conquête du pouvoir.
Jaurès est plus subtil : il prend garde de ne pas opposer franchement les deux chemins, réformiste et révolutionnaire, qui mènent à l’émancipation du prolétaire et à une société plus juste. Il ne s’oppose pas au principe de la grève générale, mais il dit (p. 113 à 115) que sa réussite est conditionnée par le soutien de la population, l’utilisation de l’arme légale de la grève (et non de la violence), et, évidemment, l’adhésion la plus large de ses protagonistes à l’objectif poursuivi. Il ajoute qu’elle ne peut pas être utilisée à de multiples reprises, ni même relancée : pour gagner, le mouvement doit être plein et unique. De la même façon que si la grève sombrait dans la violence (et les risques, selon lui, sont très grands), des échecs successifs renforceraient non seulement les défenseurs du capitalisme, mais épuiseraient et désarmeraient le prolétariat, qui perdrait le peu d’avancées sociales gagnées jusque là. C’est la raison pour laquelle il ne croit pas qu’elle puisse être une sorte d’entraînement à la révolution, à cause des sacrifices qu’elle impose. On note qu’il rejoint Van Kol, quand celui-ci montre qu’il ne faut pas sous-estimer la force de répression du capitalisme. Mais pour autant, Jaurès dit clairement qu’il ne faut pas renoncer à la grève générale, considérée comme l’arme ultime brandie face au capital, s’il lui venait jamais à l’esprit de rogner sur les libertés péniblement acquises : il s’agirait alors d’une « tactique du désespoir ». La seule solution est donc dans une patiente progression vers le pouvoir politique : « conquérir légalement la majorité » (p. 127).
La grève générale n’est pas seulement combattue par les réformistes. Les partisans de Jules Guesde appuient les détracteurs de la grève générale, mais ils privilégient l’invective au détriment d’une véritable argumentation : ils craignent surtout d’être concurrencés par un courant révolutionnaire beaucoup plus dynamique (p. 109).
Par effet d’opposition, on perçoit probablement les arguments des « grève-généralistes » : il suffit de retourner ce que disent Jaurès et Van Kol. On est obligé de résumer ici. La grève générale est effectivement une arme essentielle aux mains du prolétariat, car elle est l’expression de l’immense majorité de la population : face à elle, le capital ne peut que plier. L’objectif est bien révolutionnaire : la conquête progressive de nouveaux droits, de nouvelles libertés ne sauraient être un but en soi, car il s’agit bien de changer de société, en s’emparant de tous les leviers de pouvoir, et en s’emparant des moyens d’assujettissement contrôlés par les possédants, y compris par la violence. Pour autant, selon la commission de propagande de la grève générale, l’expérience des révolutions avortées conduit à l’idée qu’ « une émeute serait une folie […] vouée à l’insuccès fatal » (p. 153), face aux moyens militaires dont dispose le pouvoir capitaliste.
La révolution est donc une nécessité, et la réforme est donc une impasse : elle ne peut donc passer par les partis, aux mains des « docteurs de socialisme » (p. 67). En revanche, il faut s’y exercer : les grèves ponctuelles, sporadiques, doivent être entendues comme des moyens d’éveil des consciences, d’entraînement à la grève générale. Car la grève générale suppose, par définition, qu’elle implique la majorité des travailleurs ; en cela, les grèves-généralistes rejoignent bien Jaurès. Mais elle doit partir du peuple, qui déclenchera le mouvement dès lors qu’il s’y sentira prêt, quitte à ce que ce soit le fait d’une minorité agissante. Les syndicats, et non les partis socialistes (puisque réformistes), sont donc les lieux privilégiés de cette prise de conscience et de cet entraînement, qui a l’avantage de renforcer la solidarité (p. 97) : on sent bien ici la marque du courant libertaire, anarchiste, qui domine le syndicalisme français d’alors. L’idée est également de ne pas se limiter à un espace national : il y a lieu de s’appuyer sur l’Internationale, qui propose aux travailleurs de se mobiliser pour la journée de huit heures partout dans le monde, et au même moment. C’est l’objectif du Premier Mai, comme le rappelle Émile Pouget (p. 55). Cela s’oppose à l’idée d’une révolution politique : il s’agit d’une révolution économique et sociale. La grève générale doit demeurer « sur le terrain économique », et se tenir « en dehors du mouvement électoral et parlementaire et du personnel politicien (p. 106). Elle « est une révolte sociale contre le patronat » qui doit permettre de fonder une société communiste (au sens anarchiste), comme le résume la formule « Tuer la vieille société par l’inertie ouvrière et, sur le fumier capitaliste, faire éclore la société communiste où le bien-être et la liberté seront l’apanage humain ! » (p. 154).
Frédéric Stévenot, pour les Clionautes©