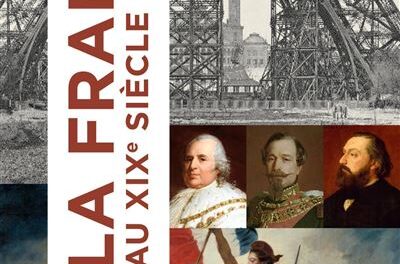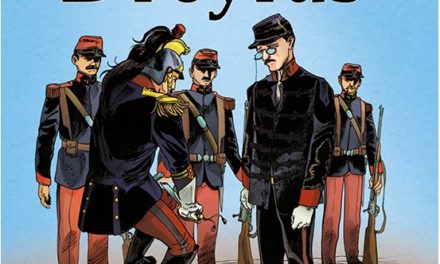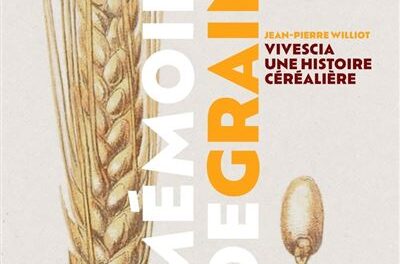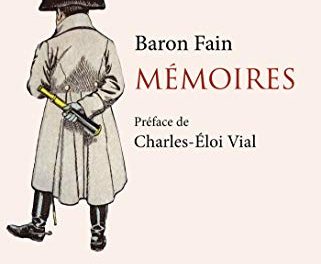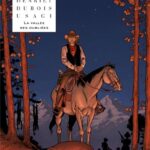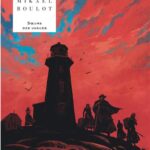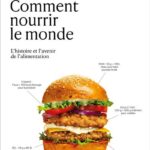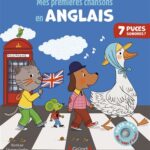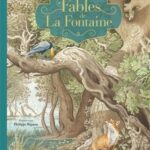L’histoire du Parti socialiste unifié (PSU), petit parti-passoire, très hétérogène, dans lequel les tensions furent parfois fortes et dont la vie fit brève (1960-1989), présente-t-elle un quelconque intérêt de nos jours ? La lecture de l’ouvrage d’Octave Pernet nous amène à répondre à cette question par l’affirmative pour plusieurs raisons. Du fait des choix que fit ce parti, en particulier en s’opposant à la guerre d’Algérie ; du fait des thèmes et des idées qu’il tenta de diffuser (écologie, féminisme, autogestion…) mais aussi, nous y reviendrons, du fait des pratiques qu’il tenta d’impulser en son sein. Enfin, ne l’oublions, même si ce n’est pas le coeur de l’ouvrage, des personnalités reconnues depuis y militèrent à un moment ou à un autre. Des « politiques » furent nombreux : Michel Rocard, Jean Auroux, Pierre Bérégovoy, Jack Lang, Claude Malhuret et bien d’autres en firent partie. Des « intellectuels » dont nombre d’historiens le rejoignirent : Pierre Vidal-Naquet, René Dumont, François Furet… Des syndicalistes ou des respsonables d’associations y militèrent : Charles Piaget (leader des Lip en 1973), Bernard Lambert (syndicaliste flamboyant de la gauche paysanne), Jacques Chérèque (responsable de la CFDT), l’avocat Henri Leclerc.
Pourquoi un groupe aux forces restreintes (voire très restreintes) attira-t-il des personnalités mais aussi nombre de militants bien moins connus ? C’est en menant une histoire de ce parti par le bas que l’auteur entend répondre à cette question.
Une histoire par le bas du PSU
Octave Pernet a travaillé sur des documents internes et externes du PSU, il a mené de nombreux entretiens avec d’anciens militants de régions différentes et analysé les documents recensant le nombre de militants tout en s’appuyant sur la bibliographie existante[1]. Il dresse, à partir des données recueillies, un tableau de la composition sociale du mouvement et présente aussi l’évolution de celle-ci du début des années 1960 à la fin des années 1980. Il adopte, par ailleurs, dans le livre « un point de vue anthropologique du militantisme ». Ce qui fait que nombre de réflexions et d’analyses qu’il avance sont valables pour d’autres partis politiques[2]. S’engager au PSU, c’est d’abord vouloir s’engager à gauche sur le plan politique mais sans rejoindre la SFIO (Section française de l’internationale ouvrière) puis le Parti socialiste (PS) de François Mitterrand) ni le PCF (Parti communiste français). Et ce, par opposition à leur action pendant la guerre d’Algérie pour l’un (F. Mitterrand, ministre de l’intérieur sous la IVème République, a mené une politique très répressive) ou par critique de celle-ci en Mai-juin 1968 pour l’autre. En effet, pour certains, le PCF s’est opposé au mouvement contestataire. Par ailleurs, bien que le parti n’offre pas de rétributions politiques à court terme, il est un lieu de sociabilités, où se constituent des réseaux amicaux qui contribuent à expliquer la longévité de l’engagement de certains militants, en particulier de ceux qui y ont adhéré dans les années 1960. Enfin, ce parti est aussi un lieu de débats, un laboratoire d’idées, original, novateur, et donc un espace de formation intellectuelle qui permit à de nombreux militants d’utiliser ensuite le capital culturel acquis au PSU.
Un laboratoire d’idées et de pratiques militantes novatrices… mais pas toujours appliquées
Le PSU s’opposa activement, on le sait, à la guerre d’Algérie jusqu’au terme de celle-ci en 1962, d’où une sensibilité tiers-mondiste affirmée. Son activisme en Mai-juin 1968, le soutien aux paysans du Larzac et aux ouvrières et ouvriers de l’usine Lip ainsi que la diffusion dans la société d’idées contestataires expliquent l’intégration dans son champ d’action de « revendications post-matérialistes » : antimilitarisme, préoccupations écologistes avec l’opposition au nucléaire civil, défense des immigrés, revendications féministes, campagne sur les transports, critiques de la ville capitaliste, sensibilité régionaliste et autogestion dans les entreprises.
Confronté à un déclin significatif à partir du mitan des années 1970 et aux nouvelles aspirations des militantes et des militants, dans et hors du parti, le PSU tente d’intégrer de nouvelles pratiques militantes : responsabilités collégiales, commissions femmes non-mixtes, augmentation de la part des femmes dans les organes de direction, volonté d’inclure davantage les militants « disposant de peu de capitaux culturels », importance accordée à la formation, critique du militantisme « total »… Autant d’idées qui restent souvent à l’état de voeux du fait du déclin du parti et des forces d’inertie qui y existent.
De fait, une fois de plus en crise, à partir de l’entrée de Huguette Bouchardeau au gouvernement socialiste en 1983, le parti se dissout en 1989.
Un livre très clair, bien écrit, dont les apports seront utiles à tous ceux qui s‘intéressent à la vie politique et sociale de la Vème République. Mais aussi à ceux qui se questionnent sur le rôle des partis et sur les liens qu’entretiennent adhérents, militants et responsables avec ceux-ci.
[1] Tudi Kernalegenn, Francois Prigent, Gilles Richard et Jacqueline Sainclivier, Le PSU vu d’en bas. Réseaux sociaux, mouvement politique, laboratoire d’idées (années 1950-années 1980) et Yannick Drouet, « Le PSU (1974-1988) : une longue agonie ? », dans Le Parti socialiste unifié. Histoire et postérité, sous la dir. de Noëlline Castagnez, Laurent Jalabert, Jean-François Sirinelli, Marc Lazar et Gilles Morin.
[2] Voir à ce sujet les travaux de Bernard Pudal pour le PCF (Parti communiste français), de Frédéric Sawicki pour le PS (Parti socialiste), de Jean-Paul Salles sur la LCR (Ligue communiste révolutionnaire) ou de Ludivine Bantigny sur Mai-juin 68 et bien d‘autres encore.