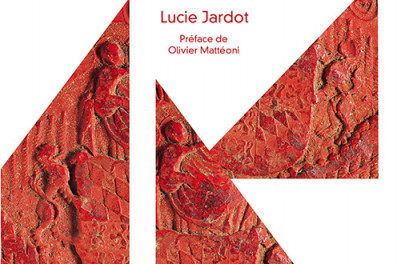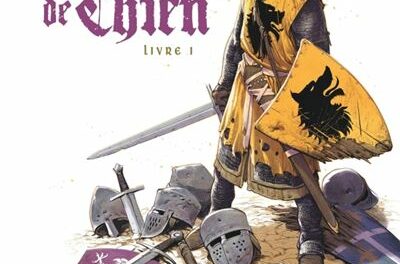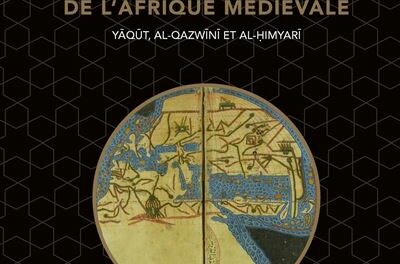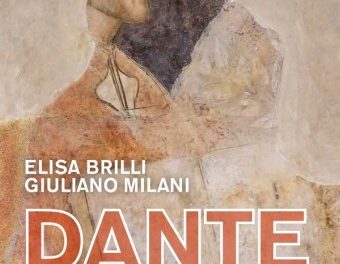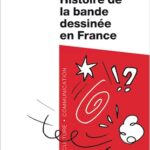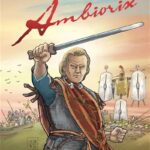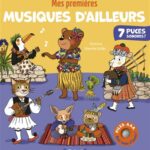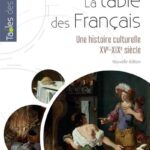Pour les habitués de la Cliothèque qui ont découvert l’histoire médiévale en regardant en famille la série télévisée « les rois maudits » qui date de 1972 , cette découverte du procès de l’évêque Guichard lors de l’été 1308 en pleine affaire des Templiers, devrait rappeler d’excellents souvenirs. Présenté comme un grand souverain, sans doute le plus « moderne » des rois du XIVe siècle, Philippe le Bel a érigé la raison d’État et peut-être même le crime d’État au rang des beaux-arts. On sait bien aujourd’hui que la politique royale à l’encontre de ceux qui disposaient d’un quelconque pouvoir, essentiellement financier, visait à s’approprier ces richesses pour le compte d’un État en cours de constitution.
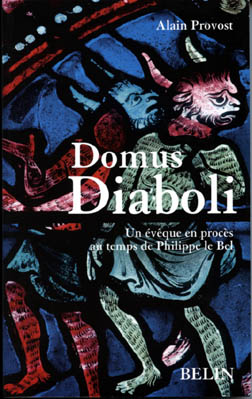
Dans le cas du procès Guichard, les motivations sont sensiblement différentes. Condamné en 1304 pour malversations financières, l’évêque Guichard de Troyes n’est ni très pieux ni très honnête; et il est accusé des pires infamies. A l’automne 1308, en plein procès des Templiers, Philippe le Bel affirme sa souveraineté face au Saint Siège. le prélat va être victime à la fois d’une machination et de la raison d’État.
L’évêque Guichard est l’objet de plusieurs chefs d’accusation, partis de l’entourage de la reine Jeanne de Navarre, épouse du Philippe le Bel, morte en 1305, à 33 ans.
Après la mort de Philippe le Bel, en 1314, c’est son fils, Louis X le Hutin, qui poursuit le prélat de sa vindicte. Mais en réalité, cette affaire Guichard s’inscrit dans un conflit indirect entre le royaume de France et la Papauté, les uns et les autres ayant des intérêts communs, notamment l’élimination des Templiers, mais en même temps des divergences quant à la place de l’Église dans le royaume de France.
Un évêque qui n’est pas très catholique…
Incontestablement, l’évêque Guichard n’était pas un modèle de probité ni d’élévation morale. Il n’était pas fondamentalement différent de beaucoup de ses collègues. Des poursuites avaient déjà été engagées contre lui à propos de malversations financières. Mais il s’agissait là de poursuites qui relevaient, au moins dans un premier temps, des tribunaux ecclésiastiques.
Le procès intenté directement par le bras séculier est d’une tout autre nature. Il s’agit à la fois d’une accusation de meurtre et en même temps d’un procès en sorcellerie. À ce propos, les agents du roi, et notamment le chancelier Guillaume de Nogaret, n’y vont pas vraiment de main morte. Plusieurs dépositions, parfaitement fabriquées présentent l’évêque comme un redoutable sorcier et surtout comme un criminel. Ce que l’auteur de ce Domus diaboli retrace, c’est bien le cheminement d’un procès politique dans lequel on fait véritablement feu de tout bois. Les Guichard entretient plusieurs concubines, trafique les privilèges ecclésiastiques, se livra toutes sortes de crimes abominables, à l’encontre des époux de ses maîtresses, soit qu’il les ait perpétrés lui-même, ou qu’il ait fait appel à ses hommes de main. Les différents témoignages prennent en compte tous les aspects de la vie de l’évêque Guichard, et notamment la façon particulièrement brutale qu’il avait de rendre la justice en tant que seigneur. On lui reproche même de laisser mourir les condamnés à des peines légères dans ces prisons. En réalité, bien des faits avaient déjà été jugés, notamment pendant la période 1300 – 1305, mais en 1308, en déclenchant une nouvelle grande enquête, malgré les désirs clairement exprimés du pape Clément V, qui considérait que ces affaires relevaient de sa compétence, ou en tout cas des tribunaux ecclésiastiques, Philippe le Bel entendait marquer son territoire fasse à la papauté.
La trilogie hérésie-sodomie-pratiques démoniaques
L’auteur ne se limite pas à évoquer les questions de grande politique, dans les rapports de force entre l’église et l’État. C’est bien la fabrication d’un procès politique, mais qui utilise clairement les ressorts du surnaturel, qui fait l’intérêt de cet ouvrage. Dans les actes d’accusation, les crimes s’accumulent, du blasphème à l’hérésie, de la simonie à l’entretien de concubines, de détournement de fonds à l’abus de pouvoir, c’est bien cette sédimentation des crimes et Alain Provost cherche à décoder. Bien entendu, ce qui relève de la sorcellerie pure et simple est l’objet d’un traitement particulier. Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, ces questions qui relèveraient a priori du religieux, sont traitées spécifiquement par le pouvoir séculier. De la même façon, Guillaume de Nogaret met en œuvre la trilogie, utilisés contre les Templiers, hérésie, sodomie et pratiques démoniaques. Pour faire bonne mesure, on fait même appel à ce que l’on appellerait aujourd’hui « les effets spéciaux » pour montrer à quel point la l’ancien prieur devenu évêque entretenait un commerce particulier avec le diable.
Le cas de l’évêque de Troyes constitue un enjeu pour le pouvoir royal. Pour autant, il semblerait d’après Alain Provost, que les commissaires ecclésiastiques qui ont été les premiers enquêteurs dans cette affaire, et pu disposait d’une certaine marge de manœuvre. En réalité, l’intervention du pouvoir politique est venue apporter une couche sédimentaire supplémentaire à une accumulation de témoignages qui avaient été dans un premier temps recueillis au sein de l’église en Champagne. Philippe le Bel n’en est d’ailleurs pas, pour ce qui concerne l’instrumentalisation de la justice, à son coup d’essai. Pendant son règne ont lieu quatre grand procès, celui contre Boniface VIII, celui contre Robert d’Artois, le procès contre les Templiers et enfin celui contre Guichard de Troyes.
Innocent ou coupable ?
Alain Provost en conclusion, se livre à un examen des deux possibilités qui nous importent, au bout du compte, celle de savoir si l’évêque Guichard est innocent, où bel et bien coupable ?
Le premier scénario, que les chroniques tendent à accréditer, serait celui de la manipulation intégrale. Difficile à envisager. L’hypothèse du complot ne semble pas plus recueillir l’assentiment de l’auteur. Cela supposerait que l’on est voulu faire porter le chapeau à Guichard d’une mort suspecte d’une reine de France.
En réalité, il semblerait que le pouvoir politique ait saisi l’opportunité de renforcer son autorité sur une province riche et l’évêque de Troyes apparaissait à ce titre comme un gêneur. Dans cette affaire qui, et ce n’est pas innocent, ne débouche sur aucun jugement, Philippe le Bel a obtenu ce qu’il recherchait, la docilité du pape Clément, et la reprise en main d’une province importante dans le dispositif de consolidation du pouvoir royal sur l’ensemble du territoire. Enfin il convient de ne pas négliger la composante financière de cette affaire. Puisque bien après sa mort en 1317, les héritiers de l’évêque Guichard se voyaient réclamer, pour le compte de la couronne, les sommes tout à fait considérables correspondant aux frais de procédure.
Une fois les dernières pages de ce livre refermées, on ne peut s’empêcher de penser à ces procès de Moscou, et à ses accusations de sabotage dans lesquelles les accusés se voyaient reprocher par le procureur Vichinski d’avoir été capables de mettre des clous à l’intérieur des œufs sans en briser la coquille. Une telle performance relevait, à n’en pas douter, de la sorcellerie.