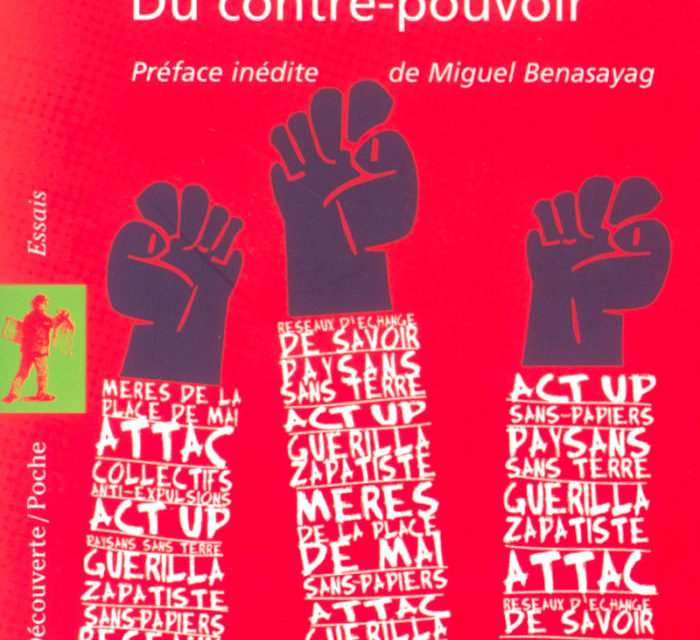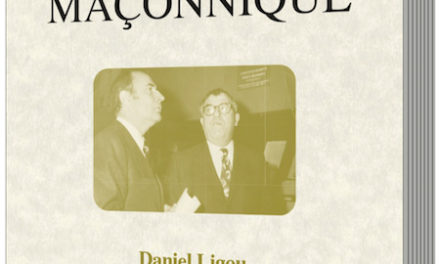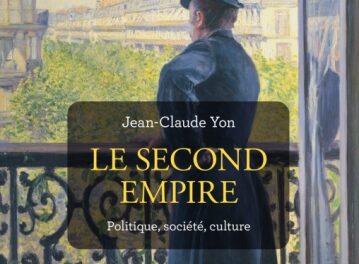Miguel Benasayag a été récemment invité à une émission nocturne sur une chaîne française. Cela a permis aussi de remettre l’auteur dans sa biographie, puisque Benasayag a été l’un des militants révolutionnaires argentins emprisonnés réclamés par le gouvernement français (de droite) aux autorités argentines à la fin des années 70, au bénéfice d’une double origine franco-argentine. En visionnant les images d’archives de son arrivée en France, il raconte dans cette émission et avec une certaine ironie cette tractation étrange qui avait pour but d’effacer la mauvaise impression laissée par l’assassinat de deux religieuses françaises, une étrange libération, en vérité, dans laquelle il était sommé par les officiels français de rester « muet », les mêmes qui le sauvaient d’une mort possible ou probable.
Cette arrière-plan, l’engagement fort des deux auteurs est une des clefs du livre. Ils le revendiquent avec la figure du « militant-chercheur » (page 15), qui n’est pas sans rappeler les textes politiques de Bourdieu, notamment son dernier sur l’Europe et le mouvement social européen [Contre la politique de dépolitisation : les objectifs du mouvement social européen].
Le point de départ de la réflexion, c’est la fin du désenchantement, cette illusion post-moderne qu’il n’y a plus rien à faire, et le retour en force du politique, que les auteurs fixent symboliquement au 1er janvier 1994 avec l’insurrection zapatiste au Chiapas. Le retour ou la formation d’une nouvelle sensibilité révolutionnaire qu’ils nomment la « nouvelle radicalité » (titre également d’un ouvrage co-écrit par Benasayag en 1997). Ils reviennent sur la fin des idéologies, des utopies des générations précédentes. Pour sortir de cette débandade intellectuelle -tristesse et impuissance d’aujourd’hui- il faut abandonner le mythe et la prédication, sans jeter le passé aux orties. C’est donc d’une « lutte sans modèle » qu’il s’agit (sans un « modèle ordonnateur depuis le futur ») et d’une rupture avec la conception linéaire et eschatologique du temps historique. « Se révolter ne signifie donc pas « penser différemment » (…) mais mettre en œuvre des pratiques concrètes de libération, des formes de vie différentes » (page 26).
Vient ensuite un travail sur l’articulation entre politique et gestion (« une tension paradoxale à préserver »). Aucune forme de gestion ne peut être la matérialisation de la politique, une analogie est proposé pour identifier deux activités différentes, celle de l’artiste et du directeur de musée. Bon, à ce stade de mon compte-rendu, vous vous doutez bien que je ne vais pas résumer le livre, je serai d’ailleurs bien à la peine et contrit de vous priver d’une lecture neuve, il s’agit là d’une évocation d’un contenu, à vous de lire.
La politique est un « caractère des situations » disent encore les auteurs, et non un objet spécifique dans un coin de la société. Elle est une « adhésion pratique à la recherche de la liberté », « ce que nous appelons le passage de la puissance au contre-pouvoir » (page 44) A la lumière des expériences latino-américaines et de références gramsciennes, il est ensuite débattu de la distinction entre social et politique (société politique et société civile). « L’appareil d’Etat n’est donc pas l’objectif, le fameux palais d’hiver qu’il faut conquérir pour que l’histoire prenne une autre direction. Même si, dans certaines conjonctures historiques, la chose politique, autrement dit la question du contre-pouvoir peut se nouer autour de la question de l’Etat, comme c’est le cas dans des luttes anticolonialistes, ou à la sortie d’une période de dictature où L’Etat, y compris comme situation de gestion, a disparu en tant que tel ». (page 52). »Ceux qui prennent le pouvoir ont ainsi comme première et paradoxale mission de constater « qu’ils ne peuvent pas ». Critique de l’impossible représentation de groupes rarement représentables, de l’impuissance des gestionnaires. Mais la représentation ne doit pas être rejetée, seulement ramenée à un des nombreux éléments de la multidimensionnalité de la vie, éviter qu’elle ne prenne trop de place. Tentative de résoudre ce problème des représentants, des avant-gardes : distinguer puissance et pouvoir, cas illustré par la Révolution Française.
A partir de citations de Foucault notamment, il est montré que le pouvoir ne se possède pas mais s’exerce partout sur les réseaux de relations (famille, relations sexuelles, voisinage, logement, travail,…). Donc vanité que de vouloir prendre le pouvoir, au contraire retrouver la puissance dans chaque connexion du réseau et simplement excentrer la question du pouvoir sans l’ignorer. Sur la topologisation du pouvoir, reprise de l’opposition territoriale entre « forteresses » fondées sur l’idéologie de l’insécurité et « no man’s land » où rien ne compte vraiment, opposition qui se joue à différentes échelles. La question de l’insécurité permet alors de transformer la question sociale en question technique : interventions militaires, policières, etc. (page 71).Bien sûr, la question du militantisme est longuement débattu, ses impasses, la militance extrasituationnelle, ses ambiguïtés, le militantisme humanitaire (le bon, le juste, mais qui a renoncé à changer l’état du monde). Retour incisif sur les vieux-anciens militants qui ont changé d’opinion. Pour les auteurs, nécessaire abandon de l’ancienne figure du militant, cet être extrasituationnel qui comprend mieux les situations que ceux qui y sont engagés (la position du mirador). Chaque situation comporte ses formes propres d’engagement, mais sur un fondement commun, un universel qui ne s’exprime que dans les situations concrètes. Cette militance situationnelle ne connaît pas de terre promise, elle n’est qu’un processus. » Toute arrivée est illusoire, et n’est, dans le meilleur des cas qu’un nouveau point de départ » (page 85). D’où aussi des temps pluriels, le temps des situations multiples (contre le temps unique du travail et du profit), l’acceptation de l’incomplétude (face à l’idéologie du complexe, qui nous dit que tout est devenu trop complexe pour qu’on y touche), des contradictions, de l’inachevé, du non exhaustif. Il faut mettre entre parenthèses la complexité pour agir à un moment donné, sinon c’est l’indécidable et le renoncement. A cette impossible complétude, les auteurs opposent le concept de consistance.
L’idéologie de l’individu, mise en évidence par d’autres auteurs comme Dominique Méda (« qu’est-ce que la richesse ? ») ou des écoles sociologiques, est retravaillée ici. Distinction entre individu et personne, mais là encore, l’individu, la particule élémentaire, ignorante et égoïste des économistes, empreinte et véhicule du capitalisme, n’est pas rejeté. Il est rejeté à la marge, il doit exister, plus humblement, dans une tension avec la personne, c’est-à-dire, l’être social, lié aux autres de mille façons, un « pli » dans l’épaisseur du réel. « La personne est sa situation ». (page 105). Notre vie n’est pas individuelle. Tout ce passage se réfère au communisme philosophique (évidemment sans rapport avec les organisations communistes existantes) et à plusieurs textes de Marx et Engels. Même discussion sur savoir et pouvoir, de l’ignorance produite par la déliaison, la sérialisation, l’hyper-spécialisation (le fétichisme technologique comme variante du fétichisme mercantile), de l’assujettissement des savoirs, induits par le pouvoir, la commande institutionnelle. Long passage sur l’utilisation de l’Université, de l’extension du champs des savoirs qui y sont produits : « le savoir doit être présenté comme une activité et non comme une représentation possible » (Pierre Macherey). Le corps bien sûr et pas seulement l’esprit sont source de savoirs (je n’ai pas encore dit que Benasayag est psychanalyste), refus de la dichotomie absolutiste entre théorie et pratique. Retour sur la figure du militant-chercheur, du philosophe de la praxis (pages 121-122).
Alors militer « malgré tout » (c’est le nom du collectif auquel Benasayag participe).
« Parrainage » de deux figures du marxismes, Antonio Gramsci et José Carlos Mariategui, un « militant-chercheur » péruvien des années vingt. Mariategui refuse l’orthodoxie marxiste de l’époque et réinterprète la tradition péruvienne, instrumentalisée au profit des puissants, en « exhumant des parcours cachés et les récits oubliés » (page 133).
A propos du passé, « Mariategui montre bien qu’il n’en existe pas d’image spontanée, pas plus qu’il n’y a d’innocence dans la façon d’envisager une recréation historique : le passé est toujours une lecture à partir du présent. » (page 135)
Le chapitre 10 est intitulé « le contre-pouvoir ». De celui, je parlerai surtout du passage sur la violence. Consensus aujourd’hui sur le refus de la violence en politique, et pourtant que de vraies violences produites par le capitalisme (longue liste à disposition page 138). « On ne peut donc souscrire aux énoncés pacifistes, qui, plus que pacifistes, sont en réalité conformistes voire « collaborationnistes ». » Dans la plupart des cas, la seule chose que nous puissions faire face à la violence, lorsque elle se déchaîne », c’est de définir de quel côté nous nous situons ». (page 139). Pour les auteurs, la violence ne peut être exclue a priori des situations de par le monde. De fait, le texte se termine par un retour sur la figure et les idées de Guevara (Benasayag étant lui même un ancien membre du PRT argentin), dont il est un peu difficile au terme du livre d’accepter la venue. Sans vouloir jeter Guevara avec l’eau du bain, l’impression (avec des lectures comme la bio du Che par le romancier mexicain Paco Taibo II) est que le Che est tiré vers les thèse des auteurs.
Vient ensuite le « manifeste du réseau de résistance alternatif », en français (avec des références -Deleuze – qui ne sont pas dans le texte espagnol et qui ôtent un peu de son caractère universel au texte français) qui est une lecture incontournable, tant il est à la fois questionnant et réjouissant.
Cette lecture entendue par les auteurs comme une invitation, un « tous ensemble ! » autant qu’un « tous philosophes ! »
Le manifeste est accessible en plusieurs langues à l’adresse www.sinectis.com.ar/u/redresistalt E-mail : redresistalt@sinectis.com.ar Boîte postale : C.C. 145, 1422 suc. 22 (B), Ciudad Autònoma de Buenos Aires, Argentine.
Un extrait en espagnol (pour la beauté des langues).
2. Resistir a la tristeza
Vivimos una época profundamente marcada por la tristeza. No sólo la tristeza de los llantos sino, y sobre todo, la tristeza de la impotencia. Los hombres y las mujeres de nuestro tiempo viven en la certeza de que la complejidad de la vida es tal que lo único que podemos hacer, so pena de aumentarla, es someternos a la disciplina del economicismo, el interés y el egoísmo. La tristeza social e individual nos corroe y nos convence de que no tenemos más los medios de vivir una verdadera vida y así nos sometemos al orden y a la disciplina de la sobrevida. El tirano necesita la tristeza porque así, cada uno de nosotros se aísla en su pequeño mundo, virtual e inquietante, pero a la vez los hombres tristes necesitan del tirano para justificar su tristeza. Nosotros creemos que el primer paso contra la tristeza (la forma en que existe en nuestras vidas el capitalismo) es la creación de lazos solidarios y concretos. Romper el asilamiento, crear solidaridades es el principio de un compromiso, de una militancia que no funciona más « contra » sino « por » la vida, la alegría, a través de la liberación de la potencia.
Un beau texte à lire, critiquer, reformuler. Un manifeste à faire circuler. Une question à travailler, celle de la violence (le récent témoignage d’objecteurs de conscience israéliens en est une illustration éclairante ou la situation au pays basque), de ce que n’est pas la non-violence (un gentillisme bêlant) et je trouve dommage que l’histoire indienne et la non-violence de Gandhi (plutôt performatrice et situationnelle) n’est pas été appelée par les auteurs.
J’ajouterai que la couverture du livre, un peu simpliste, ne me paraît pas vraiment en accord avec l’esprit et la pensée des auteurs, je vous laisse regarder cela par vous-même.
J’espère n’avoir dégoûté personne de lire « Du contre-pouvoir », avec cet impossible compte-rendu, que les auteurs me pardonneront au titre de l’incomplétude et du temps capitaliste. Bonne lecture.