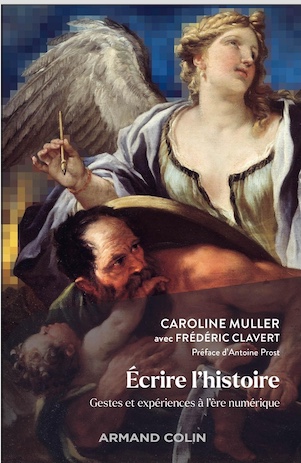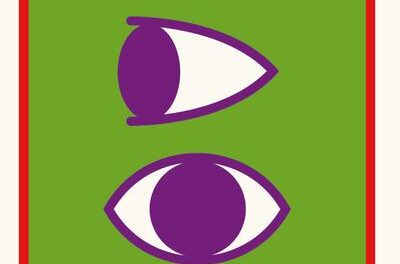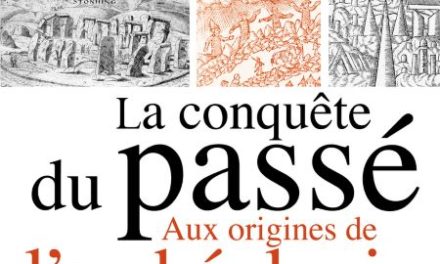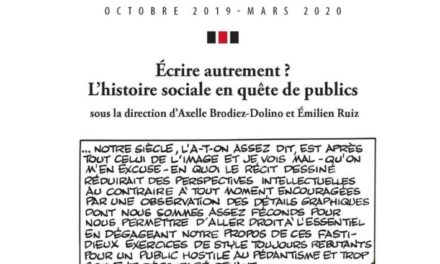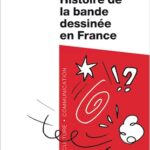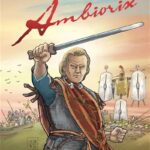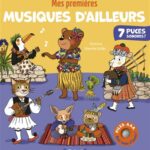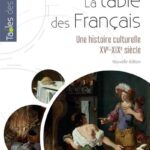Ce livre est une réflexion sur le métier d’historien aujourd’hui. Il est le résultat de huit ans d’observation et de discussion avec des historiens. Il s’agit donc de comprendre les manières d’écrire l’histoire à l’ère numérique.
Papiers et poussières : des expériences savantes au XXIe siècle
Ce premier chapitre explore la place des archives dans les récits de l’histoire. Nous sommes à un moment paradoxal car les historiens manipulent de moins en moins de papier et de l’autre côté le renouveau éditorial prend souvent appui sur la mise en avant d’un « goût de l’archive ». La dématérialisation du rapport de l’historien à l’archive oblige à reposer la question de la place de l’émotion dans l’enquête historique.
Les archives chez soi : l’ère de la photographie
L’expérience des « archives chez soi » s’est banalisée, démocratisant l’accès aux documents. L’ordinateur personnel devient une salle de lecture portative.
D’étranges territoires de l’histoire : les moteurs de recherche et interfaces de découverte
Les moteurs de recherche peuvent guider mais aussi influencer la quête de connaissances tout en posant des problèmes d’interprétation. Des sites spécialisés comme celui de la BNF ne fonctionnent pourtant pas selon la même logique. L’historien doit apprendre à bien formuler sa requête au risque de passer à côté d’informations. L’apparente facilité des moteurs de recherche est un piège car ils sont pensés pour des consommateurs et non pour des historiens.
Qu’est-ce qu’une salle de lecture à l’âge numérique ?
Les lieux numériques de consultation d’archives se multiplient. La possibilité de constituer de façon autonome des contenus en ligne ouvre la voie à des formes de rééquilibrage documentaire : des groupes « minoritaires » peuvent construire leurs fonds et les rendre visibles. Il est donc essentiel de se demander qui produit le document, le met en ligne ou le valorise. Les auteurs évoquent les cahiers citoyens des Gilets jaunes qui ont été démembrés, découpés pour cause de numérisation. Cette opération qui a pour but de les protéger et de les mettre à disposition leur fait perdre en même temps une partie de leur réalité. Ils soulignent aussi le « syndrome du lampadaire » c’est-à-dire la tendance à se concentrer sur les zones déjà éclairées.
Faut-il (ré)apprendre à lire les sources ?
L’ère numérique a démultiplié la production de traces des activités humaines. Parmi les initiatives en cours, il y a la numérisation de 300 000 actes de mariage de la III ème République. En effet, ce type de document peut fournir jusqu’à 118 informations différentes. Une équipe développe un chatbot permettant d’échanger en langage naturel avec le corpus. En même temps il faut se méfier d’un travers qui consisterait à penser qu’on peut avoir une compréhension fine des phénomènes en raison même de l’abondance de documents traités.
Outils et expériences d’écriture
La plateforme Hypothèses a connu une très forte croissance en dix ans. Elle accueille désormais des milliers de carnets en plusieurs langues. Cependant, il faut tenir compte du fait que l’article scientifique et le livre publié restent les deux piliers de l’évaluation de l’activité d’un chercheur.
L’histoire en sa toile
L’adoption de l’e-mail, des listes de diffusion, des médias sociaux ou des sites Web a fait évoluer les moeurs professionnelles. De nouveaux rites se sont mis en place et peuvent occuper une place importante. L’historien doit aujourd’hui s’inscrire dans la logique de projets soutenus par l’Agence nationale de la Recherche. On lui demande aussi de médiatiser ses recherches ce qui est un autre métier. En France, l’histoire a une longue tradition de vulgarisation mais l’historien doit trouver la bonne distance entre une hyper présence médiatique et une invisibilité liée à des moments de recherche.
Pratiques de l’histoire et politiques de la recherche à l’ère numérique
Parmi les exemples développés par les auteurs, on peut citer celui porté par Claire Zalc. Lubart World associe micro histoire et approches quantitatives pour construire « une histoire transnationale des trajectoires des Juifs de Lubartow des années 1920 aux années 1950. » Il ne faut pas oublier la temporalité des recherches car les financements sont donnés pour plusieurs années mais rien n’est prévu pour entretenir dans la durée les productions numériques.
Enseigner l’histoire à l’ère numérique
Les auteurs formulent des propositions pour un enseignement de culture numérique pour l’histoire. Cela implique de se familiariser avec la nature d’une information scientifique et la forme qu’elle prend en ligne, puis de comprendre la transformation des sources historiques à l’âge numérique et enfin savoir en mener la critique.
En conclusion les auteurs reviennent sur l’atelier actuel de l’historien fait en partie d’outils numériques ou de logiciels spécialisés, par exemple dans la gestion d’archives. Ils terminent ainsi : « nous voulons faire de l’histoire à l’ère numérique : sans être ni programmeur, ni ingénieur, ni prophète, mais en nous donnant les moyens d’étayer collectivement les piliers de notre discipline ».