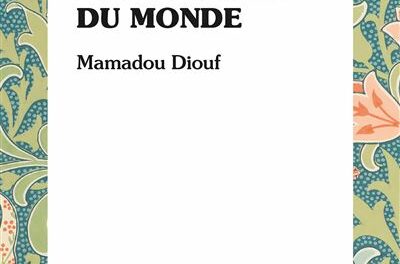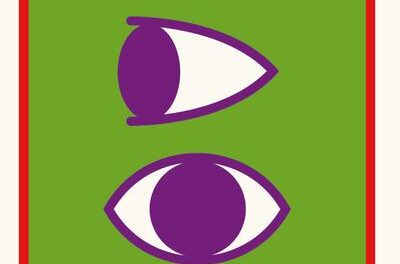On n’a jamais autant fait et parlé d’histoire qu’aujourd’hui, selon Guillaume Mazeau. Mais ce regain d’audience, cette démultiplication tant des formes que des auteurs de l’histoire tendent à brouiller quelque peu l’idée que l’on pourrait s’en faire. C’est pourquoi, ce débordement d’histoire nous impose alors de la repenser selon l’auteur, historien spécialiste de la Révolution et du XIXe siècle français à Paris I et à l’IHTP et membre du CVUH.[1]
Cet effort de définition est d’’autant plus urgent et salutaire que certains tentent de manipuler et d’utiliser l’histoire à leurs propres fins.
Le besoin d’histoire et la sacralisation du passé, symptômes d’une crise de la temporalité
L’histoire n’appartient plus aux historiens, elle est désormais partout et déborde du cadre institutionnel de l’université et des instituts savants reconnus.
En effet, l’industrie des loisirs et du divertissement s’en est allègrement emparée.
Ainsi, l’histoire n’est plus une pratique sociale exclusive réservée aux savants comme elle a pu l’être jusqu’au XIXème siècle, elle est désormais partagée et l’histoire scientifique n’en est qu’un aspect parmi d’autres.
Des spectacles historiques comme celui du Puy du Fou aux émissions télévisées telles Secrets d’histoire jusqu’aux séries et chaînes Youtube, l’histoire a gagné en public mais surtout en « faiseurs », amateurs et « historiens du dimanche »[2].
Cette démocratisation inédite de l’histoire est récente, et favorisée par la généralisation de la scolarisation au XXème siècle, elle est aujourd’hui encouragée par la numérisation des sources. Cette évolution a modifié de fait le statut social de l’histoire en en faisant un « passe-temps » comme un autre[3].
Mais pourquoi cet engouement ? Selon Guillaume Mazeau, si l’histoire connaît de nos jours un tel succès, c’est qu’elle possède une fonction sociale importante et répond à des besoins impérieux. L’auteur en relève d’eux, celui de divertir et celui de rassurer.
Mais c’est le besoin de rassurer qui intéresse avant tout l’auteur car il témoigne d’une crise de notre conscience historique[4] et de notre perception de la temporalité au travers du phénomène d’accélération du rythme de nos vies imposé par le capitalisme comme l’a bien analysé le sociologue et philosophe Hartmut Rosa[5]. Ce mouvement n’est pas récent et prend forme après la Seconde Guerre mondiale par défiance envers le progrès et le futur. Dans ce contexte, aggravé par l’incertitude de la crise environnementale, le passé devient alors un refuge, celui d’un « temps stable et rassurant car immobile[6] ». Cet attrait pour le passé ne cesse d’étendre son emprise et confine à la sacralisation comme en témoigne l’élargissement de la notion de patrimoine ou la frénésie de l’archivage[7]. Mais ce passé muséifié et immobile n’est pas de l’histoire selon l’auteur.
Dans cette volonté de retenir cette « fuite du temps », Guillaume Mazeau y voit le symptôme d’une crise de la temporalité qui se traduit par la peur de l’effondrement dont témoignent le succès pour la collapsologie ou le survivalisme.
Mais l’histoire pourrait peut-être, selon l’auteur nous guérir de cette « morbidité collective[8] ».
L’histoire comme outil d’un consensus néolibéral et conservateur
Cette crise des temporalités se traduit d’un côté par un temps continu et universel dicté par l’économie et de l’autre une fragmentation des temps collectifs[9]. En effet, depuis les années 1970, le retour du libéralisme et le tournant conservateur ont fait du capitalisme le visage du progrès et la révolution ou la colère sociale celui de l’archaïsme. Ce mouvement se voyait alors confirmé par la fin de l’expérience soviétique sonnant ainsi la « fin de l’histoire[10] », c’est-à-dire la fin du cycle de démocratisation sociale débuté au XVIIIe siècle. Cette révolution conservatrice en retournant les idées des Lumières, fit de l’égalité une idée rétrograde et, associée au phénomène du présentisme inventé par l’historien François Hartog, contribua à créer une désorientation générale et une incapacité à penser un autre avenir.
De plus, cette révolution conservatrice s’attache tout particulièrement à discréditer tout mouvement contestataire en stigmatisant sa violence et son absence de projet comme certains experts conservateurs l’on dénoncé chez les Gilets Jaunes par exemple.
La conséquence de ce mouvement néolibéral, selon l’auteur, est une crise des temporalités qui confinent les peuples à une aliénation temporelle, celle du temps économique, qui tout en éclatant le temps collectif et individuel (flexibilité, précarité), les empêchent ainsi de penser l’avenir et un autre avenir que celui dicté par le capitalisme.
Ce présentisme imposé par l’économie dans lequel les peuples sont enfermés profite alors aux dirigeants pour s’assurer l’obéissance des peuples souvent infantilisés. Dans cette perspective se rejoignent régimes libéraux et autoritaires pour faire de l’histoire cet outil de consensus et une machine à créer de l’ordre social. Mémoire, patrimoine et identité deviennent alors les trois piliers, selon Laurence de Cock cité par l’auteur, sur lesquels se fonde l’enseignement afin de créer ce « vivre ensemble » et ses « valeurs républicaines »[11]. Aux côtés de l’école, ce sont de véritables politiques de la mémoire qui ont été mises en place afin de créer ce consensus, synonyme d’ordre social. Mais le revers de ce « devoir de mémoire » et de ces usages politiques du passé est d’avoir généré en retour de puissants mouvements identitaires faisant de l’histoire un instrument politique au service de l’essor des nationalismes.
L’histoire récupérée et falsifiée par les extrêmes
L’utilisation de l’histoire par le néolibéralisme crée, par une réaction à une histoire officielle, fabriquée selon ses détracteurs, un renversement et une forte tendance au relativisme et négationnisme dont profitent en premier lieu les régimes autoritaires et les extrêmes politiques. C’est ainsi le cas en Europe avec l’entrée en 2017 au Bundestag de l’AFP (Alternative pour l’Allemagne) faisant son miel de l’exaltation du passé nazi[12], ou en Italie avec la Ligue du Nord de Mattéo Salvini multipliant les références à Mussolini ou encore en Espagne avec la percée du parti franquiste Vox en 2019[13]. A l’Est, le négationnisme prolifère en Autriche, Pologne, Hongrie, Ukraine, Lituanie où le rappel à la collaboration nazie est réprimé et où le marché du souvenir nazi est florissant. Ailleurs dans le monde, d’Ankara à Moscou comme de Brasilia à Tokyo et Pékin, les historiens sont mis au pas et le passé est relativisé, manipulé afin d’oublier les crimes des empires passés et de valoriser ces expériences autoritaires : du génocide arménien aux crimes soviétiques en passant par les violences coloniales japonaises en Corée, ceux de la place Tiananmen[14]… Même les vieilles démocraties ne sont pas épargnées, le Brexit a réveillé en Angleterre un imaginaire impérial alors qu’en France, le devoir de mémoire ou l’insécurité ont utilisé l’histoire au service d’une identité nationale teintée d’autoritarisme et de repli sur soi[15].
Dans ce contexte, l’histoire et les historiens, à travers l’école et les chercheurs, sont ouvertement attaqués dans l’espace public par des polémistes dénonçant pêle-mêle, de nourrir le communautarisme et la repentance, de détruire l’identité nationale et, in fine, de faire le lit de l’islamisme radical… En tête, Zemmour et Onfray, qui a depuis longtemps quitté le terrain de la philosophie, ne cessent de dénoncer une vulgate de fonctionnaires coupés du « vrai peuple »[16] et responsables du déclin culturel, en un mot des « ennemis de l’intérieur »[17]…
Cette histoire, attaquée et discréditée, doit réagir et retrouver sa place selon Guillaume Mazeau.
Reprendre possession du temps et de l’histoire
Mais l’auteur voit de l’espoir dans la capacité des peuples à résister aux manipulations de l’histoire par les dirigeants et à exercer leur esprit critique. En effet, Guillaume Mazeau a repéré différentes formes d’appropriation populaire de l’histoire témoignant d’un goût pour l’histoire et d’une volonté de transmettre, bien loin le plus souvent de cette histoire savante. Ainsi, les reconstitutions grandeur nature (Origines du Puy du Fou, le festival « Les Historiques »), les collections privées d’objets du quotidien, certains jeux vidéos, youtubeurs, forums de discussion sur les grands moments de l’histoire, Wikipédia contredisent et nuancent l’idée d’une apathie et d’une ignorance populaire pour la connaissance en général.
De même, l’histoire est utilisée par les peuples comme un « combustible politique[18] » lors des mouvements révolutionnaires tels les Printemps arabes de 2010 qui constituent selon l’auteur des moments d’ « hyperconscience historique[19] ». Durant ces moments, les peuples, afin de légitimer leurs actions, se cherchent des références dans le passé et tressent alors des généalogies collectives comme les Tunisiens faisant appel aux Carthaginois en 2010 ou les Français aux Gaulois au XVIIIe siècle[20]. Au cœur de l’évènement se bricole alors une réécriture de l’histoire qui sert la communauté politique naissante et, même si cette histoire semble peu rationnelle voire fausse, elle nous dit aussi quelque chose du « temps historique[21] », de ses pulsions, discontinuités…
Et « reprendre l’histoire, le passé c’est aussi reprendre possession du temps pour reprendre la souveraineté[22] ». Cette reprise du temps passe aussi par l’occupation d’espaces et de « non-lieux », pour les transformer en « lieux communs[23] » (de la Place Tahrir aux ronds-points des Gilets Jaunes) et ainsi de forcer le temps, celui de l’économie, à s’arrêter. Cette double réappropriation, du temps et de l’espace, conduit à une double prise de conscience de la part des peuples, selon l’auteur, conscience politique et historique, consubstantielles à l’action. Ce mouvement se retrouve également en Amérique Centrale et du Sud où les peuples brandissent aussi leur passé pour faire face à la dépossession de leur espace dont ils sont victimes : Mapuches du Chili, indiens du Chiapas au Mexique.
Ainsi, l’auteur de résumer que l’histoire est un bien commun qui ne se décrète pas et qui n’appartient à personne, ni aux savants, ni aux dirigeants, mais au peuple. Il faut donc le défendre car il est menacé.
L’histoire comme émancipation du peuple, l’histoire comme exigence intellectuelle
Et pourquoi l’histoire est-elle menacée par les néoconservateurs ? Car l’histoire dit le changement, elle démêle les discontinuités, tout ce qu’ils honnissent. L’histoire est une arme contre ceux qui veulent que rien ne change comme le climat ou les identités par exemple.
Comment faire face à ces menaces ? Sûrement pas en assénant une histoire défensive et descendante aussitôt ressentie comme une « vulgate » ou une « histoire officielle[24] » faisant alors le lit, en réaction, aux légendes et récits conspirationnistes.
Selon Guillaume Mazeau, il ne sert à rien de surcharger l’histoire de responsabilités morales et civiques auxquelles elle ne peut répondre mais au contraire, de donner les outils aux peuples pour faire vivre la démocratie comme un espace critique.
Car qu’est-ce qui définit le mieux l’histoire si ce n’est sa méthode ? Ce ne sont ni les titres et diplômes ni l’appartenance à un corps de métier qui définissent l’histoire, mais la méthode de travail reposant depuis au moins Lorenzo Valla, sur la critique des sources, l’apport de preuves et la recherche de la vérité.
L’histoire étant une science profondément sociale, elle doit rester au contact du monde social, ne pas rester confinée dans les bibliothèques ou salles d’archives et Mazeau de citer Bloch : « L’historien est comme l’ogre de la légende. Là où il flaire de la chaire humaine, il sait que là est son gibier[25] ».
Mais si l’histoire savante et l’historien professionnel doivent sortir, ce n’est pas à n’importe quel prix, ce n’est pas pour se mettre au service des discours identitaires et des minorités opprimées même si leurs revendications peuvent permettre une certaine remise en question de récits trop eurocentrés. Si l’histoire doit sortir, c’est armée d’une méthode et d’un nouvel état d’esprit d’ouverture vis-à-vis de l’histoire populaire qu’elle a longtemps mis à distance par l’invention d’un nouveau lexique : « mémoire collective », « représentation », « usages du passé », « demande sociale »[26]…
Si l’histoire doit sortir, c’est enfin pour s’engager dans la vie de la cité.
Assumer la fonction sociale de l’histoire
Il est vrai qu’on ne voit plus guère d’historien dans la cité, ou très peu. C’est ce que déplore, à demi-mots, Guillaume Mazeau qui en appelle à une histoire plus publique et davantage politique.
En effet, sous prétexte d’objectivité et de neutralité, l’historien s’est replié au fil du XXe siècle sur son petit laboratoire, loin et au-dessus du monde…
Par méfiance ou mépris, les historiens se sont coupés de l’histoire populaire et in fine, de leur matière vivante, le monde social, au risque de fabriquer un « savoir hors-sol » incapable de renouveler les questions qu’il devrait poser au passé[27], renforçant alors, en retour, la défiance envers les intellectuels.
Mais, rappelle justement l’auteur, on ne fait pas de l’histoire innocemment, et on est toujours rattrapé par le présent et la dimension politique de l’histoire[28]. L’histoire est politique mais aussi publique par nature, elle ne prend donc tout son sens que lorsque les historiens sortent et interviennent dans le monde social auprès de leurs contemporains ; en un mot, assume la fonction sociale de l’histoire.
Cette fonction sociale de l’histoire c’est, selon l’auteur, renouer le dialogue avec la société et en particulier les historiens amateurs, c’est réancrer l’histoire à l’échelle vécue, celle du quotidien, du quartier, du village, faire l’expérience du présent par des enquêtes, et c’est enfin la mettre à portée de tous et faire preuve de pédagogie.
Ainsi, Guillaume Mazeau prône une « histoire à temps pleins » comme il la nomme, dans laquelle les historiens navigueraient entre passés et présent, entre monde savant et monde social en essayant de percevoir au mieux les vibrations des temps historiques. Néanmoins, cette pratique nécessite de trouver le bon compromis[29] entre engagement dans la vie de la cité et la distanciation inhérente à la fabrique de l’histoire.
Cette tension permanente entre passé et présent Guillaume Mazeau l’expérimente en faisant partie du désormais très connu Comité de vigilance face aux usages publics de l’histoire crée en 2005 mais aussi en sachant prendre le temps d’enquêter, écrire, transmettre loin du diktat productiviste qui s’est insinué dans les laboratoires de recherche en sciences humaines.
Redonner au présent un futur et une espérance
Essai incisif et percutant, ce petit ouvrage de Guillaume Mazeau, très référencé, n’est donc pas un énième ouvrage historiographique. C’est avant tout un récit d’historien qui nous livre sa vision de l’histoire, ce qu’elle devrait être, dans un contexte troublé qui ne lui est pas favorable. C’est un livre engagé car il ne mâche pas ses mots pour dénoncer ses collègues historiens retranchés dans leurs bibliothèques ou laboratoires et ayant depuis trop longtemps déserté l’espace public mais engagé surtout car il nous présente une histoire « vraiment contemporaine[30] » en prise avec le présent et le monde social mais sans rogner ses exigences intellectuelles et scientifiques.
Guillaume Mazeau en appelle à une histoire émancipatrice qui libérerait le peuple mais aussi les historiens de la dictature du temps de l’économie en offrant à tous les moyens de penser, d’inventer et d’espérer un futur moins inéluctable que celui que nous propose le libéralisme économique.
On l’aura bien compris, il n’existe pas d’histoire avec un « h » et d’histoire avec un « H » pour Guillaume Mazeau, mais une pratique sociale à partager car l’histoire est par essence politique, et un ouvrage salutaire pour les enseignants et chercheurs afin de remettre en perspective l’intérêt et la puissance de l’histoire, véritable outil (ou arme ?) de construction d’un passé, mais aussi d’un présent et surtout d’un futur.
Des références pour aller plus loin sur la place de l’histoire dans nos sociétés :
ERIBON Didier, D’une révolution conservatrice et de ses effets sur la gauche française, Léo Scheer, 2017.
CHOAY Françoise, Le patrimoine en question, Le Seuil, 2009.
NOIRIEL Gérard, Le venin dans la plume, La découverte, 2019.
DE COCK Laurence, L’histoire comme émancipation, Agone, 2019.
DE COCK Laurence, Sur l’enseignement de l’histoire, Libertalia, 2018.
GENSBURGER Sarah, A quoi servent les politiques de la mémoire ?, Presses Science Po, 2017.
DELUERMOZ Quentin et Pierre SINGARELOU, Pour une histoire des possibles, Le Seuil, 2016.
ROSA Hartmut, Accélération, pour une histoire sociale du temps, La Découverte, 2010.
[1] Comité de vigilance face aux usages publics de l’histoire crée en 2005
[2] MAZEAU Guillaume, Histoire, Anamosa, Paris, 2020, p. 11.
[3] Ibid., p. 14.
[4] Ibid., p. 15.
[5] ROSA Hartmut, Accélération, une critique sociale du temps,
[6] Ibid., p. 15.
[7] Ibid., p. 17.
[8] Ibid., p. 23.
[9] Ibid., p. 28.
[10] Expression très célèbre tiré du titre de l’ouvrage de l’historien Francis Fukuyama en 1993.
[11] Ibid., p. 35.
[12] Ibid., p..40.
[13] Ibid., p. 44.
[14] Ibid., p.43-45.
[15] Sous Sarkozy, le projet de Maison d’histoire de France, op. Cit., p. 47.
[16] Ibid., p. 48.
[17] Gérard Noiriel, cité par l’auteur s’est attaché à ce phénomène des polémistes dans son ouvrage Le venin dans la plume.
[18] Ibid., p. 60-61.
[19] Ibid., p. 61.
[20] Ibid.
[21] Ibid., p. 63.
[22] Ibid.
[23] Expressions de l’auteur, Ibid., p. 63.
[24] Ibid. p. 74.
[25] BLOCH Marc, Apologie pour l’histoire ou le métier d’historien, 1949.
[26] Ibid., p. 83-84.
[27] Ibid., p. 87-88.
[28] Ibid., p. 90.
[29] Ibid., p. 96.
[30] Selon l’expression très célèbre de Benedetto Croce, Ibid., p. 94.