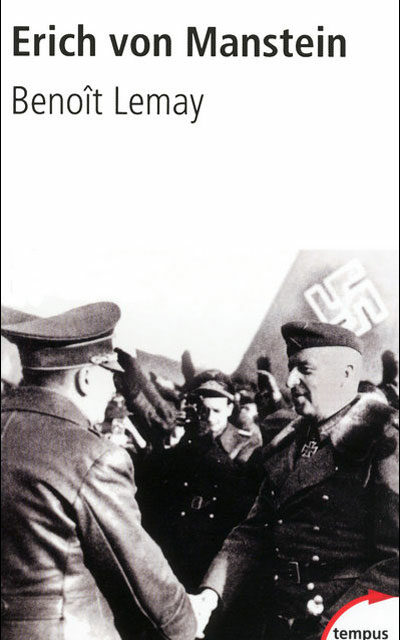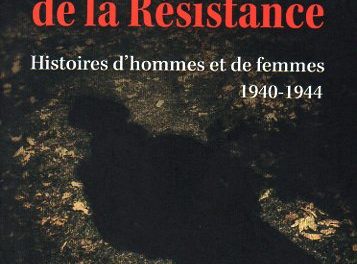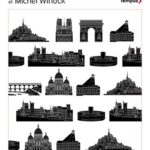Tout aussi habile manœuvrier sur le terrain que prodigieusement doué pour la conception de plans militaires de grande envergure, Manstein reste dans l’histoire militaire comme l’une des incarnations les plus parfaites du génie stratégique engendré par le militarisme prussien. Par sa naissance, il était voué à la carrière des armes. Dixième enfant du général Eduard von Lewinski, il est adopté par son oncle, le général Georg von Manstein.
Un pur représentant du militarisme prussien
A cet égard, il appartient à une caste dont la spécialisation professionnelle militaire remonte aux Chevaliers Teutoniques. Son éducation, rigoureuse et austère, empreinte d’un « fort puritanisme luthérien » (p. 23), le conforte dans sa vocation, qui est d’abord celle d’un officier d’état-major dont la sûreté de jugement et la dureté confinent à l’arrogance, à la fois craint et admiré par ses collègues et ses soldats, et détesté par ses supérieurs pour son ambition et son indépendance d’esprit. Son admission à la Kriegsakademie en 1913, ses capacités stratégiques révélées durant la Première Guerre mondiale, son goût pour la conception – purement théorique – de plans tactiques d’attaque (Kriegsspiel) montrent à la fois sa prédilection pour la stratégie militaire d’ensemble et son aptitude sur le terrain à appliquer ses choix stratégiques tout en s’adaptant aux circonstances.
De fait, le « plus meilleur cerveau que l’état-major ait produit » selon Hitler (p. 24) s’avère être un remarquable créateur de plans opérationnels d’attaque. Manstein est donc de toutes les offensives allemandes. Devenu major-général et sous-chef de l’état-major général de l’armée de terre, il supervise le plan de réarmement de 1935 et favorise, avec son ami Guderian, l’adoption d’une « nouvelle stratégie pour réhabiliter la guerre de mouvement opérationnelle : celle de l’engagement de l’armée blindée et des forces aériennes » (p.58). Pour favoriser la mobilité de la Wehrmacht, il préconisa personnellement la généralisation sur les champs de bataille du Sturmgeschutz (canon d’assaut). En 1936, il dirigea les plans d’occupation de la Rhénanie. Le remaniement du haut commandement militaire par Hitler (devenant commandant en chef de l’OKW – Oberkommando der Wehrmacht – et ministre de la Guerre) freine, un temps, l’ascension de Manstein, expédié en Silésie à la tête de la 18ème division d’infanterie. Mais son exil n’empêche pas l’état-major d’utiliser un plan signé Manstein (le plan Otto) pour mener à bien l’Anschluss de l’Autriche. Lors de l’offensive contre la Pologne, Manstein retrouve une place centrale dans l’offensive. Une partie du « plan blanc » d’attaque relève de ses idées cependant qu’il est nommé chef d’état-major du groupe d’armée du général Rundstedt. Et déjà, la campagne de Pologne repose sur une des théories fétiches de Manstein : coupler la recherche de l’enveloppement des troupes ennemies à une percée foudroyante pour parvenir à leur écrasement complet.
L’apogée, la campagne de France
Cette vision stratégique trouve son apogée au moment de la campagne de France. Manstein est en effet le seul concepteur (et non Hitler comme le rappelle l’auteur) du « coup de faucille » (p.145) qui permit aux troupes allemandes de prendre à revers les troupes franco-britanniques trop avancées dans le Benelux. En cela, il sublime la pensée stratégique des plus grands penseurs de l’école militaire prussienne. Loin de la pusillanimité du plan d’attaque de la France conçu par l’OKW, Manstein – comme dans chacun de ses plans d’ailleurs – cherche à « obtenir une décision stratégique et non un simple succès opérationnel » (p.115). En cela, il reprend certaines options développées jadis par Schlieffen et von Moltke. Toutefois, il les « surpasse » (p.116) en jouant davantage sur la rapidité des mouvements de troupes, grâce principalement à l’utilisation conjointe des Panzerdivisionen et de la Luftwaffe. Manstein est définitivement le stratège du Blitzkrieg à l’Ouest comme à l’Est. Prônant ouvertement le principe d’une guerre préventive contre la Russie, Manstein se distingua sur le front soviétique par trois succès majeurs. Ayant conquis la Péninsule de Crimée, devenu feld-maréchal, Manstein parvint à stabiliser le front russe méridional après la chute de Stalingrad. Il fut surtout l’artisan d’une remarquable retraite sur le territoire ukrainien, parvenant, selon le principe de « l’attaque en retour ou de la seconde frappe » (p.361), à porter de rudes coups à une Armée Rouge pourtant bien supérieure en hommes et en matériel – Manstein reprenant par exemple Kharkov en mars 1943.
Le stratège Manstein est de surcroît un remarquable tacticien, apte sur le terrain à conduire ses troupes au succès mais surtout à adapter ses décisions aux réalités de l’offensive. Manstein n’est pas qu’un militaire de kriegsspiel, concevant ses offensives sur cartes. « Général le plus brillant de la Wehrmacht » (p.132), Manstein manœuvre seul en Crimée à la tête de sa XIème Armée, s’empare après des mouvements audacieux de la péninsule de Kertch pour conquérir finalement, grâce à une puissance d’artillerie peu commune, la place forte de Sébastopol après 250 jours de siège.
Mais ce brillant militaire, capable d’une finesse d’analyse stratégique peu commune, est aussi le soldat qui a accepté les pires compromissions avec le régime nazi et, finalement, a couvert les crimes les plus odieux sans ciller. Car l’homme est très ambigu quant à son attitude face au régime. L’auteur montre d’ailleurs que Manstein n’était pas nazi. Le feld-maréchal, esprit fort et indépendant, n’hésite pas à railler ouvertement Hitler « qu’il considérait comme un parvenu » (p.402), l’affublant ironiquement du titre ottoman de Effendi.
Pas vraiment nazi ?
En outre, Manstein, alors simple colonel, a tenté, en 1934, de s’opposer au décret d’aryanisation des différents corps de l’armée allemande. Sans doute d’ascendance juive, le futur feld-maréchal lutta notamment, mais en vain, pour défendre un de ses subordonnés rayés des cadres de l’armée. Mais ce fut là son premier et dernier acte – « exceptionnellement courageux » selon l’auteur, (p.48) – d’insubordination face à la politique juive du régime. Sa crainte était trop forte de compromettre sa carrière voire de mettre sa vie en péril, les sbires de la SS ayant constitué en avril 1944 un dossier sur sa personne.
Malgré sa tendance naturelle à l’insubordination et son aversion pour la plupart des dignitaires nazis, il s’est au total comporté comme les maréchaux les plus ouvertement nazis de la Wehrmacht (à l’instar de Reichenau). Ainsi, Manstein ferme les yeux (à la différence par exemple des généraux Blaskowitz et Ulex) sur les agissements criminels des Einsatzgruppen des corps SS et SD – mais également de la Wehrmacht – en Pologne, véritable « laboratoire » de la « guerre raciale et d’extermination » (p.99) menée en URSS. Ainsi, les mouvements de son armée en Crimée sont suivis par l’Einsatzgruppe D de l’Oberführer Olhendorf. Et Manstein n’hésite pas, dès novembre 1941, à signer un ordre à ses troupes selon lequel « le soldat allemand a le devoir non seulement d’écraser le potentiel militaire de ce régime, mais il doit aussi se poser en défenseur d’une conception raciale et en vengeur de toutes les cruautés qui ont été perpétrées contre lui et le peuple allemand » (p.270). Avec netteté, il cautionne la politique d’extermination nazie et entraîne la Wehrmacht dans le crime contre l’humanité, assurant que « le soldat devra se montrer conscient de la dure expiation infligée au judaïsme, détenteur spirituel de la terreur bolchevique » (p.271).
Comment expliquer cette attitude ? Plusieurs raisons peuvent être avancées, relevant aussi bien de motivations idéologiques que du plus pur carriérisme. Son désir de devenir chef d’Etat-major de l’armée l’a notamment poussé à mettre sous le boisseau ses préventions à l’égard du régime.
Mais couvre l’entreprise de mort
En outre, son éducation prussienne le conduit à donner un part prévalente à la notion de serment et donc au principe d’obéissance. Benoît Lemay applique d’ailleurs au feld-maréchal « la phrase de Bertolt Brecht « d’abord vient l’obéissance puis la morale » » (p.496). Son serment au Führer le 2 août 1934 scella définitivement la fidélité de Manstein au pouvoir nazi et lui fut un commode paravent pour refuser d’adhérer à tout complot contre Hitler malgré les appels présents de ses pairs Kluge et Rommel. L’auteur montre également avec clarté le profond bellicisme de la Wehrmacht – dès avant l’accession de Hitler au pouvoir – dans lequel s’inscrit pleinement Manstein. Il fut notamment l’un des cadres de l’armée les plus « va-t-en guerre » (p.70) qui soient, militant ardemment, par exemple, pour l’invasion des Sudètes en 1937, pour un débarquement militaire contre la Grande-Bretagne en 1940 au soir de Dunkerque, et surtout pour l’attaque contre l’Union Soviétique. En cela, l’homme resta guidé, tout au long de sa vie, par un « antibolchévisme » (p.37) viscéral conforté par ses déplacements en URSS durant l’Entre-deux-guerres.
Au final, Erich von Manstein fut donc un homme éminemment paradoxal dans sa conduite. Animé d’une haute conscience il ferma les yeux sur une entreprise mortifère d’envergure mondiale. Grand stratège, il resta remarquablement aveugle sur la fin inéluctable de l’Allemagne nazie, au point même de croire en la capacité de l’armée de reprendre victorieusement l’offensive même au soir de sa mise en congé par Hitler au printemps 1944.