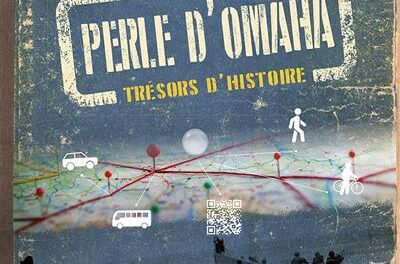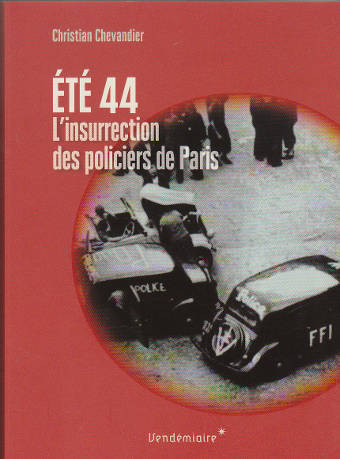
Professeur d’histoire contemporaine à l’université du Havre, Christian Chevandier a récemment publié deux ouvrages, Policiers dans la ville. Une histoire des gardiens de la paix (Gallimard, 2012) et La Libération de Paris. Les acteurs, les combats, les débats (Hatier, 2013), qui le qualifient particulièrement pour nous proposer aujourd’hui une histoire de l’insurrection des policiers de Paris du 19 au 25 août 1944. Ceux qui avaient servi le régime de Vichy écrivirent ainsi le premier acte de la libération de Paris « par elle-même », comme le dira le général de Gaulle.
Cet ouvrage novateur couvre un large champ. Si la première partie est effectivement un récit des événements de la libération de Paris centré sur les policiers qui en sont les acteurs majeurs (récit clair et vivant qui ne se veut pas exhaustif), la seconde partie se situe à la confluence de l’anthropologie et de l’histoire. S’appuyant sur l’analyse exhaustive des dossiers individuels des 152 policiers morts dans les combats, l’auteur dresse un portrait sociologique et politique de ces policiers résistants. A cette source originale s’en ajoutent beaucoup d’autres, qu’il s’agisse des archives de la préfecture de police ou de nombreux témoignages et récits (tous cités dans les 761 notes qui se trouvent en fin d’ouvrage).
L’étude est solidement structurée : la première partie (160 pages) intitulée « Combats dans Paris » est divisée en trois chapitres : « Paris occupé », « Paris insurgé », « Paris libéré » ; la seconde (225 pages) intitulée « Des insurgés » les analyse d’abord comme « Des combattants », puis comme « Des hommes », avant de traiter « Des mémoires ».
Créée par Bonaparte, la préfecture de police, dont le titulaire dépend directement du ministre de l’Intérieur, compte presque 25 000 fonctionnaires, les plus nombreux étant les gardiens de la paix et les gradés, brigadiers et brigadiers-chefs. Le corps des « gardiens de la paix publique » constitue une police urbaine en uniforme dont les membres connaissent fort bien le quartier dans lequel ils travaillent et demeurent. Les inspecteurs et les commissaires, qui exercent dans les commissariats ou dans les brigades spécialisées de la police judiciaire ou des Renseignements généraux sont en civil. À Paris, lorsqu’on parle de la préfecture de police, on fait souvent référence au bâtiment, la caserne de la cité, et non à l’institution.
Ces policiers, qui sont des hommes socialisés dans un régime républicain et recrutés par une administration républicaine, ont été au premier rang pour servir le pouvoir de Vichy et sa politique de collaboration. Mais, dès 1943, et de manière croissante à partir de juin 1944, certains policiers sont devenus sensibles aux arguments de la Résistance. Plusieurs centaines d’entre eux contribuèrent à la libération de Paris.
Combats dans Paris
Vers la grève générale
« Dès les premières semaines de l’Occupation, et en nombre significatif à partir de 1942, les policiers sont entrés en résistance. » Ils se sont regroupés au sein de trois mouvements de résistance, créés à partir du début de l’année 1943 et qui ne sont pas cloisonnés : « Police et Patrie », le moins important des trois, issu de » Libération-Police », mis en place en juillet 1942 par les responsables de « Libération-Nord » est plutôt proche des socialistes ; le « Front National de la police », créé au début de l’année 1943, est intégré au grand mouvement fondé par le parti communiste, le « Front National » ; « Honneur de la police », le plus important d’entre eux, a été fondé par le brigadier Arsène Poncey, après le démantèlement du groupe de résistance « Valmy ».
Pour ces fonctionnaires qui ont pris le parti de la résistance, la question de la désobéissance est fondamentale. « Certaines interventions donnent l’impression que, profitant de la confusion ambiante, les agents tentent de se soustraire aux ordres, voire de faire le contraire de ce qui leur est demandé. » A l’occasion des grandes manifestations patriotiques du 14 juillet 1944, pour la première fois la police n’est pas intervenue et, s’il n’est pas encore question de prendre les armes, l’idée d’une grève se propage, portée par les organisations syndicales dans la clandestinité. Dès le 10 août, des syndicalistes résistant des chemins de fer lancent un appel à cesser le travail dans la région parisienne, tandis que les autorités de Vichy quittent la ville, que les occupants font preuve d’une férocité accrue et que la vie quotidienne des parisiens des milieux populaires est plus dure que jamais.
Le 8 et le 9 août, sur la consigne de leurs organisations de résistance, certains policiers ont abandonné leur poste en gardant leur arme administrative, leur tenue et leur « carte de réquisition » qui leur permet d’attester de leur appartenance à la police. Ils ont été immédiatement suspendus de leurs fonctions, révoqués et recherchés. Le 13 août, le comité directeur du Front National de la police prend la décision de lancer un mot d’ordre de grève auprès de tous les effectifs de police pour le surlendemain. Les deux autres mouvements, puis la direction des Forces Françaises de l’Intérieur s’y rallient et un « Comité de libération de la police parisienne » proclame un « ordre de grève générale pour toute la police parisienne ». « Ce texte fait basculer les légitimités et modifie la situation des policiers. La lâcheté ordinaire, l’excuse de l’obéissance aux ordres, celle de tous les bourreaux, ne tient plus désormais. »
Le 15 août au matin, l’ordre de grève est massivement suivi : « Ces hommes dont la fonction est d’assurer l’ordre sèment le désordre par leur simple absence. » Le 16 au soir, Chaban-Delmas, le Délégué militaire national, arrive à Paris et informe les responsables de la Résistance que Köenig est hostile à toute insurrection. L’état-major FFI de la région parisienne fait placarder un ordre de mobilisation appelant « tous les Français et Françaises valides à rejoindre les formations FFI ou les milices patriotiques », tandis que les « élus communistes de la région parisienne » signent un appel « à l’insurrection libératrice ». Les gaullistes comprennent vite qu’ils seront débordés si l’insurrection se fait sans eux, et Chaban télégraphie à Köenig d’intervenir auprès des Alliés pour demander une occupation rapide de Paris. Rol-Tanguy, chef des FFI, promeut une tactique de guérilla urbaine qui privilégie la mobilité. Le 17 août, Charles Luizet, nommé Préfet de police par le Gouvernement provisoire de la République française, arrive à Paris et, le lendemain, Alexandre Parodi, représentant du général de Gaulle, le présente aux résistants de la police.
L’insurrection, malgré la trêve
Le mouvement « Honneur de la police » prend l’initiative d’appeler à un rassemblement des policiers grévistes le 19 août au matin, devant la préfecture de police. Gardes et gendarmes, qui remplaçaient les policiers en grève, se rallient aux insurgés qui rentrent dans la cour et investissent les bâtiments. Les autorités issues de la Résistance s’installent. Le gaulliste Charles Luizet, qui choisit Edgar Pisani comme chef de cabinet et le communiste Rol-Tanguy, qui installe son PC près de Denfert-Rochereau, font connaissance : « deux autorités, deux légitimités sont en présence ». Les policiers les plus compromis dans la politique de collaboration, à commencer par ceux des Brigades spéciales, sont arrêtés quand ils ne se sont pas déjà enfuis.
Les agents venus de tout Paris occupent la caserne de la cité ; la Résistance adresse aux soldats de l’armée d’occupation des tracts rédigés en allemand, tandis que la guérilla s’installe et prend de l’ampleur en gagnant le Quartier latin sur la rive gauche et que les mairies d’arrondissement sont occupées. Chaban est atterré de cette insurrection à laquelle Köenig n’a pas donné l’ordre, mais qu’il n’est plus possible de retenir. Il n’est pas question pour les policiers qui occupent la caserne de la cité de l’abandonner alors que la raison semble l’imposer. C’est dans ces conditions qu’une trêve est négociée car les forces de l’occupant ne sont pas négligeables. Cette trêve qui fut contestée dès son origine, et qui fut l’objet d’amples débats, fut négociée par Nordling qui entra en relation avec Choltitz, mais à aucun moment les autorités de la Résistance ne furent consultées. Les deux parties furent donc persuadées que l’ennemi avait demandé la trêve et y virent ainsi un signe de leur propre force. Elle fut annoncée par des équipages mixtes (policiers parisiens et soldats allemands) le dimanche 20 août, mais ne fut pas respectée et n’empêcha pas l’occupation de l’hôtel de ville.
Révolution ?
Le lendemain des barricades furent édifiées par dizaines dans de nombreux quartiers et la guérilla s’amplifia, en particulier au Quartier latin. Le 23 août, l’ennemi attaqua le commissariat du 8e arrondissement et un incendie se déclara au Grand Palais. « Par la dilution de certains pouvoirs, par l’affirmation d’autorités officielles qui s’installent, qui s’opposent, par l’autonomie prise sur le terrain par les acteurs, la situation n’est pas seulement insurrectionnelle, elle est révolutionnaire. »
« La population parisienne est en train de se réapproprier son histoire et de renouer avec son identité (…) Les photographies prises en 1871, à Belleville par exemple, semblent avoir inspiré les insurgés. Ces barrages ont plusieurs fonctions. Ils entravent d’une part la circulation des véhicules allemands avec une efficacité indéniable, sauf dans le cas des chars (…) Les barricades permettent d’autre part à la population d’un quartier de manifester sa cohésion. »
Devant cette situation, le commandement allié ordonne à la 2e Division blindée du général Leclerc de se diriger sur Paris en suivant deux itinéraires, par Chartres par Rambouillet. C’est alors que Choltitz reçoit une longue missive signée par Hitler lui ordonnant de défendre la ville, quitte à ce qu’il n’en reste qu’un « tas de ruines » et que les autorités de la Résistance dénoncent la trêve.
Le 24 août au soir, un appel général ordonne aux policiers de reprendre leur service en uniforme. Le capitaine Dronne reçoit l’ordre du général Leclerc, qui le considère comme un de ses meilleurs officiers, de marcher sur Paris. Il est chef de la 9e compagnie du Régiment de marche du Tchad, vite appelée « La Nueve » parce qu’elle est en grande partie composée d’Oranais hispanophones et d’anciens combattants Républicains espagnols déjà très aguerris. Il entre dans Paris peu avant 21h par la porte d’Italie. Le bourdon sonne à la cathédrale Notre-Dame. L’insurrection est devenue libération.
Libération
Les policiers ont repris leurs uniformes et les groupes tactiques de la 2e DB pénètrent dans la ville par quatre endroits différents, tandis que l’armée américaine arrive par la porte d’Italie. Leclerc s’installe à la gare Montparnasse qui possède un central téléphonique. « Soldats américains, Français libres de la 2e DB, FFI : la diversité des combattants qui libèrent Paris en cette chaude journée contribue à créer une atmosphère étrange que restituent bien les films et les photographies de l’époque. Les policiers, en uniforme, souvent casqués, participent aux combats mais assurent aussi la protection de la population ». Les accrochages avec l’occupant continuent tandis que Nordling fait parvenir à Choltitz un ultimatum du commandant français exigeant sa reddition. Il accepte, et c’est dans la salle de billard de la préfecture de police que Choltitz signe l’acte de reddition. Leclerc l’accompagne ensuite à l’extérieur et l’emmène au PC de Montparnasse où il paraphe une série d’ordres de cessez-le-feu destinés à ses subordonnés. De Gaulle se rend d’abord à la préfecture de police puis gagne l’hôtel de ville où il prononce l’un de ses plus célèbres discours.
Le lendemain c’est la « marche triomphale » que de Gaulle a tenu à organiser, de la tombe du soldat inconnu jusqu’à Notre-Dame et qui se termine par un Te Deum à la cathédrale, « cérémonie voulue par de Gaulle (qui) ancre la journée dans une tradition de triomphes, des victoires célébrées par un Te Deum sous l’Ancien régime, à la cérémonie du 14 juillet 1919 au cours de laquelle défilèrent les vainqueurs de la Grande Guerre ».
Le 31 août, le gouvernement s’installe dans la ville libérée. Le nouveau pouvoir a besoin de s’appuyer sur une police forte afin d’affirmer son autorité politique et de protéger les citoyens : c’est le temps des débordements, des règlements de comptes et de l’épuration. « La police parisienne doit mettre au pas des groupes plus ou moins armés, issus de la résistance et au sein desquels le parti communiste est généralement influent » La commission d’épuration de la préfecture de police tient sa première séance dès le 8 septembre et siégera jusqu’à novembre 1945. Près de 4000 fonctionnaires seront traduits devant cette commission qui sanctionnera d’autant plus fortement que les responsabilités du fonctionnaire auront été importantes.
Des insurgés
L’objectif de cette seconde partie est de comprendre l’insurrection des policiers parisiens en les étudiant à la fois en tant que groupe social et en tant qu’individus. L’auteur propose donc une prosopographie, biographie collective du groupe social des policiers parisiens insurgés, portant sur leurs origines sociales, leurs parcours depuis l’enfance, l’influence des événements qu’ils ont traversés comme la Grande Guerre, la crise des années 1930, ainsi que les bouleversements qu’ils ont vécus depuis 1939.
Des combattants
« Les agents ne combattent pas en formations constituées. Mais à maints égards, ils ressemblent fortement à une troupe (…) coordonnée administrativement et pratiquement. » Les fonctionnaires de police sont entre 21 000 et 25 000 et les gardiens, brigadiers et brigadiers-chefs entre 20 000 et 24 000. Parmi eux, il y aurait 2700 membres actifs ou sympathisants de la Résistance, surtout des gardiens et des petits gradés : effectif proportionnellement considérable.
La troupe qui s’insurge est fortement hiérarchisée et centralisée, mais l’insurrection a bouleversé la hiérarchie dans la mesure où de simples policiers l’ont préparée, puis en ont pris la tête. Dans les services, les responsables des trois mouvements de Résistance se sont substitués à des chefs trop impliqués dans la politique de Vichy.
La tenue est constitutive de la fonction de gardien de la paix ; elle contribue à octroyer une dimension militaire à leur groupe, d’autant plus qu’à la différence des FFI qui sont tête nue, ils ont un couvre-chef qui leur permet de faire le salut réglementaire. Ils sont en civil sur les barricades, « ce déshabillage est bien un rite de purification, celle d’un costume que la collaboration a souillé ». Mais le 24 août au matin, l’ordre leur est donné de se mettre en tenue : ils se battent désormais en uniforme. L’arme à feu constitue également un enjeu identitaire pour les gardiens de la paix, même si l’armement à la disposition des occupants de la préfecture de police au premier jour de l’insurrection est particulièrement restreint.
L’auteur parvient à restituer et à prendre en compte l’atmosphère concrète de l’insurrection : le bruit assourdissant des combats, le concert des cloches de la cathédrale, les haut-parleurs des voiturettes qui délivrent des informations, les « manifestations sonores (…) des pratiques sexuelles », la vue et l’odeur des incendies dans un ciel très dégagé, l’odeur de la mort, celle des cadavres. Il consacre plusieurs pages à une étude très fine des « tireurs des toits » qui affolaient les libérateurs et les passants et qui apparaissent aujourd’hui comme la dernière énigme de la libération de Paris.
Les policiers se trouvent dans une situation contradictoire dans la mesure où ils doivent combattre, mais aussi et simultanément protéger la population. « Tout au long de l’insurrection, d’un ton plaisant, complice ou autoritaire, il tentent d’éloigner les curieux. » Dans la mesure du possible, ils règlent la circulation et cherchent à empêcher les pillages, à limiter les exactions et à éviter les lynchages. Leur parfaite connaissance de la ville est un atout dans l’insurrection. L’auteur montre qu’une majorité de policiers ont combattu dans le quartier où ils résidaient et qu’ils connaissaient bien, et que les commissariats ont été des centres importants de diffusion des nouvelles officielles. « L’occupation des locaux de police par les agents insurgés renforce à la fois la légitimité de l’insurrection et l’inscription des policiers au sein de la population parisienne. »
« Combattants empressés, loin de l’image du gardien de la paix débonnaire et peu martial, les policiers sont cette semaine là appréciés pour leur efficacité. »
Des hommes
Les pertes humaines totales au cours des combats de la libération de Paris seraient légèrement inférieures à 5000 victimes : un peu moins de 600 civils, entre 900 et 1000 FFI, 130 soldats de la 2e DB et 3200 soldats de l’armée allemande. Le chiffre officiel des fonctionnaires de la préfecture de police tués au cours des combats fut établi à 167. Les recherches de l’auteur le conduisent à retenir le nombre de 152, la plupart tués dans un affrontement, mais un tiers tués après avoir été faits prisonniers, fusillés ou massacrés, pour beaucoup après avoir été torturés. C’est l’étude des dossiers administratifs de ces victimes conservés aux Archives de la préfecture de police qui constitue la source de ce chapitre.
Ils appartiennent à diverses générations, sont tous nés en France et presque tous dans un département rural de la moitié Nord. Ils sont issus de milieux populaires, ont presque tous suivi la scolarité obligatoire et se sont mis au travail très jeunes : ils ont exercé deux ou trois métiers différents avant d’entrer dans la police. Ils ont peu d’enfants, caractéristique malthusienne habituelle à Paris. Les morts de l’insurrection étaient dans la police depuis 13 ans en moyenne : ce sont donc des policiers de la IIIe République. Ils ont tous étés militaires, mais un quart seulement a connu l’expérience d’un véritable conflit. La Grande Guerre au cours de laquelle ils étaient enfants pour la plupart les a beaucoup marqués. Par leur passé, par leur parcours et par leur culture « ils font bien partie du peuple de Paris »
Ils ne se perçoivent pas forcément comme d’anciens instruments de la politique de Vichy. Néanmoins ils ont participé aux persécutions antisémites et à la répression de la Résistance. « Il est donc vraisemblable que la plupart des policiers morts pour la Libération ont été mêlés à une ou plusieurs rafles antisémites. » Il est possible d’observer des signes et des actes de mauvaise volonté : de rares démissions, de rares refus de promotion, mais les archives ne permettent pas de repérer un départ massif de l’administration. Il est possible d’observer aussi des fuites permettant à des Juifs d’échapper à la rafle, il s’agit alors d’actions individuelles. Les agents en uniforme n’ont pas participé à la torture des résistants qui fut le fait des Brigades spéciales. Impuissants face aux truands qui bénéficiaient du port d’armes et même de cartes de police, les policiers ont ressenti leur arrogance comme une humiliation.
« Pour chacun de ces policiers parisiens se pose la question de l’articulation entre son métier, dont l’obéissance semble constitutive, et sa conscience. Question pour laquelle l’historien n’a pas de réponse. »
Des mémoires
Dans ce dernier chapitre l’auteur entreprend tout d’abord une étude approfondie du devenir des cadavres des insurgés, identification, reconnaissance, recherche des circonstances de la mort, constitution de dépôts mortuaires improvisés dans des lieux publics, récupération des corps, recherche des cercueils, inhumation, exhumation et transfert. Les autorités tiennent à aider les familles en deuil et procèdent à des promotions posthumes et rétroactives.
Il propose ensuite une étude des récits immédiats des événements de la Libération, puis des récits tardifs et de la constitution des mémoires. Il procède à une approche critique des témoignages écrits, des bandes d’actualités, des documentaires et des films. Il montre comment se sont fixées les représentations, accordant toute son importance au livre puis au film Paris brûle-t-il ? Enfin sont évoqués les travaux historiques qui traitent du rôle des policiers parisiens dans l’insurrection.
Le chapitre se termine par une analyse de la mémoire officielle et des commémorations. Dès octobre 1944, aux Invalides, la préfecture de police fut admise dans l’ordre national de la Légion d’honneur, au cours d’une cérémonie qui eut lieu dans la cour d’honneur en présence du général de Gaulle et du général Koenig, ainsi que des organisateurs de l’insurrection devenus commissaires divisionnaires. Le rôle de la police pendant l’occupation est effacé et la mémoire officielle valorise chez le policier le combattant plutôt que l’insurgé. C’est l’ensemble du groupe qui est honoré mais de nombreuses décorations sont distribuées individuellement.
Paris n’a donné à aucune de ces voies le nom d’un policier mort pour la Libération, mais des dizaines de plaques commémoratives ont été apposées un peu partout dans Paris par des proches et des associations, la plupart dès l’automne 1944. Un « monument de la préfecture de police aux morts pour la France et la libération de Paris » fut installé sous le porche de l’entrée sud de la cour de la préfecture. « Il demeure le lieu d’une mémoire pérenne » : chaque année une cérémonie commémorative s’y déroule, le 19 août ou à une date très proche, en présence du ministre de l’Intérieur, du préfet de police et du maire de Paris.
« La démarche de construction identitaire du groupe social des policiers parisiens passe fortement par le souvenir des héros de la Libération, restituant ainsi la légitimité perdue du fait de la collaboration d’État. »
Cette étude approfondie et originale dans sa seconde partie permet de mieux comprendre pourquoi des hommes appartenant à une police ayant servi l’occupant ont participé au soulèvement du peuple de Paris. Peu d’entre eux avaient fait la Grande Guerre mais beaucoup l’avait vécue enfant. Tous avaient subi la honte de la défaite humiliante du printemps 1940. Par leur insurrection ils retrouvent leur dignité. L’auteur insiste alors sur la nécessité de ne pas confondre l’institution et les individus, estimant que cette confusion « est sans doute l’erreur la plus commune des analyses de la société française pendant la Seconde Guerre mondiale » : « la police a collaboré et des policiers ont résisté » écrit-il. Mais l’institution existerait-elle sans les hommes qui l’incarnent ?