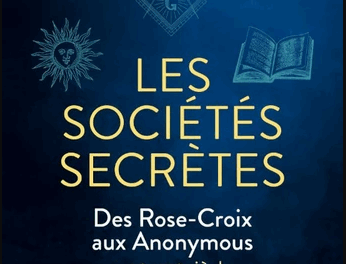Plaidoyer pour l’oubli?
« Face au passé « est un ouvrage passionnant à plusieurs égards. Outre une analyse réflexive sur l’histoire de la mémoire, un champ relativement récent, Henry Rousso y revisite la mémoire nationale et ses enjeux de mémoire. Il montre également que la mémoire de la Shoah a servi de modèle matriciel à une mondialisation de la mémoire qui se déploie aujourd’hui sur tous les continents.

Henry Rousso, spécialiste de l’histoire de la mémoire de Vichy, a rassemblé dans cet ouvrage des contributions anciennes ou récentes, en partie ou totalement remaniées et réécrites, sur la notion de mémoire qui a fini par « signifier sans distinction toute forme de rapport entre passé et présent ». Ce mot « usé », rappelle Henry Rousso dès son introduction, est devenu « un élément déterminant de l’affirmation des identités collectives de groupe ou de nations. Elle donne lieu à de nouvelles formes de revendications sociales et de politiques publiques, « les politiques de mémoires », actions volontaristes et finalisées destinées à promouvoir une certaine idée du passé. Elle ne se limite plus, comme ce fut toujours le cas, à des dispositifs visant à entretenir le souvenir de tel ou tel événement ou de tel ou tel personnage. Elle est devenue une vertu cardinale de notre temps, un nouveau droit humain, un marqueur des sociétés démocratiques, qui repose sur l’idée qu’il faut agir rétrospectivement sur le passé pour le « réparer », pour en soigner les séquelles, pour le réécrire au nom de principes qui fondent notre présent » (p. 10).
C’est à comprendre pourquoi et comment la mémoire s’est transformée aujourd’hui en une « valeur » en soi que s’attelle Henry Rousso dans cet ouvrage divisé en trois parties : intitulée « Le passé conflictuel », la première propose une réflexion épistémologique sur l’histoire de la mémoire qui s’interroge notamment sur les difficultés à cerner ce que signifie l’absence, le manque : « pourquoi n’a –t-on pas parlé plus tôt de tel événement historique supposé tombé après coup dans l’oubli ? », se demande ainsi l’historien. Dans le premier chapitre, inédit, Henry Rousso revient notamment sur ses propres pratiques et ses propres conclusions qu’il amende partiellement pour en arriver à une définition complexe de l’absence de mémoire qui peut se décliner, selon lui, comme un « oubli, véritable ou dénoncé après coup par besoin de reconnaissance », comme « des silences, vertueux ou contraints par l’interdit ou par la peur ». Cette absence de mémoire peut-être aussi un « refoulement » ou « la conséquence d’un déni ». Elle peut enfin relever plus simplement de « l’ignorance ou de l’incompréhension » de l’événement (p. 57). Le deuxième chapitre, moins original, revient sur le statut de l’archive dans l’histoire contemporaine, en particulier dans l’histoire du temps présent. Le troisième s’interroge sur l’apport de la psychanalyse à la compréhension du temps présent : dans la mesure où le travail de l’historien comporte obligatoirement une dimension psychologique, la psychanalyse peut aider à saisir les « intentions des acteurs, leurs raisons d’agir, leur imaginaire, leurs mémoire ». Rousso répond ici en partie aux critiques qui lui avaient été faites sur l’utilisation de concepts psychanalytiques dans Le syndrome de Vichy. S’il reconnaît que l’utilisation un peu hâtive de cette notion de refoulement pouvait prêter le flan à la critique, il n’en affirme pas moins que la psychanalyse peut s’avérer d’un grand secours dans « l’opération historique » (p. 75).
La deuxième partie porte sur « La mémoire nationale en France ». Moins neuve que la précédente, elle s’attache à analyser les « nœuds de mémoire » les plus débattus en France depuis une trentaine d’années : le négationnisme, les politiques publiques du passé, le poids des deux Guerres mondiales dans les commémorations, le retour d’une mémoire de la Résistance et la mémoire de la Guerre d’Algérie qu’il compare à celle de Vichy dans un chapitre intitulé « Le double fardeau : Vichy et de l’Algérie ». Henry Rousso y montre que la nature conflictuelle et concurrente des représentations de la Guerre d’Algérie se double d’interrogations éthiques et politiques ne relevant pas seulement du passé. Cet entrelacement de l’histoire, de la morale et du politique, au sens noble du terme, fait de la Guerre d’Algérie un enjeu de mémoire particulièrement sensible en France, bien sûr, mais aussi en Algérie, et au-delà, dans le monde arabo-musulman. Dans cette partie, l’historien s’interroge enfin sur la fièvre commémorative qui a saisi François Hollande : il suggère notamment que ce surinvestissement dans le passé traduit les incertitudes sur le présent d’une société qui a du mal à construire un projet pour le futur. Le Général de Gaulle, rappelle Henry Rousso, ne se préoccupait nullement de la mémoire au sens contemporain du terme, il était dans l’action et dans la tradition.
La troisième partie décentre le regard en proposant un tour d’horizon des différents régimes mémoriels actuels analysés dans leur dimension transnationale, européenne et mondiale. Une place de choix est réservé au procès Eichmann qui a servi de matrice et de modèle mémoriel en Europe et au-delà. Henry Rousso analyse également la mémoire négative de l’Europe, une mémoire née des cendres de la guerre et centrée sur la Shoah. Le rejet de la Shoah comme paradigme mémoriel en Europe de l’Est, et notamment en Pologne, comme les critiques suscitées ça et là en Europe de l’Ouest par les repentances prouvent que cette mémoire négative ne peut servir de fondement au projet européen. Alors que pendant longtemps on a présenté « le devoir de mémoire » comme le moyen de préserver les sociétés européennes des conflits futurs, il est en effet devenu aujourd’hui évident que cette mémoire négative ne prémunit nullement contre l’antisémitisme et la violence. Les attentats de Paris en témoignent. Dans ces conditions, jusqu’où peut-on imposer aux générations nées après la guerre le fardeau d’une telle mémoire ?
Le dernier chapitre, qui porte sur la mondialisation de la mémoire, explore la manière dont les modes de gestion du passé circulent d’un espace à l’autre et se standardisent dans des contextes politiques et culturels très différents. A Murambi, au Rwanda, par exemple, le musée historique du génocide a été conçu sur le mode des musées de la Shoah. Dans la même ville, le mémorial du génocide, en revanche, se réclame d’une politique de la mémoire que l’historien qualifie de « traumatique – sans jugement de valeur », ajoute-t-il. Cette politique de la mémoire, explique-t-il, cherche à maintenir présente la violence du passé, tout comme le traumatisme survit chez un sujet incapable de surmonter le choc. Cette forme de mémorialisation n’est pas tournée vers la mise à distance ou l’apaisement de la conscience mais au contraire vers l’entretien de la blessure originelle, « la mise en scène de l’épouvante » . Cette mise en mémoire particulière participe d’une « victimisation du passé » où les victimes sont devenues le sujet central des commémorations tandis que les héros, dont on célébrait autrefois les actions de gloire, sont occultés. Ce mode de gestion du passé, s’interroge Henry Rousso, est-il moins traumatisant pour les victimes que l’oubli ? Rien n’est moins sûr. Quoi qu’il en soit, ce décentrage par rapport à l’exceptionnalité française est particulièrement bienvenu.
C’est avec la dédicace de l’ouvrage d’Henry Rousso à son père, « apatride et réfugié et qui eut la sagesse de laisser le passé derrière lui » que pourrait se conclure ce livre passionnant. Dans une interview accordée à Libération le 6 avril avril 2016, l’historien explique que son père, juif égyptien chassé par Nasser en 1956, fut « déchu de sa nationalité. Il s’est donc retrouvé apatride. Le passé aurait pu être, pour ce déraciné, une source de ressentiment ou de nostalgie. Mais se tourner vers l’avenir et laisser de côté les blessures du passé est la marque de générations qui ont vécu de grands traumatismes. Je crois que le surinvestissement sur la mémoire est une forme d’impuissance et je le perçois plus encore depuis le 13 novembre » (p. 289) . Un plaidoyer pour l’oubli ?