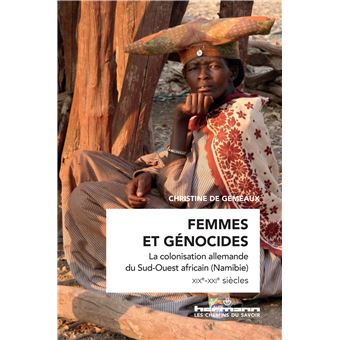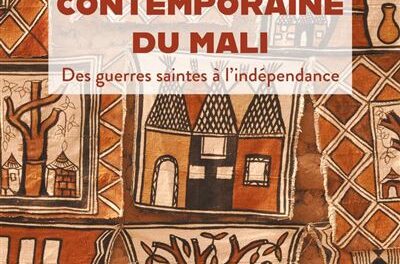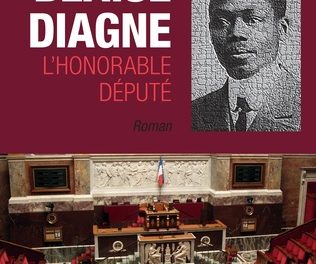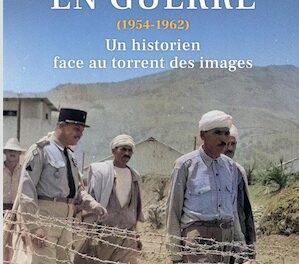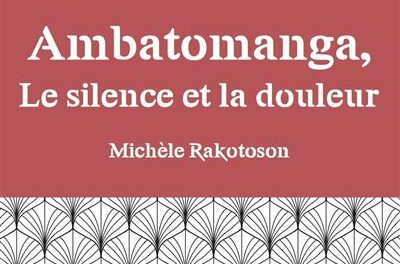Germaniste, professeure émérite à l’université de Tours, spécialiste de l’empire colonial allemand, Christine de Gemeaux consacre cet ouvrage au Sud-Ouest africain, colonie allemande de 1884 à 1920, devenue la Namibie au moment de son indépendance en 1990. Elle évoque les grands aspects de la colonisation allemande, en particulier le génocide des Hereros et des Namas entre 1904 et 1908. Dans son ouvrage l’auteure consacre de nombreux développement aux femmes allemandes qui ont participé à la colonisation. Elle s’intéresse particulièrement à la vie et à l’oeuvre de Margarete von Eckenbrecher ( 1875-1955) fermière et institutrice qui publia en 1907, mais il y eut ensuite des rééditions actualisées « Was Afrika mir gab und nahm. Erlebnisee einer deutschen Frau in Südwestafrika 1902- 1936 (« Ce que l’Afrique m’a donnée et m’a prise. Les expériences d’une femme allemande dans le Sud-Ouest africain »). L’ouvrage décrit la vie des colons et l’ampleur des préjugés raciaux de la plupart d’entre eux. La dernière partie de l’ouvrage de Christine de Gemeaux est consacrée à la dimension mémorielle, au souvenir de la colonisation : reconnaissance du génocide par les autorités allemandes, politiques de réparation et de restitution des biens spoliés.
Le Sud-Ouest africain / Namibie est un vaste Etat d’Afrique australe ( 825 418 Km2). C’est un territoire hostile. Les côtes sont bordées par l’Atlantique traversé par un courant océanique glacial auquel s’ajoutent des vagues déferlantes. Les baleines et les otaries y sont nombreuses. Le littoral est désertique et parsemé de dunes qui peuvent atteindre 200m. L’intérieur du pays est plus favorable à l’occupation humaine et c’est là que s’installent les colons allemands, mais à l’est se trouve le grand désert du Kalahari.
La colonisation de la Namibie
Lors de l’arrivée des Européens, la Namibie est loin d’être un territoire vide.et compte environ 250000 habitants au début du XXe siècle. Les plus anciens occupants sont les Bushmen ou Sans (environ 30000), présents depuis mille ans avant l’arrivée des Européens . Ce sont des chasseurs-cueilleurs ou ils pratiquent l’agriculture pastorale. Beaucoup vivent dans le désert du Kalahari. Les groupes les plus importants sont des populations bantoues venues d’Afrique centrale aux XVIIe et XVIIIe siècles. Au nord, vivent les Kavangos et les Ovambos (ils constituent aujourd’hui le groupe le plus important en Namibie et nous verrons que ce n’est pas sans conséquence pour ce qui concerne les questions mémorielles), soit environ 150000 personnes. Les Ovambos sont répartis verticalement en petits royaumes autoritaires. Au centre du pays se trouvent les Hereros (80000) un peuple d’éleveurs ( ils consomment peu de viande mais surtout du lait) dont la vie, les traditions, les signes de puissance, sont centrés autour de la possession du bétail. Ce sont eux qui ont eu le plus à souffrir de la colonisation allemande, ce qui explique leur révolte. Les Hereros dominent d’autres peuples comme les Damaras Au centre- sud se trouvent les Namas ou « peuple rouge » (20000 individus). En conflit sanglant avec les Hereros, ls s’allient d’abord aux Allemands, puis se révoltent. Beaucoup de ces peuples sont évangélisés, mais peut- être superficiellement.
L’ Afrique australe est connue des Européens d’abord par les navigateurs portugais, puis au début du XIXe siècle par des colons allemands ( souvent des pasteurs ) venus de la Colonie britannique du Cap fondée en 1806. Les commerçants allemands connaissent d’abord des difficultés et parcourent de longues distances « Le trek et le troc sont difficiles » comme le note l’auteure. La colonisation s’accélère à la fin du XIXe siècle. En 1884, Lüderitz un riche commerçant de Brême obtient le protectorat allemand. Des parcelles réputées fertiles ou riches en minerais sont achetées à des chefs namas. Des villes sont fondées comme la future capitale Windhoek. Un chemin de fer est construit. La colonie est exploitée à la fois par des grandes compagnies concessionnaires (on découvre des mines de diamant en 1908) et par des colons qui achètent bas prix ou spolient des terres Le Sud-Ouest africain devient une colonie de peuplement. La colonie est dirigée par un gouverneur les deux premiers étant Carl von François ( comme son nom l’indique , il s’agit d’un descendant de Huguenot français , sans doute ayant quitté la France après la révocation de l’ Edit de Nantes), puis par Heinrich Göring, le père du dirigeant nazi. La colonie est plutôt sous- administrée mais en 1897 est créée une troupe coloniale, la « Schutztruppe » qui joua un rôle meurtrier lors du génocide des Hereros et des Namas. Cette politique s’inscrit dans le cadre de la politique impériale des puissances européennes à la fin du XIXème siècle, en particulier la conquête de l’Afrique, l’Allemagne étant soucieuse de se « faire une place au soleil » selon l’expression du chancelier Von Bülow. L’Allemagne se doit donc d’avoir de bonnes relations avec d’autres puissances coloniales, en particulier avec le Royaume-Uni dans le cadre de ce que l’on a appelé la «transimpérialité». Au nord du Sud-Ouest africain les relations avec l’ Angola portugaise ne posent pas de problème. Au sud, les relations avec l’Union sud-africaine sont plus complexes. Les Britanniques ne s’opposent pas à la colonisation allemande en Afrique. Le conflit entre les Britanniques de la colonie du Cap et les Boers pourrait être source de conflit mais ce n’est en fin de compte pas le cas. Des nationalistes allemands soutiennent les Boers et un bataillon de volontaires européens parmi lesquels de nombreux Allemands, part d’Europe pour les soutenir mais le gouvernement allemand ne veut pas entrer en conflit avec le Royaume-Uni. Dans les années 1920, des Boers s’installent dans l’ancienne colonie allemande. Aujourd’hui, les descendants des Boers représenteraient 60% de la population d’origine européenne. Il faut aussi mentionner les Basters-Witboois de Rehoboth composés de populations autochtones métissées de Boers-Afrikaners.
Margarete von Eckenbrecher
Christine de Gémeaux organise son ouvrage autour de Margarete von Eckenbrecher Elle est originaire de Saxe, fait des études d’institutrice, épouse un officier ; ils acquièrent une ferme et s’installent dans le Sud-Ouest africain en 1903. Le gouvernement allemand encourage la colonisation fémine ; des écoles de formation des futures femmes-colons sont créées ;il s’agit d’atténuer le déséquilibre hommes/ femmes, de limiter le recours à la prostitution ( les prostituées du Sud -Ouest africains sont terriblement maltraitées) et de limiter les unions mixtes entre Européens et indigènes. Quoi qu’il en soit le couple s’installe dans une ferme au nord de Windhoek. Il s’agit essentiellement d’une ferme d’élevage ; la vie y est extrêmement rude. Mais surtout Margaret partage l’idéologie nationaliste et racialiste « völkisch » de la plupart des colons. Il s’agit de mener « une croisade civilisatrice, moralisatrice et hygiéniste ». Margarete met l’accent sur les bienfaits apportés par les colons aux Africains et aux Africaines. Elle décrit les peuples africains de la colonie. Elle connaît surtout les Hereros, dont certains travaillent dans l’exploitation agricole, qu’elle décrit comme orgueilleux et fourbes Elle n’éprouve pas d’empathie pour eux et les considère comme des peuples « inférieurs » destinés à être contrôlés. Certains colons mais peut -être pas Margarete et son mari utilisent le fouet contre leurs travailleurs. Margarete est cependant sensible à la situation difficile des femmes hereros. Elle évoque le sort des Damaras qui ont été longtemps les esclaves des Hereros. Elle peut ainsi légitimer l’intervention « protectrice » des Allemands.
La séparation entre Blancs et Noirs est stricte. Dans l’empire allemand, comme dans l’empire britannique , seuls quelques colons considérés comme des originaux, épousent des femmes indigènes ou participent à la vie communautaire des indigènes. Les Britanniques les qualifient de « going native », ceux qui deviennent indigènes.
Les génocides au Sud- Ouest africain
A partir de 1903 l’opposition à la colonisation allemande s’intensifie. Elle s’explique par la dépossession des terres, la perte du bétail aggravée par les pestes bovines de 1897. Les Hereros ne supportent pas la perte de leur bétail mais surtout le viol des femmes africaines par les blancs et la mise en cause de leurs traditions sociales et culturelles. L’attaque des Hereros débute le 11 janvier 1904 . Des colons sont massacrés, mais les femmes, les enfants et les pasteurs sont épargnés. Margarete Eckenbrecher est témoin de l’insurrection. Elle raconte l’attaque des fermes, le pillage du bétail; elle évoque ses tentatives de négociation avec un chef nama, puis la manière dont elle se réfugie dans une caserne désertée. De leur côté les Hereros sous-estiment les forces allemandes et pensent qu’ils vont chasser les colons. Les troupes allemandes parviennent à reprendre le contrôle de la région après de durs combats. Margarete quitte la colonie avant le génocide. La révolte des Hereros conduit les plus radicaux des Européens à envisager non pas une victoire mais une extermination de masse. Le nouveau gouverneur Lothar von Trotta est connu pour sa brutalité. Le 11 août 1904 une bataille oppose les troupes allemandes aux Hereros sur le plateau du Waterberg. Vaincus, les Hereros s’enfoncent dans le désert où ils sont pourchassés et mitraillés. Les femmes et les enfants sont écartés des points d’eau Mais les troupes allemandes qui elles aussi souffrent de la soif et de la maladie ne parviennent pas à détruire les Hereros. C’est alors que naît l’idée d’extermination. Trotta publie un ordre d’extermination le 2 octobre 1904 :» Tout Herero découvert dans les limites du territoire allemand ( …) sera abattu ». Bien que l’ordre ait été révoqué par Guillaume II dès décembre 1904, la politique exterminatrice se poursuit. Les survivants, environ 15000 personnes, sont enfermés dans des camps de concentration, le plus meurtrier étant celui de l’ Ile aux requins. Ils souffrent de la faim, de maladie et sont loués à des colons. Les crânes sont envoyés à Berlin et le « père « de l’anthropologie génétique allemande, Eugen Fischer, se rend même sur place.80% des Hereros périssent.
Un sort comparable touche les Namas. Après avoir soutenu les Allemands contre les Hereros , les Namas prennent conscience du sort qui les attend et prennent les armes en 1904-1905. Les Namas mènent une guerre de guérilla mais les actions sanglantes conduites par Trotta conduisent à la capitulation des Namas le 3 février 1906. La moitié de la population nama disparaît. Les terres sont confisquées.60000 Hererros et 10000 Namas périssent La population de la colonie passe de 200000à 100000 habitants. Les populations indigènes sont étroitement contrôlées ; par exemple, les autochtones de plus de sept ans doivent porter une médaille gravée avec leur numéro matricule. Les exactions commises par les troupes allemandes provoquent de vifs débats au Reichstag. Les centristes et les socialistes dénoncent les violences. Les débats provoquent la chute du gouvernement, de nouvelles élections en 1907 et l’arrivée au pouvoir de ministres qui mènent une politique plus modérée. Dans la colonie, la révolte provoque une radicalisation de la plupart des colons qui soutiennent une politique de « gestion raciale » des indigènes. Margarete, après avoir séjourné en Allemagne, puis dans les colonies d’ Afrique orientale rentre au Sud-Ouest africain en mai 1914 ; elle s’installe alors à Windhoek.
Un débat historiographique
Le génocide des Hereros et des Namas a longtemps été passé sous silence mais dans les années 1990 un romancier Uwe Timm dans son roman Morenga et un historien, Jürgen Zimmerer. ont évoqué les génocides. Plus récemment, en 2023, le film de Lars Kraume « L’ homme mesuré » a évoqué les génocides et évoqué les travaux des « craniologues « allemands (le film a été diffusé sur Arte en octobre 2024). Un double débat historiographique a pris naissance. Doit-on considérer le génocide comme spécifiquement allemand et peut-on rapprocher le génocide de la Shoah sans banaliser cette dernière ? Plusieurs éléments pourraient plaider pour un caractère spécifiquement allemand (un « Sonderweg ») du génocide : la dureté et la rigidité de la formation militaire du Reich allemand, héritée de la formation militaire prussienne, la volonté de coloniser des terres d’abord en Afrique, puis pour les nazis à l’est de l’ Europe, le mépris pour les peuples considérés comme inférieurs. D’autres continuités peuvent être soulignées : certains membres du « Schutzgruppe » qui opérait en Afrique se sont retrouvés dans les milices nazies, un « anthropologue » ( » craniologue » serait sans doute plus exact) qui étudiait les crânes des Hereros et des Namas a également travaillé dans l’Allemagne nazie, le père d’ Hermann Göring avait été gouverneur du Sud- Ouest africain sans être cependant impliqué dans le génocide. Cependant l’auteure est très réservée sur la spécificité allemande du génocide.Elle considère que les Allemands ont poussé à l’extrême des politiques menées par d’autres puissances coloniales. Elle souligne que des massacres ont été commis par d’autres puissances coloniales, comme le Royaume-Uni au Kenya. Parler de génocide dans le Sud-Ouest africain conduit–il à banaliser la Shoah ? Dès les années 1950 Aimé Césaire avait souligné que des crimes comparables à ceux des nazis avaient été perpétrés par les colonisateurs. L’auteure souligne également que, comme les nazis, les militaires coloniaux euphémisaient leurs actions en parlant par exemple d » expéditions punitives ». Pour l’auteure, il n’y a pas de différence de nature entre les génocides coloniaux et le génocide contre les Juifs : il s’agit d’une différence de radicalité et sans doute de préparation, de planification. « Par rapport aux génocides coloniaux, le génocide anti-juif se distingue par un degré d’exécution inédit, manifestation d’un radicalisme raciste exacerbé « ( p 107)
La première guerre mondiale et la défaite allemande marquent la fin de l’empire colonial allemand. L’Union sud-africaine, malgré l’opposition des Boers, rejoint les Alliés et attaque la colonie allemande. La disproportion des forces est notable et conduit à la capitulation des troupes allemandes en juillet 1915. Les populations autochtones ne demeurent pas passives et accueillent les troupes sud-africaines en libérateurs. Les Sud-Africains créent une commission d’enquête chargée d’étudier les exactions allemandes contre les Hereros et les Namas. Le « Blue book » publié à Londres en 1918 permet d’opposer le sens de la justice britannique à la politique raciale allemande. Le Traité de Versailles prive l’Allemagne de ses colonies. Le Sud-Ouest africain est placé sous mandat de la SDN attribué au Royaume-Uni qui en confie l’administration à l’Union sud-africaine. Pendant la durée du mandat (1920-1946 ) puis jusqu’à l’indépendance en 1990, le Sud-Ouest africain est gouverné depuis Pretoria qui exploite les richesses locales. La politique sud-africaine est moins brutale, mais les indigènes paupérisés sont soumis à des amendes ou doivent s’installer dans des réserves. Les révoltes sont matées. Sans surprise, Margarete, qui enseigne alors dans une école germanophone oppose le matérialisme des Britanniques à l’oeuvre « civilisatrice » et « moralisatrice » des Allemands. La France n’est pas entièrement absente de ses préoccupations. En 1921, l’attribution du prix Goncourt à l’écrivain martiniquais René Maran pour son roman Batouala suscite son hostilité.
Après la Seconde guerre mondiale et la dissolution de la SDN en 1946, l’Union sud-africaine conserve l’administration de l’ancienne colonie. Comme en Afrique du Sud, elle pratique une politique d’apartheid. Windhoek est divisée en trois entités, pour les Noirs ( le quartier de Kantura « le lieu où on ne veut pas vivre « en herero ) , les métis et les Blancs. A partir des années 1960 un mouvement indépendantiste, la SWAPO ( South West African’s People Organization ) se développe et mène une lutte armée dans le nord du pays .Les femmes y jouent un rôle qui n’est pas négligeable. En 1968, l’ ONU met officiellement fin au mandat de l’ Afrique du Sud qui continue cependant à l’administrer. La lutte de la SWAPO, soutenue par Cuba, s’inscrit dans le cadre des luttes de la guerre froide en Afrique australe : victoire du mouvement communiste en Angola, affaiblissement de l’ Afrique du Sud. La Namibie devient indépendante en 1990.
Les enjeux mémoriels
Face à une histoire si complexe et si tourmentée, on imagine aisément que les enjeux mémoriels sont importants. Deux aspects peuvent être analysés : la mémoire de l’histoire coloniale sur le territoire namibien et les relations entre la Namibie et l’Allemagne. Les Hereros et les Namas commémorent le génocide et rendent hommage à leurs chefs victimes du colonialisme allemand. Les Namibiens descendants de colons allemands commémorent plus discrètement qu’autrefois, la bataille du Waterberg qui opposa les troupes allemandes aux Hereros. La statue du gouverneur Curt von François qui se trouvait au milieu de la capitale Windhoek a été déboulonnée et placée dans un musée. De même, une statue à la gloire des colonisateurs a été remplacée par la statue d’un couple de Namibiens brisant leurs chaînes. Les relations entre la Namibie et l’Allemagne sont complexes. La bataille mémorielle débute en 2004 lors du centenaire de la commémoration de la bataille du Waterberg. La ministre allemande de la coopération de l’époque a demandé le pardon du pays et appelé toutes les parties à la réconciliation. Une étape décisive est franchie lorsqu’ en mai 2021 le ministre des Affaires étrangères allemand Heiko Maas a reconnu officiellement le génocide. L’Allemagne s’est engagée à verser plus d’un milliard de dollars en trente ans à la Namibie. Dès lors se pose la question de la forme de ces réparations. Elle peut prendre la forme d’aide publique au développement, ( c’est le choix du gouvernement allemand) mais dans ce cas elle bénéficierait surtout aux Ovambos qui contrôlent le gouvernement et qui sont majoritaires. Les Héréros et les Namas souhaiteraient une indemnisation dont ils seraient les bénéficiaires directs. Enfin, la Namibie met l’accent sur la restitution d’objets et d’archives volés qui se trouvent encore souvent à Berlin. Depuis 2022 des objets spoliés ont été restitués à la Namibie. La question de la restitution des ossements, notamment ceux des internés, reste posée. Ces demandes s’inscrivent dans le cadre de devoir de justice, de mémoire matérielle.
.