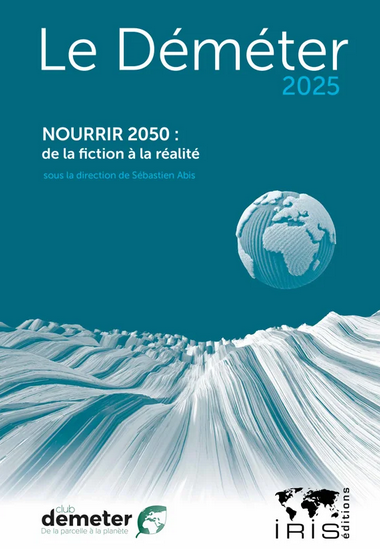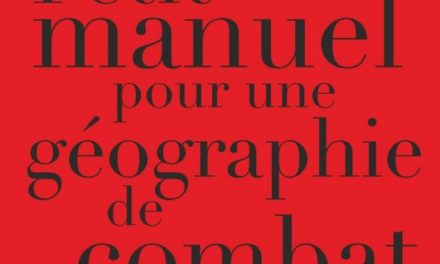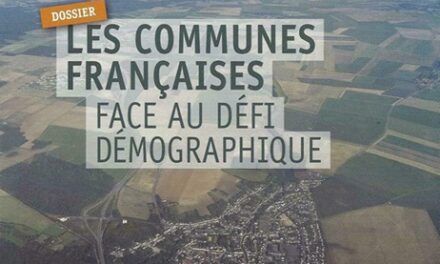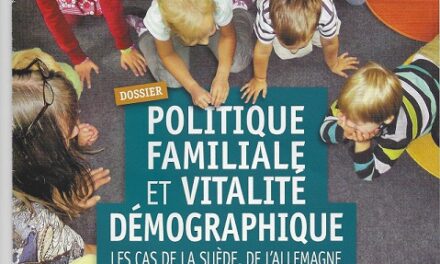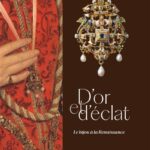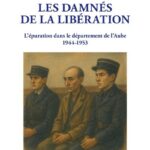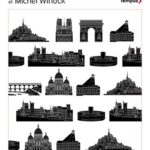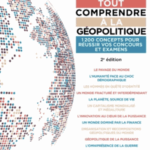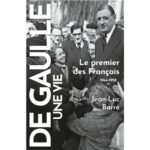La revue annuelle Le DéméterDont les précédents numéros ont été chroniqués pour la Cliothèque depuis 2019 a choisi cette année une démarche prospective, horizon 2050.
Demain l’agriculture
Sébastien Abis, dans cette introductionconsultable ICI : Nourrir le futur à l’ombre des hippopotames, reprend un thématique déjà abordée dans son ouvrage : Veut-on nourrir le monde ? (Armand Colin, 2024). Avant de regarder à l’horizon 2050, il propose un arrêt sur image en 2025 qui s’impose dans un monde troublé par les réalités géopolitiques et les évolutions du climat. En choisissant l’hippopotame, ce n’est pas au place ruminant qu’il évoque, mais l’animal puissant par sa taille et son poids prêt à tout pour défendre son territoire et aux charges imprévisibles qui n’est pas sans rappeler un contexte actuel où la loi su plus fort est de retour.
L’auteur s’interroge sur les positions européennes dans ce monde de plus en plus brutal quand, pourtant, une nécessité s’impose : nourrir une population mondiale toujours plus nombreuse.
Agrosphères – Renversements géoéconomiques
Banque et finance en 2050 : le grand Braquage ?
Pascal Ordonneau, Secrétaire général de l’Institut de l’Iconomie, revient sur l’institution bancaire et son évolution depuis de XIXe siècle. Il propose sa vision de la banque dans 25 ans : des services aux particuliers et aux entreprises dans un monde hypertechnologique. C’est aussi un monde où les vols de données sont courants et les risques des monnaies digitales : une réalité.
Il imagine que, malgré les évolutions, le dollar reste inévitable, cependant concurrencé par des monnaies digitales crées par les Brics, Chine en tête. Il voit un FMI rénové, garant de la transparence et de l’intégrité des flux monétaires dans le monde. Résolument optimiste, il voit le monde bancaire impliqué dans la lutte contre le changement climatique.
Les États-Unis d’ici 2050 : déclin de la puissance ?
Thierry Pouch, dans cet article manifestement écrit avant la prise de fonction de Donald Trump, dresse un tableau de l’organisation du monde par et pour les États-Unis, des années 1930 à aujourd’hui, qui est un bon résumé de la période. L’auteur montre les éléments de faiblesse : un dollar fragilisé, une contestation de l’hégémonie américaine après les attentats du 11 septembre.
Dans sa réflexion prospective il propose plusieurs scénarios :
- Une relance de la puissance qui reposerait sur la planification écologique de Biden
- Un déclin face à l’expansion chinoise et à sa politique visant à faire du Yuan une monnaie de référence dans les échanges internationaux, un creusement de l’endettement fédéral et de la balance commerciale
- Une hégémonie bipolaire YAS/Chine.
Percées scientifiques
Intelligence artificielle et bon sens paysan : choc ou alchimie à venir ?
Il s’agit d’un entretien entre Vindicien Delcourt, Christian Germain et André Loesekrug-Pietri qui montre quelques pistes de recherches, notamment en France (Cirad, IRD, INRIA), à propos de robotique. Le développement en France est limité par l’absence de grande entreprise du numérique. Christian Germain insiste sur la nécessité d’une formation dans les collèges et les lycées même s’il existe déjà quelques éléments dans la formation des ingénieurs agronomes.
Ce qui freine le développement de l’IA agricole, c’est la nécessité de créer les jeux de données nécessaires, et ce d’autant plus que nous sommes dans un contexte de variabilité climatique. En matière de robots, aujourd’hui, ils peuvent permettre de gagner du temps, mais ils sont très onéreux. C’est l’une des difficultés de l’IA, être rentable et plus performante que les connaissances précises d’un terroir, accumulées au fil des générations.
Deux encarts traitent de L’intelligence artificielle au service des agricultures européennes par Hervé Pillaud et L’alimentation en 2050 : la grande révolution ? par Marie Dollé et Olivier Frey.
La France agricole d’ici 2050 : escale sur l’innovation
Christian Huyghe, chercheur à l’INRAE, avertit le lecteur dès les premières lignes « le récit qui suit est purement fictionnel, mais s’appuie sur des éléments de la littérature scientifique et technique » (p. 107)
Il situe sa prospective en 2040 en Beauce en s’appuyant sur les divers scénarios du GIEC, à +6° même si la transition énergétique a permis de limiter les émissions de CO2. Il prévoit une réduction de l’emploi des fongicides chimiques qui rend indispensable le contrôle des mycotoxines dans les grains après récolte. Il montre une agriculture transparente dans ses méthodes, ultra connectée qui s’est adaptée au changement climatique grâce à un choix de variétés adaptées à la chaleur. C’est aussi une agriculture qui mesure ses émissions pour tenir compte des limites planétaires, avec par exemple, une forte diminution de l’emploi des engrais azotés de synthèse et le recours aux légumineuses pour maintenir la fertilité des sols. L’auteur décrit des associations de cultures et une évolution des engins agricoles. Ces techniques ont permis de maintenir les rendements en blé au niveau des années 1990. Il évoque la question des adventices résistantes aux herbicides, les bandes fleuries et la production d’énergie photovoltaïque.
Urgences climatiques
Les démocraties face aux batailles climatiques
Les démocraties sont sont-elles à la hauteur de ce défi ? Telle est la question que pose Pierre BlancGéopolitique et climat, Presses de Sciences Po, 2025. Elles semblent peu aptes à prendre des décisions en faveur du climat, car leur action se situe dans le présent. Elles ont pourtant des atouts : une science libre et des mobilisations citoyennes.
Au plan pratique, les démocraties sont en avance en matière de politiques d’atténuation des effets du changement climatique, de politiques de décarbonation. C’est notamment le cas de l’UE. La Russie et même la Chine, malgré la doxa d’une Chine civilisation écologique en 2060, semblent moins engagées.
Les menaces qui pèsent sur les démocraties sont un national-populisme climatosceptique et électoraliste, le poids des ressources nécessaires à la décarbonation et qui génère des dépendances vis-à-vis de régimes autoritaires
« La question climatique appelle plus que jamais le réchauffement d’un multilatéralisme en crise profonde. » (p. 150)
Un encart d’ Antoine Buéno : La démocratie directe, seul salut climatique
Monarchies du Golfe : incontournables sur l’échiquier alimentaire mondial d’ici 2050 ?
Delphine Acloque et Jérôme Lavandier proposent un scénario pour les pétromonarchies, s’unir pour changer le monde agricole et alimentaire en investissant localement et à l’étranger, dans ce secteur vital pour ces pays dans un contexte de risques climatiques et géopolitiques.
Le raisonnement s’appuie sur des exemples précis en matière et stockage et de transformation des céréales, investissement dans des grands groupes (ex de la SALIC, ou des investissements en Australie pour la production de viande). Ces pays investissent également dans l’innovation agricole (culture sous serre au Qatar, aquaculture). Ces politiques visent à assurer leur sécurité alimentaire dans un espace test du changement climatique. En 2050, la péninsule arable sera-t-elle inhabitable ? Sera-t-elle le lieu de réfugiés « technocisés », grâce à la géo-ingénierie comme ensemencement des nuages ? L’article se termine sur un tableau comparatif en 2050 entre version positive et disruptive et version négative et risques associés.
À noter un encart d’Arnaud Lacheret et Maxime Bos : Émancipation des femmes saoudiennes et entrepreneuriat : une révolution en cours ?
Retours géopolitiques
2050 : l’insécurité alimentaire mondiale inévitablement amplifiée ?
Marine Raffray présente plusieurs trajectoires d’évolution de la faim. La période 2000-2022 a vu baisser les taux de pauvreté dans le monde, mais stagner la sous-alimentation autour de 10 % de la population. Elle récuse le seule dimension démographique pour expliquer cette évolution. Dans les projections qu’elle imagine, elle intègre la dimension géopolitique, rappelant qu’en 2023 les principales causes d’insécurité alimentaire étaient les conflits locaux, la crise économique et le changement climatique, 282 M de personnes dans 59 pays.
Quelle sera la demande alimentaire en 2050, pour une population estimée par les Nations unies d’environ 1,3 milliard d’habitants en 2080 ?
L’autrice s’appuie sur les recherches qui existent (INRAE, CIRAD, FAO…) pour construire ses scénarios.
Le scénario tendanciel prévoit 9,7 milliards d’hommes avec une demande alimentaire en hausse (+50 % par rapport à 2010) et notamment de produits transformés. Mais la hausse des rendements demeure plus faible que celle de la population et engendre une extension des terres cultivées et des pâturages, surtout en Afrique subsaharienne et en Amérique latine. Selon la FAO, la sous-nutrition toucherait plus de 680 millions de personnes.
Le scénario d’une montée des « souverainetés adverses » : la montée des nationalismes et des conflits serait liée à la recherche de sauvegarde des approvisionnements, notamment alimentaires dans un monde à 10,1 milliards d’individus. On assisterait à une hausse des inégalités et à une pression accrue sur les terres agricoles dans un contexte de risques climatiques accrus. 750 millions de personnes vivraient sous le seuil de pauvreté.
Le scénario de transition systémique : c’est un scénario de rupture, de transition démographique grâce à l’éducation, mais avec une urbanisation accrue (75 % de la population) avec optimisation des transports et du foncier. L’autrice prévoit une baisse de la dépendance aux énergies fossiles, une augmentation des surfaces agricoles, mais une baisse des pâturages grâce à une diminution de la consommation de viande. Un scénario peut-être utopique.
Le scénario libéralisme et haute technologie : il est marqué par des inégalités renforcées (énergie décarbonée dans les pays développés et énergies fossiles dans les pays en développement), le développement de la robotisation et de l‘usage du numérique, mais 1/3 de la population mondiale sous le seuil de pauvreté avec une insécurité alimentaire pour 42 %.
En conclusion : des réflexions à poursuivre.
Encarts : Précarité alimentaire et faim : un impensé dans les pays riches par Bernard Valluis et Guyane : futur modèle de sécurité alimentaire durable ? par Margaux Louis
Réveils d’Asie centrale : confirmer ou disparaître
Michaël Levystone dresse un tableau de la région en cours de reconstituer une zone de cohésion dans une monde en crise (Afghanistan, Ukraine, Caucase), mais sous influences russe et chinoise.
En 2050, l’auteur voit une région en danger avec des prévisions climatiques alarmistes : fonte des glaciers et donc de la disponibilité en eau, sécheresses et tempêtes de sable qui entraîneraient des migrations climatiques, des agricultures menacées par le stress hydrique, y compris pour le grenier à blé du Kazakhstan. Il y aurait aussi des risques politiques
Équations sociodémographiques
L’Inde en 2050 : superpuissance mais impuissance agricole ?
Catherine Viens et Marwan Attalah montrent l’importance du secteur agricole qui emploie la moitié de la population active et représente 17 % du PIB. Cette agriculture est soumise à des défis majeurs, entre pénurie alimentaire et échec de la Révolution verte : libéralisation, endettement paysan, non reconnaissance du travail des femmes. Les autrices analysent les programmes de soutien et les tentatives de réformes. Bilan : l’Inde autrefois importatrice de nourriture est devenu un exportateur de riz et de légumineuses. Ces exportations sont un outil dans les relations internationales, cependant, en 2024/2025, les exportations de blé ont été interdites.
Si on se projette vers 2050, l’Inde pourrait compter 1,7 milliard d’habitants, un défi entre chaleur et précarité des agriculteurs. Le gouvernement Modi a fait des promesses écologiques et agricoles pour viser l’autosuffisance alimentaire, développer le stockage et lutter contre le changement climatique, elles sont peu crédibles. Sans amélioration du sort des agriculteurs, des conflits internes sont à craindre. À l’échelle nationale, la question de la sécurité alimentaire est un enjeu important qui impose de concilier libéralisation et protectionnisme. Il existe des avancées en matière d’agroécologie comme le montre l’exemple de l’ pour le développement de l’agriculture biologique. Les recherches en matière de technologie et de digital ne sont pas absentes (projet IA Saagu Baagu, soutenu par la fondation Bill Gates). Un engagement fort de l’État est nécessaire.
Deux encarts : Pénurie de main-d’œuvre : une menace pour le riz asiatique (Chine, inde, Indonésie, Bangladesh) par Alain P. Bonjean et L’aquaculture en Inde, un avenir durable à l’horizon 2050 ? par Claire de Marignan.
Regard d’avenir
Pakistan: A Future Food and Agricultural Power in 2050?
Dans cet article à plusieurs mains, Matthieu Brun, Muhammad Ayaz Khan et Mazhar Mughal analysent la situation de l’agriculture pakistanaise entre souveraineté alimentaire et cultures illicites (cannabis, opiacés). Ils abordent le commerce international des céréales, perturbé par la guerre en Ukraine et ses conséquences : augmentation des prix des denrées alimentaires et de la pauvreté.
Carte : Pakistan: Between Food Production and Water Issues (p. 298)
Fruits rouges : l’irrésistible ascension sur nos étals
André Barlier et Jérémy Denieulle, avec Matthieu Serrurier montrent un marché en pleine expansion dans le monde : la production de myrtilles à augmenté de 480 ù entre 2000 et 2022. Ce sont des cultures qui évoluent vers le hors-sol, mais aussi avec de nouveaux producteurs : Russie, Chine où la demande intérieure flambe, Pérou, Chili qui produisent d’abord pour l’exportation
Carte : Myrtilles, framboises, cassis et groseilles : des petits fruits rouges stratégiques (p. 311)
Malgré la croissance de la production européenne : France et aussi de nouveaux producteurs (Ukraine, Géorgie, Kosovo), l’Europe importe toujours plus.
Carte : Principaux producteurs de cassis dans l’UE (et le Royaume-Uni) (p. 320)
Ce sont des productions fragiles dans le contexte du changement climatique.
Encarts : Le coton en Éthiopie, une nouvelle frontière agricole par Jean-Baptiste Damestoy et Le sucre bio : solution pour l’agriculture d’outre-mer par Olivier Antoine
Les banques de ressources génétiques, sentinelles de notre alimentation
Alain P. Bonjean introduit son article par une cyberattaque au Svalbard, en 2050. Il rappelle l’histoire de la préservation des semences. Cette base de données essentielles dans le monde qui vient devrait être étendue aux algues et nécessite un financement croissant. Ce sont des données à protéger. Le site du Svalbard accueille plus d’1,3 milliard de semences.
Carte : Sites soviétiques détenant des ressources génétiques pillés par les SS début 1943, dont les collections furent dispersées en Autriche nazie (p. 340)
Carte : Principales banques de gènes actuelles ex situ (p. 344)
Encarts : Acides aminés : bientôt tous chinois ? par Aymeric Beaumont
On retrouve, comme dans chaque éditions des repères statistiques avec en particulier :
- la noix française dans la compétition mondiale, les plantes à parfum, aromatiques et médicinales : une croissance durable ?
- Le marché carbone : une opportunité pour l’agriculture et l’agroindustrie ?
- La consommation alimentaire des Français : un concentré du monde.
Le Prix DEMETER 2024 a mis en valeur l’étude d’ Eva Barré : Changement climatique : la solidarité internationale mise à rude épreuve et La Chine, fossoyeur de l’industrie du bois français ? Par Agathe Denisselle, Maxence Dubaele, Adrien Gillion, Mélanie Lam-Wai-Shun et Antoine Nicolas.