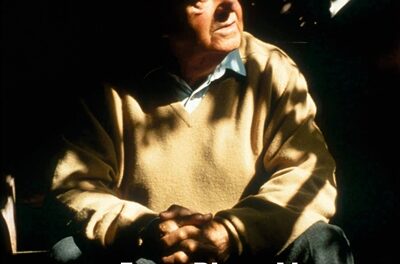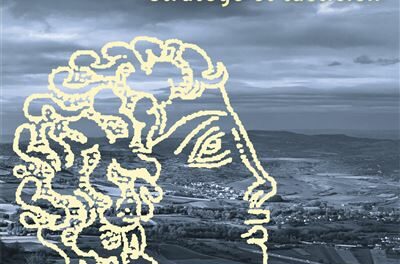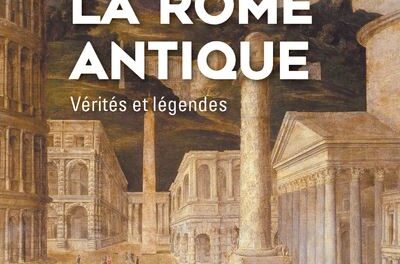Nihil novi sub sole (« Rien de nouveau sous le soleil… »). L’utilisation d’armes bactériologiques ou de gaz toxiques ne constituent pas des nouveautés ou des infractions au regard des prétendues lois de la guerre. Comme nous le montre Adrienne Mayor, chercheuse en histoire des sciences et en lettres classiques, « miel toxique, flèches enduites de venin de serpent, plantes mortelles, catapultage de ruches, de pots d’argile remplis de scorpions vivants, cochons enflammés lâchés contre des éléphants de guerre, empoisonnement des puits, diffusion volontaire de la peste, création de nuages de poussière caustique, propulsion de flammes inextinguibles » … constituaient des pratiques relativement courantes déjà dans l’Antiquité. L’ouvrage se veut ambitieux puisqu’il traite aussi bien des pratiques grecques que romaines, perses et chinoises, indiennes ou arabes ; il se permet même, malgré son titre, certains développements jusqu’au milieu du Moyen Âge. S’appuyant aussi bien sur les mythes, les récits d’historiens ou de récentes découvertes archéologiques, l’auteur établit ainsi des liens permanents entre Antiquité et période contemporaine et pose la question d’une prétendue moralité de la guerre.
Depuis la fin de la guerre froide, et plus particulièrement à la suite des attentats du 11 septembre, les chercheurs s’interrogent sur les mutations de la conflictualité. Comme le rappelle Adrienne Mayor, les attaques aux lettres empoisonnées à l’anthrax qui semèrent la panique aux États-Unis en 2001 furent ainsi présentés comme un phénomène de guerre biochimique « uniquement moderne ». L’objectif de cette historienne anglo-saxonne est au contraire de nous montrer que les formes de guerre dites « non conventionnelles », telles qu’elles ont pu être définies au XIX et XXe siècle, constituent en réalité un phénomène très ancien. Comme le prouvent notamment les multiples expériences menées par des scientifiques modernes pour reconstituer les armes antiques, comme la composition de certains poisons, il s’avère que les Anciens étaient en réalité très « modernes ». Et inversement, les combattants modernes ne feraient finalement que reprendre de vieilles recettes améliorées grâce aux progrès de la science. Adrienne Mayor explique notamment comment Newsweek s’est inspiré de ses propres travaux pour attribuer faussement à Saddam Hussein la production des « bombes à scorpion ». Mais en 2014, l’Etat islamique reprit l’idée pour terroriser des villages irakiens. La « guerre non conventionnelle » constituerait d’une certaine manière la forme la plus traditionnelle de la guerre. Au-delà de l’aspect anecdotique, l’auteur montre comment l’apparition de ces formes de guerre non conventionnelle a permis aussi le développement d’une éthique de la guerre, et comment le recours à des pratiques déloyales a posé aussi la question de leur encadrement et de leurs limites.
Les armes biologiques
Dans une première partie, Adrienne Mayor s’intéresse tout d’abord à l’invention des armes biologiques. Partant du cas d’Héraclès et de l’Hydre de Lerne, elle dresse l’inventaire des différents poisons d’origine naturelle utilisés aussi bien dans la mythologie que dans l’Antiquité.

Lernaean Hydra Louvre CA7318
Contrevenant à la représentation que les Grecs pouvaient se faire de leurs propres comportements guerriers, elle rappelle que le mot « toxique » dérive de toxon qui signifie la flèche. Le fait d’empoisonner ses flèches au venin de serpent était vraisemblablement une pratique plus courante qu’on ne pourrait a priori le penser. Elle poursuit cette réflexion dans la deuxième chapitre consacré aux « flèches du malheur » et précise la composition des poisons utilisés, à base par exemple de plantes comme l’hellébore ou l’aconit. Elle rappelle d’ailleurs qu’Ulysse aurait succombé à une blessure infligée par une lance munie d’une épine de raie. Le recours aux poisons déversés dans les réserves d’eau fait l’objet du chapitre suivant. Le premier cas historiquement documenté est celui de la ville de Kirrha : en 590 av. n. è., les conduits d’eau qui alimentaient la ville auraient été empoisonnée par l’hellébore. L’auteur évoque aussi des « vapeurs mortelles » émis par les marais, propagateur de maladies, et rappelle à quel point l’eau croupie et les maladies qui y sont associées, comme le choléra ou le paludisme, ont pu détruire des armées entières.
« un coffret contenant la peste dans le temple de Babylone »
La partie suivante, intitulée « un coffret contenant la peste dans le temple de Babylone » développe un aspect surprenant, celui des armes bactériologiques. Sans posséder de véritables connaissances en épidémiologie, les Anciens auraient réussi à propager certaines maladies chez leurs ennemis, notamment en catapultant des cadavres au-dessus les murailles des cités assiégées ou faisaient appel à des dieux comme Apollon qui apporte la peste grâce à son arc. Après l’eau, « les hostilités sucrées » s’intéressent à la nourriture comme arme. Le cas emblématique est celui du « miel qui rend fou » des rives de la rive de la Mer Noire, provoqué par un empoisonnement au rhododendron. L’auteur cite aussi les nombreux cas où les banquets et les rasades de vin ont pu servir à éliminer des ennemis trop gourmands. Les derniers chapitres sont sans doute les plus succulents.

Dans les « animaux comme alliés », Adrienne Mayor revient sur certaines d’inventions étonnantes, comme les « bombes à essaim d’abeilles » ou les « bombes à scorpions ».
L’exemple le plus étonnant, ce sont sans doute, ces cochons enflammés lancés contre les éléphants de guerre à l’époque hellénistique. Enfin, « le feu infernal » souligne l’ingéniosité des Anciens, capables de développer des flammes inextinguibles, et qui débouchera notamment sur l’invention du feu grégeois. La fumée est aussi considérée comme une arme capable de désorienter ou d’asphyxier l’ennemi.

Codex Skylitzes Matritensis, Bibliteca Nacional de Madrid, Vitr. 26-2, Bild-Nr. 77, f 34
L’intérêt de cet ouvrage est de mettre l’accent sur certains aspects de la guerre antique qui ont pu parfois être négligés. On parle beaucoup des poisons de Mithridate, mais très peu par exemple du « miel qui rend fou » qui aurait affaibli les troupes romaines en marche contre les armées du roi du Pont.
Cependant, par sa volonté d’exhaustivité, ce livre s’apparente par certains côtés à un inventaire à la Prévert et n’évite pas

Artus Quellinus, (1609-1668), Apollon et Python. Collection fondation Roi Baudouin,
certaines répétitions. La volonté d’effectuer des parallèles entre l’Antiquité et la période contemporaine ouvre parfois des perspectives intéressantes, notamment sur l’utilisation des animaux dans la guerre, mais cela confine souvent à notre goût à l’anachronisme. De plus, par sensationnalisme, l’auteur a tendance à utiliser à outrance le conditionnel, ou à pousser parfois ses idées un peu trop loin. Certaines hypothèses peuvent surprendre : on a du mal par exemple à croire que l’Arche d’Alliance ait pu être volontairement infectée par la peste afin que personne ne puisse s’en emparer, ou même que les temples d’Apollon aient pu être les gardiens d’ « un matériel biologique mortel » (p. 174).
Quoi qu’il en soit, l’auteur manifeste un sens certain de la pédagogie et un don pour la vulgarisation. Les cartes ou les chronologies qui accompagnent l’ouvrage aide le néophyte à se repérer au milieu des multiples guerres ou périodes évoquées, et surtout Adrienne Mayor possède un grand talent de conteuse. L’évocation de cochons enflammés lancés contre des éléphants en armure frappe l’imagination et on comprend très bien pourquoi les scénaristes de Game of Thrones se sont inspirés de sa description du feu grégeois pour la série. En bonne historienne, elle nous invite finalement à nous tourner vers le passé pour mieux penser le monde d’aujourd’hui.