Armand Colin présente la 4e édition de l’ouvrage Le monde grec à l’époque classique. Enseignant à l’université de Bordeaux Montaigne, spécialiste du monde égéen et de la démocratie grecque, P. Brun nous propose ici un manuel aux dimensions accessibles qui porte sur la période classique (500 – 323 av. J-C.), la plus célébrée de l’histoire grecque de par son héritage politique, intellectuel et artistique. L’introduction en précise les écueils et la philosophie : mettre en question « l’athénocentrisme » qui marque trop souvent les recherches en histoire grecque, le poids des représentations contemporaines dans la perception historiographique du classicisme grec et adopter une certaine réserve à l’égard du rôle civilisateur d’Athènes déjà observée dans d’autres ouvrages de P. Brun, notamment celui consacré à Démosthène.
GUERRE ET PAIX DANS LE MONDE GREC
P. Brun fait le récit dense d’un événementiel qui va des Guerres Médiques aux conquêtes alexandrines. Les guerres médiques voient s’opposer des cités grecques à un empire achéménide aux ambitions affirmées sur ses marges occidentales. Repoussant les Perses à Marathon (490), Athènes consolide dans la victoire le régime issu des réformes de Clisthène. Bien loin d’un front panhellénique, c’est au gré de leurs intérêts propres que les cités, malgré l’énorme supériorité militaire perse, triomphent de Xerxès à Salamine (480) puis Platées (479).
Les années qui vont jusqu’à la Guerre du Péloponnèse sont celles de l’apogée d’Athènes. Elle prend la tête de la Ligue de Délos et met provisoirement fin à la menace perse par la « Paix de Callias » (449). D’alliance défensive, la ligue se mue en instrument de la domination hégémonique d’Athènes. Les relations entre Sparte et Athènes se dégradent alors progressivement.
Pour décrire la Guerre du Péloponnèse qui les oppose (431 à 404), P. Brun emprunte à Mosse les termes de « guerre totale » et brutalisation. Jusqu’à la paix de Nicias de 421, point d’équilibre est atteint entre les victoires et les défaites, Mais Athènes s’engage dans une intervention désastreuse en Sicile (413) qui affaiblit la cité. L’instauration du régime Des Quatre-Cents (411) atteste de la fragilisation de la démocratie. La paix négociée fait rentrer Athènes dans l’alliance de Sparte et ses murs sont rasés. Brièvement, l’oligarchie revient avec le régime des Trente (404) mais les démocrates finissent par reprendre le pouvoir dans une cité durablement marquée.
Sparte, longtemps focalisée sur le Péloponnèse, est en position « gendarme du monde grec ». Son attitude impérialiste détériore ses relations avec les Perses (405) mais aussi ses voisines, dont Thèbes et Athènes, laquelle prend la tête de deux coalitions successives. Mais rien n’est simple dans les relations entre cités et la puissance thébaine devient suffisamment inquiétante pour qu’Athènes et Sparte fassent cause commune. La défaite inattendue de celle-ci à la bataille de Leuctres (371) met à bas l’hégémonie spartiate.
La période qui va de 371 à 338 devient donc celle d’une lutte pour l’hégémonie. Thèbes semble en mesure d’hériter de la puissance spartiate jusqu’en 362. Athènes, quant à elle, renoue avec une politique hégémonique mais la menace perse toujours présente, et une nouvelle coalition de cités ont raison de ses ambitions. Cette période voit aussi s’affirmer la puissance de la Macédoine, dont P. Brun nous rappelle la profonde hellénisation. Philippe II s’immisce de plus en plus dans les affaires intérieures de la Grèce et tente d’y nouer des alliances. Sa victoire à Chéronée (338) marque le début de la domination macédonienne (338-323).
En effet, Philippe II s’appuie sur la ligue dite de Corinthe pour lancer une expédition contre les Perses dont le motif invoqué, laver le sacrilège de 480, masque mal les intentions expansionnistes. Après son assassinat en 336, son neveu Alexandre hérite de ses ambitions. Il part pour l’Asie en 334. Les victoires s’enchaînent contre Darius : Granique (334), la prise de l’Egypte (332) où Alexandra accède à un statut de divinité, Arbèles (331)…
Mais les tensions apparaissent rapidement. Les difficultés de la conquête de certaines régions et le caractère illimité de sa soif de conquête, sa politique de métissage culturel, crispent contre lui les troupes macédoniennes. Vers 325, Alexandre amorce son retour avec pour tâche la stabilisation des cités grecques et la réorganisation d’un empire si vaste qu’y fleurissent les potentats locaux. Mais il meurt à 33 ans sans succession crédible.
Quel bilan tirer de son expédition ? Elle ne modifie pas profondément pas les structures politiques et sociales des régions conquises. Malgré la fondation de plusieurs Alexandries, il n’y a pas de réelle volonté d’helléniser les indigènes. En revanche une certaine conception politique de la cité se trouve ébranlée : l’hégémonie n’est plus centrée autour d’une ville mais d’un Roi qui a considérablement élargi les frontières de la culture hellénique.
LA VIE DANS LE MONDE DES CITES
Nées pour la plupart à l’époque archaïque, les polis sont le cadre de vie majoritaire, même si elles sont généralement de petites communautés. Entre 375 et 275, elles connaissent un maximum démographique.
Des cadres institutionnels variés
La royauté et la tyrannie, sa lointaine survivance, sont en déclin à l’époque classique. Elle peut néanmoins persister sous forme affaiblie, par exemple à Sparte. En aristocratie et oligarchie, une partie du corps civique est exclue du gouvernement de la cité sur des critères socio-économiques plus ou moins drastiques. Ces cités sont généralement gouvernées par un conseil et des magistrats, d’une part, une assemblée d’autre part. Le poids respectif de l’un ou l’autre déterminait une variété de nuances qui font dire à P. Brun que la frontière avec la démocratie n’était pas toujours si lisible.
En effet, la démocratie athénienne ne doit pas être généralisée ni idéalisée. La vision d’une citoyenneté restreinte à un petit nombre de privilégié ne heurtait en rien la pensée politique grecque. Bon an mal an, les classes dirigeantes se recrutaient parmi les plus fortunés. De plus, la parenthèse de l’élargissement du corps civique par Clisthène (508) se referme avec la réforme de 451, restreignant la citoyenneté aux enfants nés de deux parents athéniens. Elle repose enfin sur l’impérialisme rendu nécessaire pour la financer à un moment où se généralisent les indemnités (misthoi).
L’emprise du demos sur les institutions va néanmoins grandissante : contrôle étroit du travail des magistrats, création de l’ostracisme, réduction des prérogatives de l’Aréopage au profit de la Boulè, ouverture de l’archontat à la 5e classe sont présentées comme des gardes fous contre les dérives oligarchiques. Tout pouvoir émane de l’Ecclésia mais il ne faut pas sous-estimer la vie politique locale au niveau des assemblées de dèmes.
Les cités, soumises à des forces centrifuges du fait de leur éclatement géographique, se regroupent de diverses façons. Par des partages de citoyenneté plus ou moins élaborés (isoplitie ou sympolitie), des fusions de noyaux villageois (synoecisme) ou des confédérations de cités à finalité militaire (synmachies) dominées par une cité hégémonique. P. Brun conclue le chapitre sur l’idée que la royauté hellénistique n’est pas incompatible avec la cité. L’épopée alexandrine ne fera ainsi pas disparaître le modèle de la cité mais l’affaiblit considérablement en ce qu’elle met en évidence une impasse profonde : l’incapacité des villes à s’en remettre à des structures supra-politiques pour assurer leur défense sans verser dans une hégémonie autodestructrice.
Les sociétés
La citoyenneté grecque fonctionne sur le modèle de l’exclusion, le citoyen étant, peu ou prou, un homme de 18 à 20 ans ayant reçu la citoyenneté en héritage. La frontière entre citoyens et non citoyens est nette en démocratie mais plus floue dans les oligarchies comme Sparte. Les non-citoyens s’y déclinent en catégories plus ou moins associées à la gouvernance de la cité : hilotes asservis, périèques ou treisantes (privés de leurs droits pour avoir reculé au combat).
A Athènes, la citoyenneté confère aussi des droits exclusifs : la propriété ou bénéficier de certaines redistributions. Elle est, là encore, assortie d’obligations militaires et fiscales. La survie du régime doit autant à la phalange des hoplites, fantassins capables de payer près de 200 drachmes d’équipement, qu’à l’enrôlement croissant des plus pauvres sur les trières. Les valeurs citoyennes sont transmises par l’éducation. Qu’il s’agisse de l’éphébie athénienne ou de la rude éducation spartiate, elle permet l’acceptation d’obligations comme le paiement de l’impôt. L’eisphora à Athènes, se pérennise et sert à financer l’impérialisme maritime et le fonctionnement d’une démocratie où les indemnités se sont multipliées. Les liturgies (chorégies, évergésie, triérarchie) concernent les citoyens les plus fortunés.
Les non-citoyens sont d’abord des femmes. Privées d’éducation savante, frappées d’incapacités légales multiples au profit de tuteurs masculins, privées du droit d’exercer la citoyenneté, elles la transmettent néanmoins, surtout après la réforme de 451 à Athènes. Les étrangers sont frappés eux aussi d’incapacités diverses mais sont davantage présents dans les cités sous l’effet de l’accélération des échanges au IVe s. L’exemple le plus connu est celui des métèques d’Athènes qui y vivent contre le paiement d’une taxe et peuvent se voir attribuer individuellement et, à titre exceptionnel, certains droits comme servir dans la phalange. Quant aux esclaves, toujours plus nombreux en raison des guerres, vivaient par centaines de milliers dans l’Attique. Leur existence est la condition nécessaire de fonctionnement de la démocratie explique P. Brun afin de libérer du temps à la politique. Leur situation n’émeut pas autrement les contemporains et la Grèce classique ne connaît pas de soulèvement comparable à celui de Spartacus. De manière générale, la cité est donc très avare dans l’accord de la citoyenneté, ce qui n’allait pas sans créer des tensions.
L’économie
P. Brun décrit le débat entre primitiviste et modernistes comme dépassé. Le modèle de la cité est fondamentalement marchand mais il insiste sur la notion de rationalité économique : les échanges (matières premières contre produits transformés) ont pour but d’assurer la survie de cités qui ne sont pas autosuffisantes.
L’économie repose avant tout sur une agriculture très variée dominée par la trilogie vigne, blé, olivier mais qui se présente avant tout comme une polyculture vivrière. La période est marquée par de faibles progrès technologiques (dans l’outillage, l’irrigation, l’usage des engrais) et le manque de terres fertiles aisément exploitables en Grèce. La petite exploitation familiale où travaillent quelques esclaves est majoritaire même si pouvaient exister, de très grandes propriétés aristocratiques. La même exiguïté des structures de production se retrouve dans l’artisanat (cuir, bois, céramique…) où le petit atelier reste la norme. Cependant des personnalités comme Démosthène ont pu en diriger d’énormes où travaillaient des centaines d’esclaves. Ils correspondent à ces « nouveaux riches » vilipendés dans les pièces d’Aristophane lorsqu’ils en viennent à prendre un poids significatif dans la démocratie. Leur fortune s’appuie sur la possession de liquidités et la location d’esclaves.
Ces activités alimentent un commerce déjà important à l’époque archaïque et qui s’intensifie à l’époque classique comme en attestent l’augmentation du tonnage des navires et les progrès des infrastructures portuaires (au Pirée ou à Rhodes). Ils sont stimulés par une croissance urbaine lente mais régulière. Cette économie peut être considérée comme monétaire à partir du Ve s. Nombre de cités battent monnaie et son rôle s’affirme tant dans les échanges que le transfert de la propriété foncière, le paiement des mercenaires ou des indemnités civiques. L’essor de la monnaie provoque celui du secteur bancaire qui s’appuie sur le prêt et les activités de change déjà élaborés.
LE MONDE DE L’ESPRIT
La notion de classicisme dans le domaine de la culture n’a de sens que comme découpage chronologique. Face à l’ampleur des questions, P. Brun centre sa réflexion sur les liens entre art et épanouissement de la cité.
La culture
L’apparition de l’histoire comme genre littéraire accompagne l’essor de la pensée rationnelle dans un univers mental où la plupart des Grecs ne font pas de différence de nature entre passé mythique et historique. Avec, Hérodote, puis Thucydide le récit historique prend ses distances avec le récit homérique. Ils témoignent d’un changement d’époque où la volonté des hommes s’autonomise du registre divin et façonne les événements. Sans être niée, l’explication divine du monde recule mais les progrès de la raison ne se font pas sans contradictions ou reculades.
D’essence aristocratique, l’art de la rhétorique est en plein développement à la faveur de l’essor des institutions démocratiques à Athènes et de la reconnaissance du droit de chaque citoyen à la parole. Les sophistes comme Gorgias ou Prodicos deviennent des spécialistes de la parole publique. Hors du champ politique, l’éloquence est aussi mise au service des procédures judiciaires aux mains du peuple à l’Héliée ou des affaires privées. Des accusateurs publics professionnels, les sycophantes, peuvent vivre de leur talent d’orateur. Le Ve s. est également celui de la philosophie qui met petit à petit l’Homme au centre de ses réflexions. Des écoles philosophiques se développent au IVe s. (Académie, Lycée) autour de ces grands maîtres, comme Platon ou Aristote, qui enseignent aux élites athéniennes. L’origine variée des intellectuels athéniens illustre la circulation des idées en Grèce.
Le théâtre illustre aussi le lien entre art, politique et religion. La tragédie est le genre majeur à travers des auteurs comme Eschyle, Sophocle ou Euripide. Aristophane est le plus éminent représentant de la comédie. P. Brun montre que le théâtre est le prolongement direct de l’Ecclésia car les mêmes thèmes y sont débattus : nature de la démocratie, légitimité de l’impérialisme athénien, critique des dirigeants…
Enfin, l’art dit classique s’épanouit en Grèce. La sculpture représente l’art civique par excellence. Les œuvres des grands maîtres comme Phidias ou Praxitèle reflètent l’atmosphère intellectuelle de l’époque. Elles renoncent à l’hiératisme archaïque et privilégient la courbe et le mouvement au service de l’humanité des sujets. Et si la statuaire conserve cette dimension politique lorsqu’elle célèbre les mérites d’un roi plutôt que d’une cité avec la domination macédonienne, P. Brun note qu’elle revêt également au IVe s. une dimension purement esthétique et décorative. Enfin, l’architecture connaît elle aussi un essor sans précédent. Décrire le programme de construction de l’Acropole, sous l’égide de Phidias, Callicratès et Ictinos, est l’occasion pour P. Brun d’observer la façon dont l’art, reflet à l’époque archaïque de valeurs très aristocratiques, se met au service de celles de la cité.
La religion
La majorité des cultes est antérieure à l’époque classique. Le panthéon des 12 dieux traditionnels s’enrichit du culte des héros et de multiples divinités collectives. Elle se pratique dans le cadre privé, à l’échelle panhellénique des sanctuaires (ex : Delphes) mais surtout la religion civique connaît un apogée. Dans les cités comme Athènes, les lieux politiques sont sacrés, ils s’enrichissent de temples et d’autels. Leur gestion, particulièrement financière, est confiée à des magistrats élus. Les fêtes sacrées sont nombreuses et donnent lieu, partout, à des concours artistiques et sportifs, à des sacrifices et des banquets qui mettent en scène la communauté. Les Grandes Panathénées sont l’exemple le plus fameux. Ces cultes civiques se perpétueront, pour la plupart, jusqu’à la fin du paganisme. Mais au IVe s., ils déplacent leur objet de la cité vers la personne royale dans le sillage d’Alexandre.
Les pages les plus passionnantes de l’ouvrage, P. Brun les consacre à la « crise religieuse » qui affecte le Ve s. Le rationalisme en vogue amène une remise en question de la religiosité traditionnelle sous la plume d’intellectuels comme Xénophane, Démocrite, Anaxagore ou Critias. Ces penseurs développent une critique de la religion civique allant du scepticisme à l’impiété. Mais, à partir des années 440, ces positions sont vécues comme une forme d’hostilité aux valeurs de la cité. P. Brun montre comment, à Athènes, les malheurs nés de la Guerre du Péloponnèse sont perçus comme des malédictions divines. Ils provoquent un regain de religiosité et un recul du rationalisme grec. Le procès de Socrate pour impiété (399) s’inscrit dans ce contexte.
Une autre inflexion peut se lire au IVe s. : celui de la personnalisation du rapport aux Dieux qui se superpose aux formes collectives et codifiées de la piété. Consultations d’oracles sur demande individuelle, utilisation croissante de tablettes de défixion, adoption de nouveaux dieux orientaux supposant des cultes plus directs sont autant de signe de l’intériorisation de la croyance. Comme si les divinités poliades ne suffisaient plus à satisfaire les craintes et les aspirations spirituelles en temps de crise…
CONCLUSION
L’ouvrage se conclue sur une intéressante réflexion sur la périodisation. P. Brun met en évidence les différentes représentations qui ont orienté l’historiographie contemporaine dans sa perception du classicisme grec. L’athénocentrisme lié au caractère lacunaire des sources, bien sûr, mais aussi une lecture très idéologique de celles-ci. Ainsi, la IIIe République de 1870, s’identifiant à Athènes, a emboîté le pas d’auteurs réactionnaires comme Aristophane puis contribué à forger le mythe de l’âge d’or du Ve s. par opposition au IVe s. qui serait celui du déclin. P. Brun invite donc à réévaluer les continuités entre la période archaïque et classique ainsi qu’à repenser la périodisation, à la façon de Thucydide, en redonnant un rôle charnière à la Guerre du Péloponnèse.

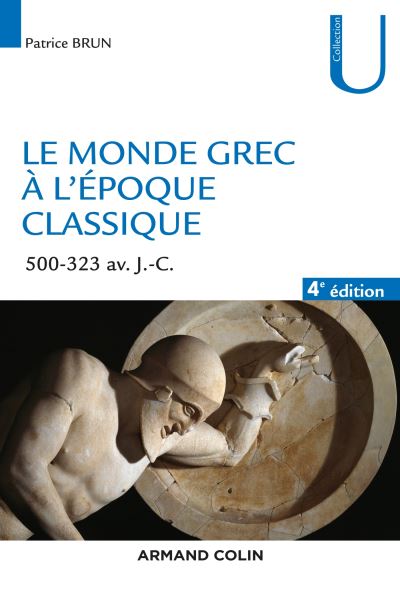
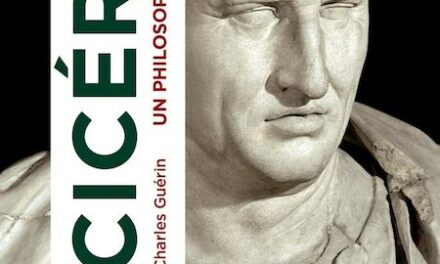

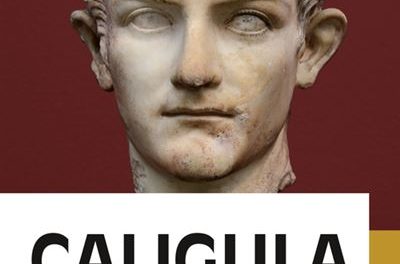
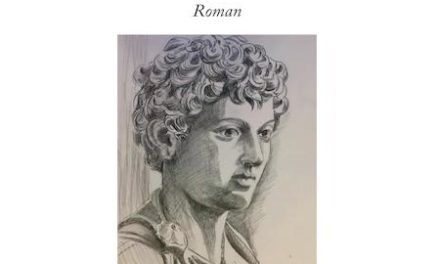









Je trouve tout celà formidable. Je vous en félicite et vous en remercie !