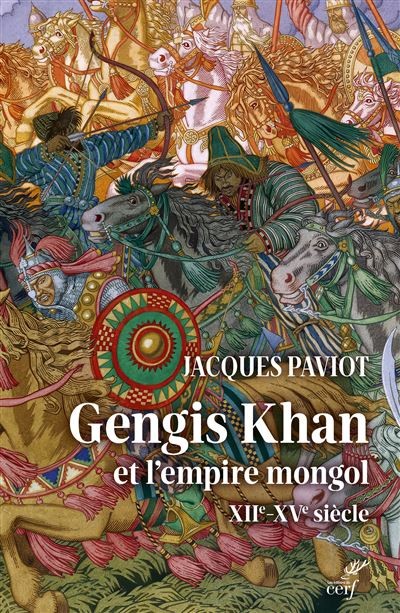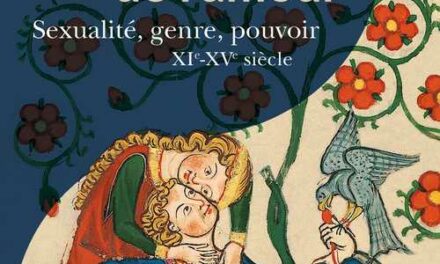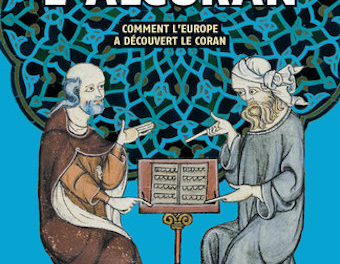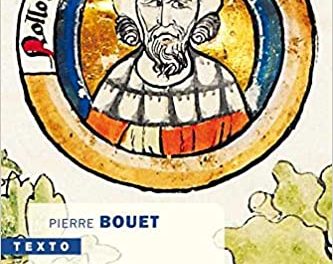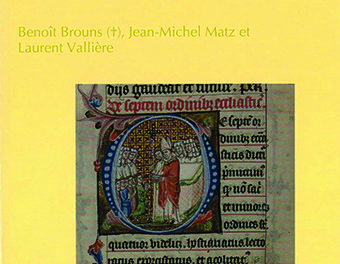L’ouvrage Gengis Khan et l’empire mongol est signé Jacques Paviot, historien médiéviste, ancien élève de Philippe Contamine. Il est secrétaire de la Société de l’Histoire de France et président de la Société nationale des Antiquaires de France. Ses travaux portent sur les derniers siècles de l’époque médiévale, notamment des croisades et des relations entre Occident et Orient.
L’ouvrage dont il sera question ici est un récit très narratif d’environ 260 pages, accompagné de quelques sources primaires éditées. Il porte à la fois sur Gengis Khan (dont il retrace la vie), la formation et les conquêtes de l’empire mongol au début du XIIIe siècle, les successeurs du Khan après sa mort en 1227, et les contacts religieux et culturels entre l’empire mongol et l’Occident chrétien.
C’est un vaste programme, alléchant de prime abord pour celui qui s’intéresse à une histoire eurasiatique. Le 4e de couverture annonce d’ailleurs : « une plongée fascinante dans l’histoire d’un empire hors norme dont les armées, parties de la steppe, auront déferlé jusqu’aux confins du monde. Une fresque saisissante. Un ouvrage magistral ».
Or, le lecteur attiré par une histoire eurasiatique sera déçu à la fermeture de l’ouvrage, et préférera se tourner vers les travaux de Marie Favereau (en particulier La Horde. Comment les Mongols ont changé le monde, Perrin, 2021 ; Les Empires anciens, Perrin, 2025). On trouvera peu de concepts anthropologiques comme les « murs de feutre ». Car l’ouvrage de Jacques Paviot, malgré ses mérites, reste ancré dans une historiographie française très classique voire ancienne aujourd’hui. Le poids de l’écriture de Philippe Contamine (la guerre, l’histoire politique, l’histoire événementielle, le récit des grandes batailles) et la concentration sur les sources uniquement textuelles s’en ressent particulièrement.
Le récit est solide, mais l’approche reste ancienne. Appuyé sur des sources écrites, ne faisant que très peu appel à d’autres sources de terrain, le texte se limite à une histoire « princière » et « lignagère » de l’empire mongol. Les personnages évoqués ne sont que des « Grands Hommes », membres de l’entourage (amical ou non) du personnage principal de l’histoire. On peut regretter qu’à la manière des travaux historiques d’un lointain XXe siècle, les aspects géographiques, ethnographiques, économiques et écologiques n’aient été traités que dans de maigres pages d’introduction (p. 9-27).
Tout se passe comme si, une fois le « cadre » posé, on pouvait se débarrasser de ces questions pour écrire une histoire centrée sur des événements de la vie des princes. Tout le reste compte peu. Aucun chapitre, par exemple, ne fait mention du peuple mongol ou des combattants mongols (l’organisation de l’armée mongole est décrite en seulement 5 pages, p. 189-193). Quelques passages dispersés répètent seulement que les Mongols sont aussi des pillards et qu’ils ont besoin de mener des raids violents contre les villes avant de revenir à leurs activités d’éleveurs nomades. Le chapitre 10 propose quelques descriptions des ulus. Jusqu’aux deux derniers chapitres, les approches anthropologiques les plus approfondies concernent seulement les alliances et les rivalités entre tribus (grâce à des titres de familles et des échanges matrimoniaux) et le désir de vengeance de Temüjin contre les assassins de son père.
L’ouvrage est avant tout une histoire événementielle. Le sujet de la formation de l’empire mongol est traité uniquement par le prisme de l’histoire politique et de l’histoire militaire. La moitié de l’ouvrage ne porte que sur la biographie politique de Temüjin, le futur Chinggis Qan, « l’Empereur féroce »/ Gengis Khan. Jacques Paviot retrace, année après année, l’enfance, l’adolescence, la formation et la maturité de ce chef d’une tribu mongole à l’origine. L’auteur rappelle le contexte des steppes mongoles, marquées par une mosaïque de clans rivaux. L’ascension de Temüjin, s’explique par sa capacité à fédérer les tribus, réformer l’armée et instaurer une méritocratie.
Cette unification des Mongols constitue le socle des conquêtes. Du chapitre 1 au chapitre 7 en particulier, le récit est linéaire : c’est celui des batailles (qui sont presque toutes racontées), des querelles tribales, des intrigues politiques et de la lente prise de pouvoir.
Les chapitres 8 à 10 partagent la même méthode, mais avec les successeurs de Gengis Khan. Seul le chapitre 10 (à partir du sous-chapitre « La dynastie Yuan) et le chapitre 11 proposent une approche différente : ici, les développements anthropologiques et culturels sont prégnants et remplacent la narration militaire et politique. La dizaine de pages (p. 233-242) portant sur la fusion entre le monde traditionnellement nomade des Mongols et les habitudes urbaines de la civilisation chinoise sous le règne de Kubilai Khan (1271-1294) est agréable à lire. Jacques Paviot décrit avec plusieurs exemples la sinisation de la culture mongole après la domination de « la société la plus avancée du monde, du point de vue économique et social » (p. 236). Mais cette fusion est faite de choix, d’acceptation et de refus, ainsi que d’une opposition constante entre la Chine du Nord et la Chine des Sud (qui reste méprisée). De la culture chinoise, les élites mongoles ont emprunté l’administration écrite, le système de concours, la religion (le confucianisme), l’art, les mathématiques, les sciences, les techniques. L’ère des Yuan a été une période d’ouverture (en particulier maritime) de la Chine vers l’Asie du Sud-Est, avant le retour d’une politique de « mer fermée » sous les Ming à partir de 1368.
Le dernier chapitre analyse une série de voyages et de rencontres entre l’Europe latine et l’empire mongol aux XIIe et au XIVe siècle précédant la Grande Peste. Jacques Paviot rappelle le mythe du Prêtre Jean qui joue un rôle majeur dans la projection des Chrétiens vers l’Asie centrale au moment des croisades. Par moments, les rois chrétiens et les souverains pontificaux ont envisagé de convertir les Mongols au christianisme afin de faire d’eux des alliés du Christ dans le mouvement porté contre les musulmans du Levant. L’Asie centrale a d’abord été parcourue par des « envoyés » pontificaux, savants et polyglottes (André de Longjumeau, Ascelin de Crémone, Simon de Saint-Quentin, Jean de Plan Carpin, Benoît de Pologne, Guillaume de Rubrouck) avant d’accueillir des marchands (les Polo, originaires de Venise) puis des missionnaires en Chine (Jean de Montecorvino, Odoric de Pordenone, Giovanni de Marignolli). Le chapitre apporte des connaissances sur les rencontres entre plusieurs mondes tout au long du XIIIe siècle.
Le texte reste compliqué à lire, même pour le lecteur appréciant l’histoire narrative. En effet, les noms sont très nombreux : peuples, personnages, localités, sont pléthores. Les orthographes sont différents selon les sources utilisées. Nous ne sommes pas familiers de ces noms, qu’il faut pourtant bien utiliser. Par exemple, celui que nous appelons Gengis Khan s’appelle en réalité Temüjin. Nous aurions apprécié de pouvoir nous appuyer sur des arbres généalogiques, des tableaux synoptiques, des récapitulatifs, et même des cartes, comme dans l’œuvre de Marie Favereau. Pourtant, rien de cela n’a été fourni dans l’édition. Il n’y a pas même un index. Nous avons été contraints de lire et de rechercher sur internet en parallèle où se trouvent le Burqan Qaldun, le Khangaï, « les Sables de Qalaqaljit, près de Dalan Nemürges » la Kimurqa (dont nous avons dû comprendre qu’il s’agissait d’une rivière), les sources du Senggür ; les lieux où résidaient les Tatars, les Tangoutes, les Jürchin, les Kereyit, les Ouïghours, les Karlouks, les Qangli, les Qipchaq… Quant au choix des sources apportées en annexe, on ne saisit pas très bien les raisons de leur choix. Leur présence n’est pas justifiée par l’auteur.
Jacques Paviot s’est essayé à la vaste question de l’archéologie mongole, en particulier autour de la question de la tombe de Gengis Khan. Mais l’historien reste fidèle aux sources textuelles et n’en cite aucune d’autres. Il conclut donc l’affaire de façon légère en disant que « il fut inhumé dans le Burqan Qaldun sur le flanc sud, soit sur les rives de l’Onon (à son lieu de naissance), soit sur celles de la Kerülen », que « l’endroit avait été choisi par Gengis Khan lui-même » mais que « au début du XIVe siècle, l’endroit était devenu une forêt si épaisse qu’on ne pouvait y pénétrer et que les anciens gardes ne savaient plus retrouver le lieu de la sépulture ». Il néglige malheureusement les recherches faites depuis une quinzaine d’années par Albert Yu-Min Lin ou par Pierre-Henri Giscard et Raphaël Hautefort grâce à des techniques modernes, à l’aide de drones ou d’imageries numériques sur le site, qui ont permis de préciser la localisation de la tombe. Il ne parle pas non plus des problématiques géopolitiques liées au « mausolée de Gengis Khan », construit à Ordos au XIIIe siècle, et restauré par Mao Zedong en Chine en 1956, et qui attise des tensions entre la Mongolie et la Chine actuelles.
En somme, Gengis Khan et l’empire mongol, XII-XVe siècle est un ouvrage narratif centré sur l’histoire politique et militaire de l’empire mongol et de son créateur, qui s’appuie très largement sur les sources écrites. Sa lecture est utile pour ceux qui s’intéressent à une histoire chronologique classique et sont adeptes d’une approche historiographique française classique. On peut cependant regretter qu’en délaissant les autres sources et les autres sciences sociales, l’ouvrage dans son ensemble délaisse également une approche anthropologique ou ethnologique qui aurait permis de mieux connaître non seulement l’empire mongol, mais aussi le peuple mongol aux XIIIe et XIVe siècles.