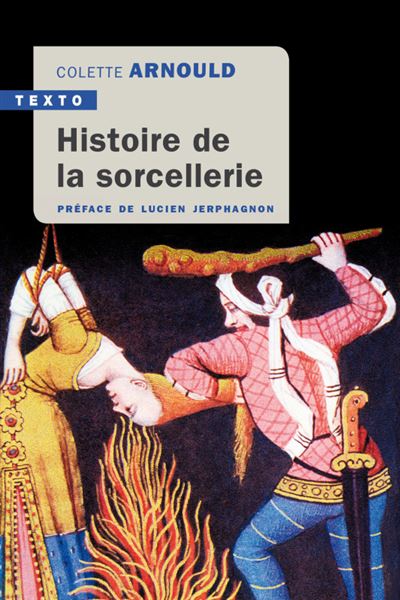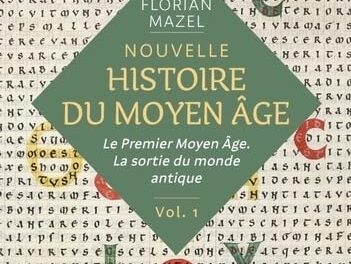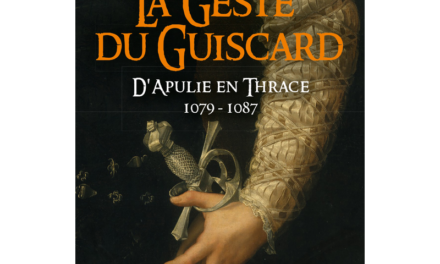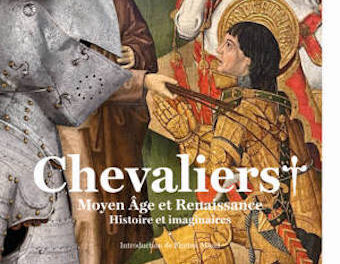Compte-rendu réalisé par Clémence Peyré, étudiante en hypokhâgne (année 2023-2024) au lycée Claude Monet de Paris, dans le cadre d’une initiation à la réflexion et à la recherche en histoire.
Présentation
Colette Arnould est professeure de philosophie. Dans sa thèse de doctorat, intitulée Un aspect de la superstition dans la France médiévale : le Diable et la sorcière, XIIe-XVe siècles, dirigée par Louis Sala-Molins et soutenue à l’Université Paris-I Panthéon-Sorbonne en 1990, elle interroge les liens entre la figure du diable et celle de la sorcière. Son travail de recherche est repris dans sa principale publication, Histoire de la sorcellerie, publié pour la première fois en 2009.
Dans cet ouvrage, l’autrice retrace l’histoire de la « sorcière » et l’évolution de ses représentations à travers les époques. De l’Antiquité à l’époque contemporaine, elle convoque de nombreuses références afin de proposer un portrait détaillé et analytique des figures de la sorcellerie, et tente d’en faire les reflets des consciences au cours du temps. À travers l’image du diable, de Satan et de la sorcière, elle nous renseigne aussi sur l’évolution de l’imaginaire collectif et la perception du mal et du bien, qui n’ont cessé de fluctuer à travers les siècles. Cette dynamique illustre la façon dont la sorcellerie est devenue un ressort politique public, laissant transparaitre l’appétence de l’humain pour ce qui relève du surnaturel. Une citation de Voltaire est employée au début de l’ouvrage, résumant la problématique de Colette Arnould : « Les superstitieux sont dans la société ce que les poltrons sont dans une armée, ils ont et donnent des terreurs paniques ».
De Médée à la figure sartrienne de Satan, Colette Arnould structure son ouvrage en dix chapitres, s’emparant chacun d’un des aspects du thème abordé. En fin d’ouvrage, nous retrouvons une chronologie détaillée et une large bibliographie répertoriant les œuvres convoquées. Le livre est aussi enrichi d’une préface de Lucien Jerphagnon, philosophe et historien, louant la pertinence de l’autrice.
Résumé
Dans le premier chapitre, Colette Arnould aborde le sujet du livre durant l’Antiquité. Elle débute une chronologie de la sorcellerie et nous présente son contexte d’émergence. Elle convoque en premier lieu deux figures mythologiques de la « sorcière » : Circé et Médée : « A l’image enjôleuse de l’enchanteresse s’oppose l’image maléfique de celle qui donnera naissance à la sorcière ». Arnould s’empare directement de la confusion à éviter : magicienne ne signifie pas sorcière. La notion de sorcière transporte avec elle l’idée de maléfice, rapprochée par la suite de l’idée du Diable ou des malédictions. Pendant l’Antiquité, la sorcière est rencontrée dans la sphère politique mais aussi intime. La crainte d’être victime d’une manigance de la part de ses opposants politiques se transformait en peur d’être empoisonné, et a introduit très vite la sorcellerie dans ce milieu. Le nom du politicien Démosthène se trouvait par exemple sur une tablette d’imprécation. Dans la sphère intime, les sorcières étaient accusées d’être la source de tous problèmes : de la tromperie au décès. « De la vulgaire empoisonneuse à la sorcière, il n’y avait qu’un pas : tout était affaire de croyance ». Les accusations de sorcellerie étaient liées à la misogynie et marquaient le début d’un mal auquel les femmes seraient pendant longtemps associées.
Le deuxième chapitre s’empare de la question du diable dans le christianisme. Satan s’oppose à Dieu et est très présent dans la religion chrétienne du nouveau testament. Il prend une forme spirituelle qui en fait une réelle menace pour les hommes et lui confère la dimension mystique des sorcières. Le nouveau testament différencie le diable, personnalité bien réelle, de Satan, force transcendante. Le diable prend des formes humaines ou animales mais s’impose comme une évidence aux yeux des hommes, ce qui permet à l’autrice d’aborder la question de la crédulité de l’époque. Le manque de connaissance mène à des situations de naïveté collective permettant l’implantation de croyances irrationnelles. Les liens établis entre le diable et les sorcières sont multiples : la malveillance, le lien avec la magie et le mystique, l’idée selon laquelle le diable puisse avoir une apparence de femme. Les possédées sont d’ailleurs le plus souvent des femmes, idée que Colette Arnould rapproche des accusations « d’hystérie » qui leur sont faites.
Dans le troisième chapitre, il est question d’hérésie, soit « tout crime commis contre la foi, toute croyance contraire ». Face à cela, l’Eglise tentait d’imposer des principes régulant la société, évitant la remise en question du christianisme. L’Inquisition s’installe et vise les sorcières par la suite. Cette période est celle des peines de mort, bûchers et massacres de la part de l’Eglise et des hérétiques en retour, comme en 1249 près d’Agen où un bûcher d’inquisiteurs est organisé. Naturellement, des assimilations se font avec la sorcellerie, qui est condamnée en 1220 par Azon de Bologne. En 1326, la sorcellerie est officiellement associée aux hérésies par le pape Jean XXII qui autorise la condamnation des sorcières et sorciers pour motif hérétique. Débute alors en Europe une vague de persécutions de cette figure intrigante, à l’exception de l’Espagne qui différencie menace pour l’Église et exercice séculier.
A travers le quatrième chapitre, Colette Arnould évoque la montée de la sorcellerie, marquée par la mise au bûcher d’une domestique en Irlande, accusée d’avoir tué son employeur en usant de maléfices en 1324. La montée de ce phénomène s’évalue par la multiplication de condamnations de sorcières, permettant d’en quantifier l’ampleur, alors qu’il s’agit de pratiques dont on ignore la prolifération. Le développement de la sorcellerie s’explique par le contexte intellectuel : la science était un savoir limité et effrayant au Moyen-Âge. La pensée médiévale s’est empêtrée dans des croyances « épistémologiques et animistes » dans lesquelles la foi et la superstition empêchaient tout accès à la raison. L’idée d’une méfiance de tous envers tout nous amène à penser que la montée de la sorcellerie était inévitable puisque chaque évènement pouvait être perçu comme une démonstration de celle-ci. Ces éléments révèlent « la difficulté, voire l’impossibilité de détourner les masses de leurs erreurs ».
Dans le cinquième chapitre, Colette Arnould s’empare de l’orientation de l’Inquisition envers la sorcière. A la fin du XVe siècle, on dénombre six ouvrages dédiés aux sorcières. Elles deviennent dans la conscience collective des figures uniquement féminines du fait de pensées misogynes, associant le mal aux femmes, comme a pu le faire Sénèque qui écrit : « une femme qui pense seule pense à mal ». Les victimes de leurs malédictions sont de fait des hommes. L’Inquisition se nourrit grâce au climat de misogynie qui fait de toute femme une suspecte. La « chasse aux sorcières » est nettement accélérée en 1486 par la publication du Malleus Malleficarum, traité écrit par les inquisiteurs Henri Institoris et Jacques Sprenger, mettant en garde contre la sorcellerie. Il s’agit d’un ouvrage majeur dans l’histoire des sorcières puisqu’il établit les principes selon lesquels elles doivent être jugées selon une politique de l’aveu basée sur la torture et l’humiliation, ensuite condamnées à de la prison en attendant le bûcher.
Le sixième chapitre aborde la distinction entre les sorciers et les sorcières, ainsi que la stigmatisation des unes et non des autres. Elle relate l’idée que se développe autour de la femme un culte du mystère, permettant de la chosifier et de la faire correspondre à tous les préjugés. Des romanciers aux philosophes, la femme reste inférieure en tout point à l’homme et ne suscite ni intérêt, ni considérations permettant de « rétablir une vérité » à son sujet. Il est aisé d’en faire une figure monstrueuse et le Malleus y parvient très bien. Le sorcier est rapidement évincé des représentations.
Dans le septième chapitre, il est question du contexte sociétal dans lequel s’implante les sorcières. D’un point de vue représentatif, il fallait accuser quelqu’un d’être le diable pour pouvoir tenter de l’éliminer. « Le mal prenait un visage, il devenait femme. » La sorcière regroupait les quatre sources de peur au Moyen-âge : l’insécurité ; l’agression ; l’abandon ; la mort. Lui sont aussi associés des symboles cosmiques (déluges, tempêtes), bestiaires (serpents, loup, hibou), maléfiques (sang, yeux) et violents, même sexuels (le balai) qui traduisent ce que les hommes associent au mal. Les niveaux culturels concernés par la hantise de la sorcière variaient. La peur était largement présente dans les classes populaires alors que l’inquisition était le fait de populations éduquées. La culture dirigeante profitait de la naïveté des foules pour s’imposer. Or, ce qui ressort de l’ouvrage de Colette Arnould, c’est la profonde méconnaissance du phénomène par ceux qui le condamnent. Le mal auquel était soumise l’époque est appelé par Saint-Thomas « Tristitia » et caractérise le dégout et la torpeur qui enlevaient aux hommes tout centre d’intérêt, aboutissant à la diabolisation de toute figure non pieuse.
Le huitième chapitre étudie les bûchers qui se développent en Europe, phénomène résultant de tous les ouvrages écrits à ce sujet. Si le premier est celui de Jeanne de Brigue, brulée vive à Paris en 1390, la vague principale débute au XVIe siècle. En 100 ans, on en dénombre autour de 60 000. L’idée était aussi de brûler le diable avec qui les sorcières étaient accusées d’entretenir des relations charnelles. Des avis opposés aux pratiques infligées aux sorcières, commencent cependant à s’exprimer au XVIe siècle, comme celui de F. von Spee qui écrit anonymement un réquisitoire contre les bûchers alors qu’il est prêtre. Sous couvert de superstition et d’absence de rationalité, ce sont des milliers d’innocentes qui furent condamnées, faisant du Moyen-Âge une période de grand danger pour les femmes.
A travers le neuvième chapitre, l’historienne évoque les changements initiés par l’arrivée du Siècle des Lumières en matière d’inquisition. Au XVIIIe siècle, l’émergence de la science et la diffusion d’une certaine culture permettent la diminution de sentences envers les sorcières. Le début des considérations humanistes a eu un impact puisque la torture fut condamnée, abolissant la période des grands bûchers. La sorcellerie prenait alors fin grâce à l’arrêt des accusations de masse infondées.
Enfin, dans le dixième chapitre, l’autrice s’empare de l’impact de ces croyances dans la culture. Le diable devient dans la littérature du XIXe siècle un simple personnage, prétexte pour une critique de l’homme de la part des auteurs classiques comme Théophile Gautier dans Albertus ou Dostoïevski dans l’ensemble de son œuvre. Charles Baudelaire s’empare aussi de la figure de Satan dans Les Litanies de Satan, comme Victor Hugo dans La Légende des siècles, mais toujours à des fins différentes de celles du Moyen-Âge. Colette Arnould évoque aussi les conséquences psychiques qu’on eut les affaires de sorcellerie : délires paranoïaques ou folie. Le XIXe siècle a offert aux hommes l’espoir d’une tranquillité d’esprit, loin des rumeurs et de l’angoisse. Aujourd’hui, la figure de Satan est totalement anecdotique.
Appréciations
Le sujet choisi permet une entrée originale vers une approche sociologique des populations passées. La question de la sorcellerie parait peu ordinaire et nous fait adopter un point de vue inhabituel sur les periodes étudiées. En effet, s’intéresser à ce thème permet d’évoquer des problématiques politiques et sociales via un autre angle, non moins pertinent, puisque l’étude du phénomène des sorcières devient aussi celle, par exemple, des croyances et de la naïveté au Moyen-Âge. Ainsi on obtient, à la lecture d’Histoire de la sorcellerie, des informations sur des questionnements qui nous concernent encore aujourd’hui : la crédulité des foules et les ravages de la désinformation. Ce que Colette Arnould met en évidence, c’est la facilité avec laquelle il est possible de transformer des informations en faits de société dans un monde gangréné par la peur et l’ignorance. Constats pertinents encore à notre époque. Il a toujours été facile d’emporter les foules, de les convaincre sans preuve, de les soulever sans motif précis. Il est intéressant d’avoir un exemple aussi durable et violent que celui de la sorcellerie en termes de mouvement de foule. Remonter l’histoire des préjugés et des stéréotypes permet aussi d’en découvrir : les juifs étaient autant victimes que les femmes des idéaux sur la sorcellerie par exemple. Cette phénoménalisation était donc prétexte à des pensées sexistes et antisémites. Colette Arnould soulève des vérités qui méritent d’être mises en évidence, qui constituent un riche apport historique. Les faits énoncés, les références citées et les informations apportées le sont de façon claire et précise. Colette Arnould nous livre ici une réelle vulgarisation du mouvement sans pour autant en effacer les complexités ou les contradictions. Les termes employés sont explicités et le lecteur est happé par ce qui lui est exposé, y trouvant, grâce à la progression logique des idées, un vif intérêt. Nous pourrions cependant nous interroger sur l’ampleur du mouvement hors Europe et déplorer alors une vision ethnocentrée du sujet, ne permettant peut-être pas d’en étudier tous les ressorts, y compris actuels. Il serait intéressant de compléter la lecture de l’ouvrage de Colette Arnould par celui de Maryse Condé, Moi, Tituba, sorcière, qui offre un point de vue narratif intéressant et décentré de l’Europe. On peut considérer Histoire de la sorcellerie comme un ouvrage majeur traitant de la place des femmes et de l’une des nombreuses périodes durant lesquelles elles ont été violentées, dénigrées et objectifiées. Le goût de Colette Arnould pour la philosophie se reflète dans ce livre et apporte une vision du sujet intéressante quand il s’agit de traiter de la bêtise de l’humain. On retient de ce livre une réelle remise en question, sourcée et argumentée des pratiques, surtout médiévales, qui ont influencé les époques suivantes et notre rapport au groupe.