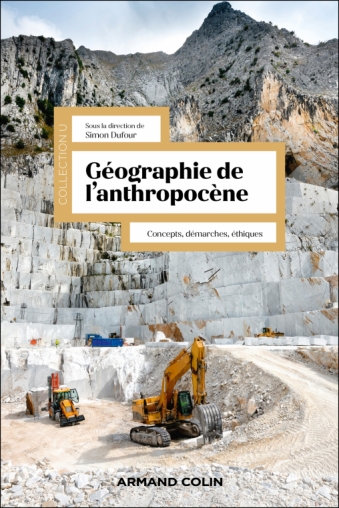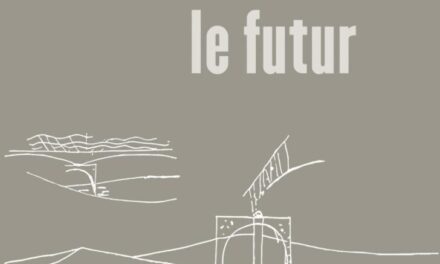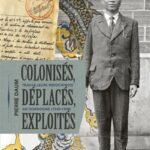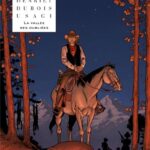Comme les auteurs de l’ouvrage, j’ai maintenant également en tête la date du 18 juillet 2022 où il a fait une chaleur écrasante arrivée par la Bretagne. Si cet évènement était tout sauf anodin, il reste un marqueur. Mais de quoi ? D’une possible nouvelle époque de l’histoire de notre planète qui se veut désormais marquée par la brutale empreinte de l’homme. D’où la « proposition anthropocène » revendiquée par les auteurs puisque, pour l’heure, les géologues n’ont pas souhaité la reconnaître comme une nouvelle époque géologique. Il n’est pourtant question de rien d’autre que la continuation de l’habitabilité de la Terre. La géographie semble indiquée pour traiter en premier lieu de la question même si l’ouvrage ne prétend pas à l’exhaustivité et invite à des lectures complémentaires.
Le livre débute par des éléments de définition de l’anthropisation, concept qui tourne autour de l’action humaine dans un cadre dynamique mais également de manifestations physiques. L’anthropisation s’accompagne de l’hominisation et de l’humanisation. On notera une première bonne figure 1.2 page 25 qui cherche à dater la possible arrivée de l’anthropocène en fonction de certains évènements (la première extinction de la mégafaune, l’agriculture, la capture de l’Amérique, le minimum de CO2, la machine à vapeur, la bombe atomique, les radioéléments). L’histoire et la géographie sont convoquées car la pression humaine n’est pas la même partout et n’a pas débuté aux mêmes moments.
Concrètement, 6 des 9 limites planétaires sont déjà franchies : 1/la hausse des températures et la hausse du CO2, 2/la disparition de certains écosystèmes, 3/la hausse de l’azote et du phosphore, 4/l’artificialisation des sols, 5/l’introduction de polluants, 6/la quantité critique de ressource en eau douce. Les trois dernières concernent la couche d’ozone, l’acidification des océans, la concentration en aérosols atmosphériques.
Il y a de nombreuses boucles de rétroaction qui illustrent le caractère dynamique du problème. Sur 41, 27 sont vus comme vicieuses (la conséquence amplifie la cause), 7 comme stabilisantes, 7 autres comme incertaines. Face au manque d’unanimité, d’autres termes ont émergé comme on peut le noter sur le tableau 1.1 page 33 (androcène, capitalocène, chtulucène, phagocène, plantationocène, thermocène, urbanocène). Malgré tout, le contexte est favorable à l’avènement du concept car on cherche justement à atténuer le problème.
L’ouvrage s’interroge sur le statut de la nature (plus ou moins extérieure à l’homme) et la place de celle-ci dans les différentes branches de la géographie (d’abord extérieure puis partie intégrante de celle-ci via la question des risques et la question des ressources). Un autre très bon tableau 2.1 page 36 illustre parfaitement la chose. Il est important de garder un recul pour, a minima, saisir épistémologiquement les objets mais aussi pour accepter l’idée que l’humain ne contrôle pas tout.
Une série de chapitres interroge utilement les grands concepts de la discipline.
Sont analysés les différents types de liens entre les dimensions biophysiques et sociales de la géographie (très bon tableau 4.1 page 70). Un intéressant développement sur le concept de milieu, de Vidal à ses successeurs, entre déterminisme et possibilisme est exposé pour montrer que celui-ci n’est pas pensé à l’échelle planétaire d’où ce recours à la proposition anthropocène. Un tableau 4.2 page 84 montre les effets culturels résultants des effets biophysiques dus au réchauffement climatique.
La distance est aussi interrogée autour du lien entre le lieu de production et de consommation qu’il faut réduire au mieux pour éviter l’empreinte carbone excessive. Le territoire est questionné en tant que « politique », « protégé » et « vécu ». Le monde est-il un seul territoire ? En tous cas, les différents territoires qui le constituent sont en concurrence : les analyses comparatives sont permanentes et l’on cherche à externaliser. Le « réseau » est interrogé aussi : les trames (bleu, verte…), les corridors et les différents flux qui constituent les réseaux (bonne figure 5.8 page 113). On trouve une approche métabolique des territoires.
Les échelles sont questionnées aussi, le fameux « penser global et agir local ». Attention à l’évidence de ces échelles justement : il faut distinguer les échelles de réalisation et les échelles d’observation. Il faut penser transscalaire et pas uniquement multiscalaire. Les manifestations sont différentes selon les lieux (la hausse des températures en Arctique est plus forte que la hausse moyenne) et les impacts (les moins responsables seront les plus impactés).
Les temporalités sont convoquées puisque l’on parle d’accélération, de 6ème extinction, de durée, enchaînements…Il y a le temps construit socialement. On évolue de « futurisme » (avec le progrès comme horizon) au « présentéisme » (derrière l’adjectif « durable » sans cesse convoqué, on cherche à prolonger le même présent). Et quand dater le début de ces phénomènes d’ailleurs ? Pour mesurer une baisse d’émissions de CO2, tel ou tel pays sera avantagé si telle ou telle date est retenue. Une bonne figure 7.3 page 140 montre différentes formes de dynamiques des systèmes socio-écologiques (stabilité, équilibre dynamique, changement progressif, équilibre métastable). On parle de résilience et d’adaptation mais comment ? Par à-coups ? S’il faut du temps, on parle de transition mais avec quels objectifs ? Quelles méthodes ? Et quelles seront les trajectoires ?
Il y a le problème de la surétude avec différentes causes et conséquences. Si les territoires sont « sexy » (Arctique en ce moment), on va s’y rendre. Il y a le problème de la temporalité courte de la recherche « bankable ». Les populations enquêtées sont lassées et les sites se voient dégradés d’un point de vue biophysique. Il y a intérêt à aller vers le comparatisme notamment en combinant des contextes analogues et les contextes contrastés pour ne pas négliger les « espaces ordinaires ».
La suite de l’ouvrage évoque la question des animaux par ailleurs évoqué pour « tisser des liens » : la figure 9.1 page 173 montre bien que les objets d’étude sont constitués de différentes catégories d’éléments.
De manière plus combinée, on pourra traiter de l’organisation spatiale contenant des structures spatiales pour voir la distribution d’un phénomène et l’évolution de la distribution de ce phénomène : la figure 10.2 page 194 montre bien les possibles glissements, contractions, étirements, basculements…Il est difficile d’isoler les facteurs explicatifs tant ceux-ci sont nombreux.
Est évoquée l’histoire du climat et des méthodes pour l’appréhender. On peut pratiquer l’observation anticipée d’un phénomène avec des relevés réguliers mais également reconstituer rétrospectivement à partir d’informations passées collectées dans le présent. Ou alors une hybridation des deux méthodes. Mais attention aux conditions de production des documents en leur temps…Un bon exemple, figure 12.2 page 229, montre qu’entre deux dates, c’est peu précis mais à partir de trois, on voit s’il y a cassure du rythme ou pas…L’outil « frise sociosystémique » (exemple de la figure 12.4 page 231) apparaît visuellement pertinent également.
La fin de l’ouvrage évoque l’implication des scientifiques qui ont leur bagage et leurs convictions propres. Les cadres d’exercice de la recherche (financement, matériel…) jouent aussi. Le caractère prescriptif de la science également. Les sciences ont influé sur le bien-être humain (médecine, production alimentaire) mais ont aussi amené des dangers (nucléaire, colonisation). Il y a donc une ambivalence qui a amené à travailler en transdisciplinarité et à investir les sciences de la durabilité. Un bon tableau 15.1 page 272, présente des comparaisons de fonctionnement des sciences. L’éthique est particulièrement nécessaire sur ce thème de l’anthropocène.
Est abordée également la géographie du contre-exemple avec problème d’échelle et problème de contextualisation. Un phénomène peut être mondial sans être uniforme (d’où le recours nécessaire aux moyennes, médianes et autres coefficients de variation). Une situation particulière ne peut pas être nécessairement transposée.
Il doit y avoir discussion entre neutralité (d’effet, de but, de procédé, d’énoncé) et engagement : il peut y avoir un engagement dissocié (action politique, syndicale, personnelle…) ou une imbrication plus nette. L’inaction peut aussi se voir justifiée de différentes façons (tableau 16.1 page 294).
Un propos riche, de nombreuses figures et une vertu illustrative des « par exemple » pour un ouvrage important qui se termine, on le souhaitait, par une invitation à intégrer ces nouveaux questionnements dans l’enseignement.
En complément, on pourra visionner en parallèle le reportage « Anthropocène, l’enquête implacable » disponible sur ARTE.