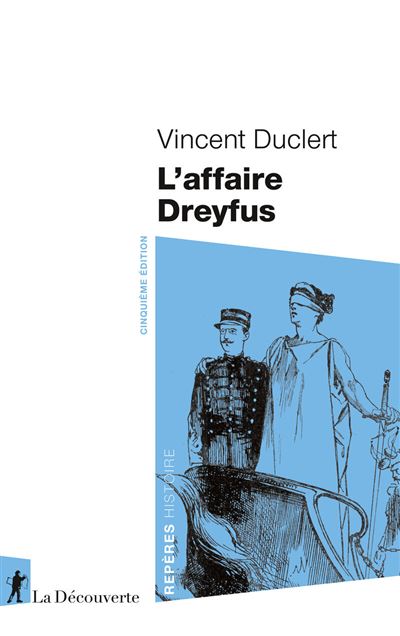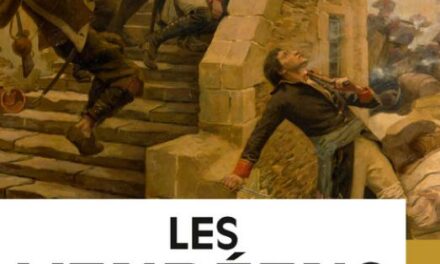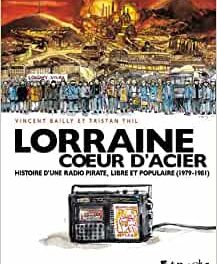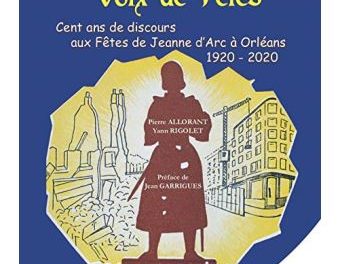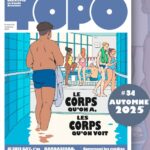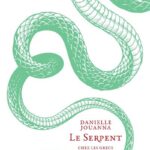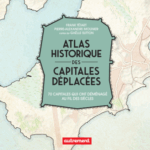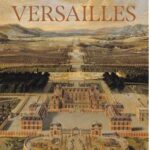L’affaire Dreyfus demeure l’un des plus grands séismes politiques et judiciaires de l’histoire française. Plus de 130 ans après la condamnation injuste du capitaine Alfred Dreyfus, elle continue d’interroger notre rapport à la justice, à la vérité et aux valeurs républicaines. À travers cette cinquième édition actualisée de L’Affaire Dreyfus, Vincent Duclert propose une synthèse indispensable et enrichie par de nouveaux documents issus d’archives publiques et privées, mais aussi par les avancées historiographiques les plus récentes.
Loin d’être un simple épisode du passé, l’Affaire marque un tournant fondamental dans l’histoire politique et intellectuelle de la France. Elle révèle les tensions profondes qui traversent la République naissante : l’antisémitisme, la toute-puissance de l’état-major, la montée des nationalismes, mais aussi l’éveil d’une conscience démocratique portée par les intellectuels et les défenseurs des droits humains. Si les figures dreyfusardes ou dreyfusistes de Zola, Clemenceau, Lazare ou Jaurès ont incarné, la lutte pour la réhabilitation de Dreyfus, ce livre rappelle également que le capitaine lui-même fut un acteur majeur de son propre combat.
Vincent Duclert revisite cette affaire avec une rigueur documentaire et critique exemplaire, donnant à entendre les voix des dreyfusards comme des antidreyfusards. À une époque où les débats sur la justice, le racisme et les dangers du nationalisme résonnent encore avec force, cette enquête historique est plus que jamais nécessaire pour comprendre l’héritage de l’Affaire et les leçons qu’elle nous lègue.
« Si l’historien et le chercheur ne peuvent se transformer en militants, même pour les causes les plus nobles moralement, il leur appartient cependant de forger du sens au présent. Et particulièrement le sens politique ». (p.114)
Ce compte-rendu reprend certains éléments de celui rédigé par les Clionautes à l’occasion de la quatrième édition : https://clio-cr.clionautes.org/laffaire-dreyfus-2.html
La France, l’armée et les Juifs
Vincent Duclert dresse le portrait de la France en 1894, une nation en quête de stabilité après avoir traversé trois crises majeures : le boulangisme en 1889, le scandale de Panama en 1892 et la menace anarchiste en 1894. Cette France s’appuie fortement sur son armée, mais celle-ci est imprégnée d’un antisémitisme de plus en plus virulent. L’ouvrage d’Édouard Drumont, La France juive (1892), et son journal La Libre Parole en témoignent, reflétant un climat où l’antisémitisme devient une donnée courante au sein de l’armée et s’ancre désormais dans la société française.
L’affaire Dreyfus s’inscrit dans ce contexte, où l’emballement médiatique joue un rôle clé. La figure du « traître » est déjà construite autour d’une véritable « espionnite aiguë », et Dreyfus est condamné avant même que son procès ne commence réellement. Vincent Duclert souligne que la grande majorité des Juifs français reste indifférente à son sort, ne percevant pas encore l’ampleur et les implications de l’Affaire.
Les mécanismes d’une culpabilité (1894-1895)
L’auteur analyse ici le verdict rendu le 19 décembre 1894 par le 1er Conseil de guerre à Paris, qui conclut le procès militaire du capitaine Dreyfus. Il met en lumière la manière dont la Section de statistique, service de contre-espionnage militaire français, a fabriqué la culpabilité de l’accusé en recourant à des moyens illégaux. Parmi ces artifices figurent le « bordereau », pièce maîtresse de l’accusation, ainsi que la constitution d’un « dossier secret » destiné à combler l’absence de preuves ou encore le « faux Henry », le tout couvert par l’état-major au nom de la raison d’État.
Plusieurs hauts responsables militaires ont joué un rôle déterminant dans cette affaire, notamment les généraux Mercier, de Boisdeffre et Gonse, ainsi que les commandants du Paty de Clam et Henry. À cela s’ajoutent les expertises graphologiques de Bertillon, qui ont contribué à légitimer l’injustice.
Le procès, entaché d’irrégularités, a bénéficié de la complicité d’une certaine presse, qui a amplifié les accusations et renforcé la condamnation du capitaine Dreyfus.
Raison d’État et République parlementaire (1895-1897)
Ce chapitre met en lumière les raisons de l’échec de la révision politique et parlementaire du procès de 1894, qui s’est soldée par un revers en novembre 1897. Dès le début de l’année 1895, le publiciste Bernard Lazare s’engage activement dans la défense d’Alfred Dreyfus et prend la tête du « Syndicat » Dreyfus (Drumont), militant pour la réhabilitation du capitaine injustement condamné.
En juillet 1895, le colonel Picquart est nommé à la tête de la Section de statistique. Il découvre rapidement l’ampleur de la trahison du commandant Esterhazy et la fragilité des preuves ayant conduit à la condamnation de Dreyfus. En consultant le « dossier secret » conservé par le commandant Henry, il identifie plusieurs faux documents. Lorsqu’il informe directement l’état-major de ses découvertes, ses supérieurs choisissent d’étouffer l’affaire. Picquart est alors mis à l’écart, mais il continue à se battre contre l’état-major.
Enfin, le chapitre souligne le rôle du sénateur Scheurer-Kestner, qui, durant l’été 1897, s’efforce de faire éclater la vérité. Son engagement lui vaut de violentes attaques, allant jusqu’à recevoir des excréments dans son courrier personnel.
La vérité est en marche (octobre 1897 – août 1898)
À l’automne 1897, le camp dreyfusard reprend espoir malgré l’épuisement des voies légales et l’acquittement d’Esterhazy le 11 janvier 1898. C’est le temps de la mobilisation : des figures comme Gabriel Monod, Lucien Herr et Émile Duclaux, ainsi que leurs réseaux, notamment l’Institut Pasteur et l’École normale supérieure, s’engagent activement dans la lutte pour la réhabilitation de Dreyfus.
Le 13 janvier 1898, Émile Zola publie son célèbre article « J’accuse… ! » dans L’Aurore, le quotidien dirigé par Georges Clemenceau, qui est à l’origine du titre. Le journal, tiré habituellement à 3 000 exemplaires, atteint cette fois les 200 000 exemplaires en quelques heures. Les 14 et 15 janvier, deux pétitions des « intellectuels » en faveur de Dreyfus voient le jour.
Le premier procès de Zola, qui se déroule du 7 au 23 février 1898, se solde par sa condamnation à la peine maximale. Lors du second procès, du 23 mai au 18 juillet 1898, l’écrivain choisit l’exil en Angleterre pour échapper à la justice française.
Par ailleurs, les élections législatives de juin 1898 renforcent la majorité républicaine antidreyfusarde, et le président du Conseil, Henri Brisson, forme un ministère de coalition favorable aux nationalistes.
La France et la révision (septembre 1898 – septembre 1899)
L’affaire Dreyfus bouleverse en profondeur la vie politique française, au point qu’en janvier 1899, « le régime républicain lui-même paraît alors en question ». La collusion entre l’état-major et Esterhazy est flagrante : le général de Boisdeffre démissionne, le lieutenant-colonel Henry se suicide, et le ministre de la Guerre, Cavaignac, renonce à ses fonctions. L’opposition nationaliste reste cependant présente à la Chambre des députés.
Le 3 juin 1899, la Cour de cassation rend un arrêt de révision, annulant ainsi le jugement du Conseil de guerre de 1894. Le capitaine Dreyfus est renvoyé devant le Conseil de guerre de Rennes. Le 22 juin 1899, une majorité parlementaire de « Défense républicaine » se dégage et désigne le sénateur Waldeck-Rousseau comme président du Conseil, dans le but de clore l’affaire Dreyfus. Cette clôture passe par un nouveau procès à Rennes, qui se tient d’août à septembre 1899.
Le 8 septembre 1899, le verdict tombe : Dreyfus est déclaré coupable avec circonstances atténuantes. Onze jours plus tard, le 19 septembre, le président de la République, Émile Loubet, signe le décret de grâce du capitaine Dreyfus en Conseil des ministres, pour raisons médicales. Cette mesure permet à Waldeck-Rousseau de déposer, le 17 novembre 1899, un projet de loi d’amnistie générale couvrant toutes les procédures judiciaires liées à l’affaire Dreyfus. Ainsi, l’affaire se conclut par un verdict « politique », permettant à l’armée, aux antidreyfusards et aux dreyfusards de sauver la face.
Le 22 mai 1900, Waldeck-Rousseau déclare devant la Chambre des députés : « Il n’y a plus d’affaire Dreyfus ». Désormais, la France peut se passionner pour un autre événement majeur : l’Exposition universelle de 1900, à Paris.
Politique, État et pouvoirs face à l’Affaire
L’affaire Dreyfus est à l’origine de l’éclatement des républicains de gouvernement, mais elle contribue également à une recomposition des forces politiques autour de la Gauche républicaine et des nationalistes. Elle marque aussi une mutation intellectuelle du socialisme français, qui, « sans perdre de sa capacité militante, découvre dans la République un avenir possible » (p.64). Jean Jaurès incarne pleinement ce courant.
L’Affaire révèle les compromissions du gouvernement et met en lumière la responsabilité de l’armée, qui fonctionne selon des représentations et des compétences dépassées, imprégnée d’un esprit de caste.
La magistrature, quant à elle, est en voie de « républicanisation », notamment au sein de la Cour de cassation.
L’engagement scientifique se manifeste dans des institutions comme l’Académie des sciences, le Collège de France et l’Institut Pasteur. Cependant, du côté des antidreyfusards, les « sciences fermées » rejettent le débat et le dialogue, à l’image des travaux de Bertillon.
Pour la discipline historique, l’Affaire favorise l’ouverture à la période contemporaine et la reconnaissance des travaux de chercheurs non spécialistes, à condition qu’ils respectent les règles de la critique historique.
Enfin, l’engagement des enseignants se traduit par une prise de position forte devant leurs élèves, incarnant ainsi la notion de « la politique dans la cité ».
La « ligne dreyfusarde » : dreyfusards, dreyfusisme et intellectuels
L’auteur s’attache à étudier et à distinguer la cause dreyfusarde (les défenseurs de Dreyfus) de l’engagement dreyfusiste (la volonté de construire une autre politique pour une cité idéale). Hormis Bernard Lazare, les premiers dreyfusards ont rarement été des dreyfusistes.
Le lien entre ces deux tendances se cristallise autour de l’affaire Zola et de la mobilisation des intellectuels. La Ligue des droits de l’homme, fondée le 4 juin 1898, se situe à mi-chemin entre le socialisme révolutionnaire et l’humanisme social.
Pour l’auteur, « plus que les intellectuels eux-mêmes, l’affaire Dreyfus a fait émerger, dans cette relation civique entre le savoir et la société, un archétype d’intellectuel : l’ »intellectuel dreyfusard », si l’on veut. Un intellectuel critique, vigilant et fraternel, matrice de l’intellectuel démocratique du XXe siècle » (p.87).
Les antidreyfusards, la France et l’étranger
Vincent Duclert étudie ici la dimension antidreyfusarde de l’Affaire. Les antidreyfusards parviennent à rallier une forte adhésion en s’appuyant sur des dogmes simples et intangibles : l’armée, la nation et l’autorité. Ils figent ainsi l’Affaire dans un cadre idéologique marqué par un socle antisémite et autoritaire.
En réalité, leur position se situe à la croisée de plusieurs courants idéologiques déjà présents avant l’Affaire Dreyfus qui ne fait que favoriser un « rapprochement des extrêmes » :
- Le déterminisme biologique et la théorie des races, diffusés notamment par Vacher de Lapouge.
- Le nationalisme théorisé par Maurice Barrès dans Le Figaro le 4 mai 1892.
- La crainte d’une « décadence française », popularisée par Édouard Drumont.
- La haine de la franc-maçonnerie.
- La xénophobie grandissante.
- L’antisémitisme :
- politique, porté par Paul Déroulède et Maurice Barrès.
- idéologique, incarné par Édouard Drumont.
Les antidreyfusards bénéficient également du soutien d’un réseau de presse influent, qui diffuse largement leurs idées. Parmi les principaux journaux engagés dans cette propagande, on retrouve La Croix, La Libre Parole, Le Gaulois ou L’Intransigeant.
La réhabilitation du capitaine Dreyfus (1902-1906)
Vincent Duclert montre que ce processus trouve son origine dans le discours de Jean Jaurès des 6 et 7 avril 1903, qui entraîne l’ouverture d’une enquête par le ministre de la Guerre, le général André. Cette enquête aboutit au rapport Targe, remis en octobre 1903 au président du Conseil, Émile Combes.
Soutenu par le gouvernement Combes, Alfred Dreyfus dépose alors une requête en révision de son procès de Rennes. Le 25 décembre 1903, la Cour de cassation est officiellement saisie de l’arrêt rendu par le Conseil de guerre de Rennes. Après plus de deux ans et demi d’examen, le 12 juillet 1906, la Cour de cassation annule ce verdict, réintègre Dreyfus dans son grade de capitaine et le réhabilite pleinement.
Le lendemain, 13 juillet 1906, la Chambre des députés adopte un projet de loi présenté par le gouvernement, qui promeut Dreyfus au grade de chef d’escadron (commandant) et le nomme chevalier de la Légion d’honneur. Enfin, le 20 juillet 1906, conformément à son souhait, Alfred Dreyfus reçoit la Légion d’honneur dans la petite cour de l’École militaire.
L’Affaire dans l’histoire et au présent
Enfin, Vincent Duclert explore la postérité de l’affaire Dreyfus, son impact sur l’histoire de France et sa mémoire collective.
Si l’affaire Dreyfus est devenue un sujet majeur pour les historiens, elle a aussi engendré l’émergence de l’extrême droite moderne, caractérisée par des idéaux racistes et xénophobes. En outre, elle n’a pas protégé la France de la résurgence de l’antisémitisme.
Le centenaire de 1894, qui commémorait le premier procès de Dreyfus, a été un événement historique et médiatique, mais il n’a pas eu de portée politique majeure. En revanche, le centenaire de 1998 a été pleinement assumé par les autorités politiques, tout comme le centenaire de 2006, qui célébra la réhabilitation de Dreyfus. Ce dernier fut particulièrement remarquable par la manière dont les hommages publics se sont appuyés sur une approche historienne, conférant ainsi aux commémorations une véritable « profondeur savante ».
De plus, les travaux scientifiques ont pu s’exprimer dans un cadre public élargi, enrichissant la compréhension de l’affaire. L’investissement dans la connaissance de l’affaire Dreyfus se poursuit aujourd’hui, en France et à l’étranger, avec des promesses de recherches sur la dimension mondiale de cet événement historique.