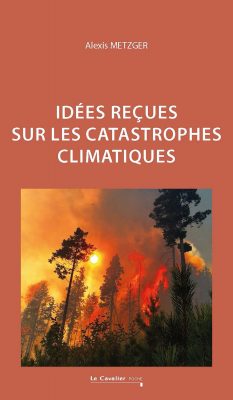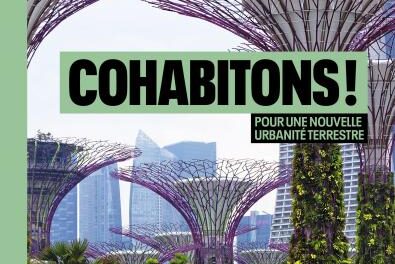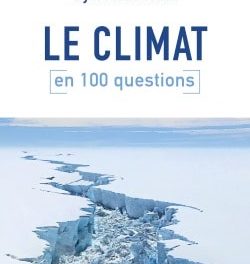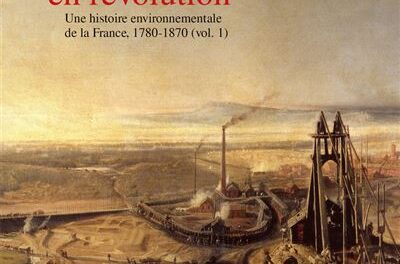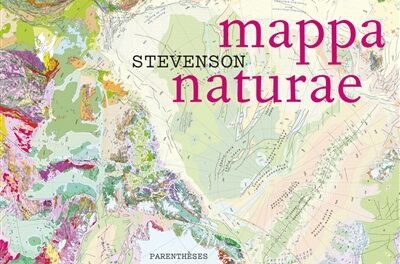L’ouvrage proposé ici par Alexis Metzger, enseignant-chercheur en histoire et géographie des paysages à l’école de la nature et du paysage de Blois, entend éclaircir quelques idées communément admises sur les catastrophes climatiques.
Si la catastrophe peut s’entendre comme la survenue inhabituelle d’un extrême climatique, il est à noter qu’il y a parfois des périodes plus riches en extrêmes et qu’en ce cas, c’est l’ampleur qui constitue la catastrophe. L’action de l’homme transforme l’aléa en désastre et chaque catastrophe est unique, propre à un territoire.
Le propos débute sur des considérations historiques et révèle qu’il est difficile d’établir un lien entre climat et évènement historique, les causes étant nécessairement plurielles : la disparition de la civilisation Maya par exemple, a sans doute été davantage le fait de conflits que d’une sécheresse et d’un manque de disponibilité en eau.
Les catastrophes sont visibles dans l’art et il y a subjectivité et déformation : la catastrophe est-elle minorée ou exagérée ? La technique employée était-elle in situ ou une reconstitution a posteriori ?
La dimension stratégique est abordée : le rôle des prévisions météorologiques (pluies, froid) durant les conflits de tranchées de la Première Guerre Mondiale ont joué leur rôle.
L’auteur interroge longuement les conséquences des catastrophes : y-a-t-il égalité des territoires touchés ? Tout dépend de la densité des secteurs concernés et s’il y a eu des choix politiques d’autoriser des constructions sur des zones sensibles…
Sur l’idée que ces catastrophes entraineraient des migrations massives, il est à noter que ce ne sont pas que les pays les plus pauvres qui voient leurs populations partir, il y a également un coût à revenir sur place.
Les petites îles, souvent prises en exemple, verront peut-être leur élévation naturelle comme suffisante pour palier la montée des eaux. Elles jouent la carte de la recherche d’aide internationale via la médiatisation de leur situation.
Les mégafeux sont également causés par une mauvaise gestion des forêts. Et s’il y a hausse de la pluviométrie, il peut y avoir croissance d’une forêt qui sera mal délimitée, sans compter les incendies volontaires parfois. Mais il est indéniable que la hausse de la température sera un déclencheur en raison de la sécheresse des espaces.
Concernant la possible surmortalité liée aux chaleurs et aux froids extrêmes, ce sont aussi les agents pathogènes en hausse avec la chaleur et l’humidité qui peuvent faire des ravages.
Il y a, sur le fond, un problème à associer des catastrophes d’aspect spectaculaire (dont nos sociétés de l’image sont friandes) à un changement à la progression lente et donc non spectaculaire…
Quelles adaptations ? Des plans, de la résilience, des déplacements…On assiste à une hausse du prix des maisons construites sur des terrains situés plus haut : verra-t-on une gentrification climatique ? De plus, aller vers les infrastructures de protection, c’est prendre le risque de s’exposer au pillage de son domicile.
Sur les arbres, la captation de CO2 s’avère assez limitée, le rafraichissement se veut correct autour des parcs mais limité dès que l’on s’en éloigne et il y a nécessité d’arrosage.
L’impasse de la géoingénierie est soulignée.
Est-ce qu’il y a de plus en plus de catastrophes climatiques ? C’est difficile à dire finalement et les courbes des assureurs sont pertinentes sur le critère du coût de l’indemnisation mais c’est tout…
Il convient de faire attention aux photographies chocs, dépolitisées…Il serait parfois judicieux de montrer des séries d’images pour expliquer des évolutions et aussi de faire des vis-à-vis pour permettre des comparaisons.
Le terme de « quantophrène » est posé sur la fin du livre, intéressant, pour expliquer cette quête insatiable de l’explication chiffrée permanente.
On l’aura compris : loin de l’auteur, l’idée de minimiser le changement climatique et ses conséquences, ses derniers mots invitant à l’action ! A notre échelle d’enseignant, on pourra donc s’appuyer sur ce petit opus et sa riche bibliographie pour aller explorer plus avant les différentes idées exposées et les soumettre à discussion dans les classes.