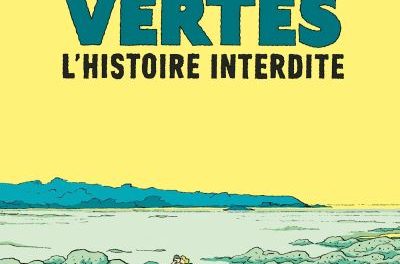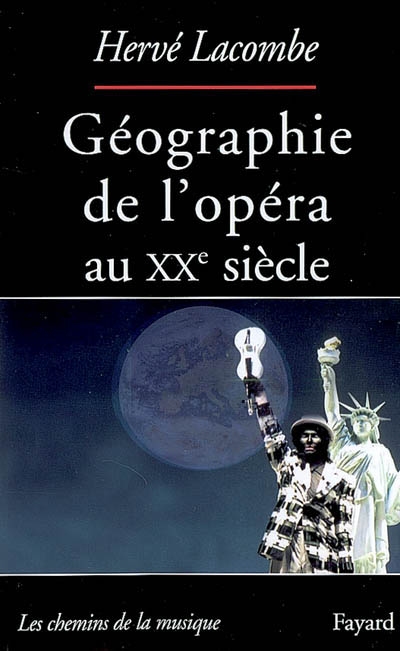
Hervé Lacombe est musicologue et professeur de musicologie à l’université Rennes 2. Spécialiste de la musique française, il a participé à de nombreux colloques et ouvrages collectifs, et publié chez le même éditeur Les Voies de l’opéra français au XIXe siècle en 1997 et une importante biographie de Bizet en 2000, plusieurs fois primés. Responsable de la collection « Études » des publications de la Société française de musicologie, il est le cofondateur et le codirecteur, avec Patrick Taïeb (Université de Rouen et Institut Universitaire de France), d’un groupe de recherches sur le concert en France aux XVIIIe et XIXe siècles : le Répertoire des programmes de concert en France. Il est aussi l’auteur d’une pièce de théâtre musical tirée de L’Arlésienne d’Alphonse Daudet, avec une musique de Georges Bizet, créée à Bougival. Il a dernièrement réalisé la dramaturgie et l’écriture du spectacle Marie-Antoinette, une rêverie en musique, créé au Théâtre de Poissy en mars 2007.
Dans ce livre, Hervé Lacombe se donne pour objectif d’examiner, sans prétendre à l’exhaustivité, la mondialisation du modèle lyrique occidental au XXe siècle : « La traversée du continent lyrique tel que le XXe siècle l’a façonné conduit à mener une double recherche. D’un côté, il convient d’examiner la place et la propagation de l’opéra dans le monde ; de l’autre, sa nature et son fonctionnement. Dire ce qu’est devenu le modèle lyrique occidental nécessite d’en faire la géographie et la physiologie. Le présent ouvrage s’intéressera au premier de ces deux volets. (…) Notre géographie de l’opéra est donc tout autant abstraite (elle renvoie à des représentations, à des structures et des mentalités) que concrète (elle s’inscrit dans la matérialité des pays).» (p. 12). Pour ce faire, Hervé Lacombe articule son propos en deux parties, la première établissant une perspective depuis l’Europe, la seconde dressant un panorama mondial. Chaque partie est illustrée par une sorte d’étude de cas, l’analyse d’un opéra de Krenek (1900-1991), Jonny mène la danse (1927).
Dans sa première partie, Hervé Lacombe s’attache tout d’abord à périodiser le XXe siècle lyrique. Il conclut à l’impossibilité de donner une date butoir, mais voit en l’opéra de Debussy, Pelléas et Mélisande (créé sur scène en 1902) la négation de l’opéra historique et de l’opéra vériste, et le début de l’ « après Wagner ». L’opéra du XXe siècle est ainsi défini comme un quadruple défi : défi de l’après Wagner (particulièrement illustré par Stockhausen) ; défi socio-politique (critique sociale et engagement politique / emprise du social et du politique) illustré par les cas de Kurt Weill, Luigi Nono et Chostakovitch ; défi de la représentation ou de l’irreprésentabilité du réel, étudié chez Schreker, Schoenberg, Ullmann, Zimmermann, Nono, Glass entre autres ; défi civilisationnel enfin : « étendre sur les territoires les plus éloignés de son origine européenne le modèle lyrique occidental ; associer, confronter, mêler dans le creuset du théâtre lyrique occidental toute sorte de cultures ; inversement, du point de vue externe à l’Europe, s’emparer du modèle lyrique occidental, le faire sonner depuis une autre culture et faire chanter, selon ses impératifs esthétiques, des langues nouvelles. » (p. 64).
Pour Hervé Lacombe, on peut distinguer dans l’opéra du XXe siècle trois tendances, qui se combinent le plus souvent. La tendance conservatrice, la plus répandue, a pour temps favori « le passé, qu’elle cherche à faire perdurer, éventuellement à actualiser » (p. 66). Il peut s’agir d’un enfermement dans « un répertoire convenu », « des mises en scène empesées » pour « une élite » ou « la classe dominante » ou la « bourgeoisie » (p. 66), il peut s’agir aussi d’avancer dans le présent à partir du passé, comme dans le Palestrina de Pfitzner. La tendance moderniste, son opposé, « reconnait une valeur au présent, au monde actuel, sans passer par un monde ancien où serait établie la norme du beau et du vrai » (p. 70-71) et peut dériver en avant-garde : montante au XIXe chez Schumann et surtout Wagner, elle s’incarne parfaitement au XXe chez Schoenberg. Enfin la tendance cumulative, qui a bénéficié de l’essor des moyens d’enregistrement et de diffusion massive de la musique, « considère, en un vaste mouvement rétrospectif, sans hiérarchie et sans chronologie, l’éventail des possibles et des matériaux déposés par chaque époque – éventail qui s’enrichit sans cesse des expériences nouvelles, sans toutefois leur apporter une valeur supérieure » (p. 74) : elle s’incarne chez des compositeurs comme Stravinsky, Adams, Zimmermann, Berio ou Bussotti.
Hervé Lacombe termine cette première partie par deux chapitres consacrés à la « culture-miroir » et à « stratigraphie et économie du répertoire ». « La culture-miroir perdue dans la reconnaissance de sa propre image telle qu’elle s’est construite dans le passé, attachée exclusivement à la préservation de ce qui fut, tend à devenir une culture-musée » (p. 97) : ce chapitre, organisé à partir de l’analyse de l’œuvre de Richard Strauss après la Première Guerre Mondiale, voit l’auteur s’interroger sur le « son du passé » à l’époque de l’enregistrement sonore et souligner le déplacement de l’intérêt de l’œuvre à son interprétation. Il y analyse aussi le processus du « théâtre dans le théâtre », les rapports entre opéra et patrimoine (« L’opéra de répertoire, répété inlassablement et enregistré, est commis aux fonctions de l’archive et de l’éducation. On a pu lui reprocher, en tant que monument du passé prenant la place d’œuvres nouvelles, d’empêcher d’imaginer un autre monde. » p. 112-113) et l’évolution du rôle du metteur en scène.
Le dernier chapitre, plus géographique, revient sur la notion de répertoire, en soulignant que sa constitution dépend de critères musicaux, mais s’explique aussi par les traditions d’échanges et de circulations des biens et des personnes, les contacts historiques, les langues pratiquées, « les choix politiques et l’organisation des institutions, les mouvements de mode, les usages culturels, les offres de spectacle, ou encore l’histoire des formes de loisir… » (p. 124). Il faut distinguer le « répertoire global » (tout ce qui est joué dans un théâtre, une période, un pays…), le « répertoire ordinaire » (l’ensemble des œuvres devenues habituelles du point de vue des organisateurs, des interprètes et du public, autrement dit le « fond de commerce » des opéras – Verdi, Puccini, Rossini, Donizetti, Bellini, R. Strauss, Bizet, Mozart, Wagner surtout – soit à la fin du XXe siècle une quarantaine de titres, à partir desquels « les pays émergeant sur la scène lyrique internationale se font une idée de l’opéra européen et la proposent à leur public » (p. 129) et le « répertoire particulier » (« répertoire de créations, d’œuvres rarement données, ou encore de re-créations » p. 136). Chaque pays a son propre mode de production du répertoire, centralisé sur Paris en France, disséminé en de nombreux centres en Italie et en Allemagne (le cas de la Finlande est plus largement développé). Hervé Lacombe présente aussi rapidement les lois économiques de la programmation et les grands modes de gestion (gestion en répertoire et gestion en saison), ainsi que l’organisation du réseau international des grandes maisons d’opéra (Opera America depuis 1970 regroupant près de 350 membres institutionnels, Opera Europa depuis 2001 couvrant 28 pays et 91 compagnies).
La seconde partie propose un panorama mondial de l’opéra, avec pour objectif « de repérer et d’indiquer les grands mouvements dans l’histoire de l’opéra se mondialisant » (p. 155). Le XXe siècle apparaît en effet comme un siècle de très forte propagation de l’opéra, dans deux directions : diffusion dans de nouveaux pays d’ouvrages occidentaux tirés d’un répertoire préexistant ; offre dans ces pays d’un modèle lyrique utilisable par de nouveaux compositeurs pour créer de nouvelles œuvres entrant dans le répertoire général de l’opéra. Cette expansion se fait sous trois formes selon Hervé Lacombe. Une première phase de diffusion de l’Italie à l’ensemble de l’Europe est étudiée depuis le XVIIe siècle, en insistant sur le rôle, à partir du XIXe siècle, des revendications nationalistes qui trouvent dans l’opéra un lieu d’expression particulier (mise au point d’un répertoire national dans la langue nationale), qu’il s’agisse de l’Italie, de l’Allemagne, de l’est de l’Europe ou plus tard d’Israël. Lui succède une phase de colonisation, qui voit le modèle lyrique occidental s’étendre à d’autres continents comme l’Amérique (latine dès le XVIIe, du Nord à partir du XVIIIe) et aux grands empires coloniaux anglais et français, et se maintenir/développer dans la période post-coloniale (sont étudiés en particulier les cas du Mexique, de l’Argentine, des Etats-Unis et de la place des chanteurs et compositeurs noirs, mais aussi la disparition de l’opéra d’Algérie et du Maroc après la décolonisation). Enfin vient une phase d’acculturation, qui peut être « institutionnelle (on importe théâtre et répertoire occidentaux) ou créatrice (des artistes « locaux » intègrent les savoirs venus d’Europe et usent du modèle lyrique occidental pour des réalisations personnelles). » (p. 197). C’est ce qui se passe en Turquie, en Égypte, en Mongolie, au Japon, en Chine, à Singapour.
Les conséquences de cette expansion sont multiples : constitution d’une « Babel lyrique » car l’opéra mondialisé s’exprime dans une multitude de langues ; inscription dans la pierre par la construction de salles de concerts et de théâtres d’opéra comme l’Opéra de Shanghaï (1998) ou le Grand Théâtre National de Chine à Pékin (2007) ; constitution de l’opéra comme modèle artistique et outil de reconnaissance pour d’autres musiques (pop, rock par exemple) ; brassage culturel par intégration de formes sonores étrangères, qui conduit parfois à l’ «opéra métis » (p. 261), mais surtout à redéfinir le couple « Occident/Autre » dans un double mouvement d’intégration et de singularisation (étudié à partir des exemples de la Russie et de l’Irlande), bref à remettre en cause un impérialisme culturel occidental, tout en se l’appropriant et en l’adaptant à la multiplicité des cultures. « Miroir occidental du monde, l’opéra reflète la persistance de la diversité des cultures. Car l’acceptation d’un modèle étranger ne signifie pas, pour un compositeur, l’abandon total de sa tradition locale, de sa langue, de sa sensibilité. » (p. 254). Plutôt qu’un renoncement total, Hervé Lacombe y voit – à partir de l’exemple de l’Azerbaïdjan – « un mouvement d’adaptation et de négociation à partir d’une plateforme idéologique » (p. 255) commune participant de la mondialisation. « Pour des pays émergents, la mise en place d’une maison d’opéra se révèle souvent un moyen d’intégration, une sorte de preuve d’excellence dans le domaine de l’art, et une manifestation de bon vouloir et de positionnement dans la civilisation porteuse (l’Occident). Il n’est pas question de la civilisation en tant que degré élevé d’évolution… » (p. 255) mais d’un signe d’inscription dans la communauté internationale et la modernité, d’un « marqueur de civilisation », d’une forme particulière de la « culture internationale » (p. 256). C’est non seulement une affaire d’élites locales mais aussi la conséquence d’une internationalisation des élites. « Le modèle lyrique occidental mondialisé est l’instrument d’une connexion à la plateforme culturelle liée à une sphère sociale élevée et commune aux pays s’inscrivant dans le monde moderne (…). Il permet tout à la fois d’exprimer une singularité visible – c’est-à-dire très exactement de « se faire entendre » – et de manifester une capacité à prendre place dans un ensemble codifié valorisant, de dimension internationale. » (p. 258)
Au total, c’est un ouvrage très riche et stimulant, un peu déconcertant dans ses quatre premiers chapitres qui s’appuient sur des analyses esthétiques et musicologiques peu familières (d’autant que le lecteur n’a pas forcément entendu les œuvres étudiées : une bonne occasion de découvertes donc !), plus aisé à lire ensuite quand le recours à l’histoire se fait plus fréquent. On y puisera de nombreux exemples qui peuvent être réutilisés tant en Première qu’en Terminale, en histoire qu’en géographie. On ne peut s’empêcher cependant de penser que le titre de l’ouvrage ne reflète pas vraiment son contenu. C’est moins une géographie de l’opéra au XXe siècle qu’une histoire culturelle de sa mondialisation qui nous est proposée, sauf dans les chapitres VI, IX et XII. Qu’on ne s’attende donc pas à cette géographie des réseaux qui domine les programmes de lycée : l’ouvrage ne propose ainsi que trois cartes de localisation, toutes européennes, et n’utilise que peu d’ouvrages de géographie (Foucher et Claval sont surtout cités dans les notes). On serait plus dans une géographie culturelle ou, dans la lignée des travaux de Serge Gruzinski, de Jean-Paul Warnier ou de Serge Latouche sur la mondialisation, dans une anthropologie historique. Des pistes sont ouvertes, qui demanderaient à être creusées, par exemple sur cette question du théâtre d’opéra comme signe d’inscription dans une culture internationale (à la lumière par exemple de l’inauguration le 22 décembre 2007, sans fanfare, de l’Opéra de Pékin construit par Paul Andreu), sur ses liens avec l’archipel métropolitain mondial et avec les villes mondiales, sur l’économie mondialisée de l’opéra en tant que spectacle, etc.