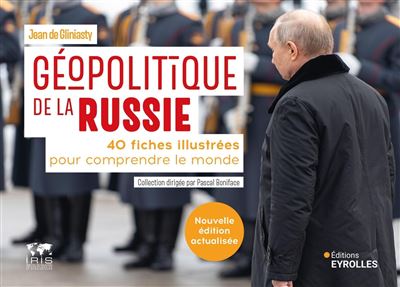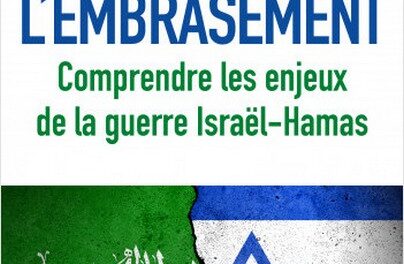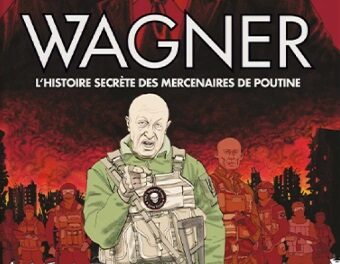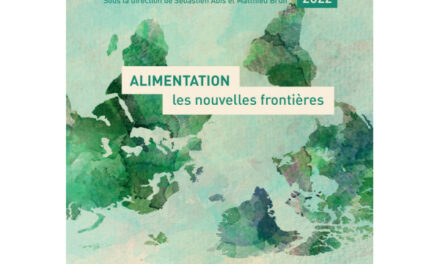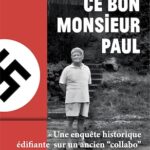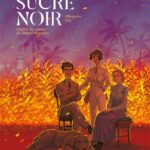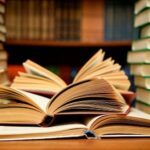Les vieux démons
Dans une très brève introduction, l’auteur rappelle « le retour de la Russie à ses vieux démons » tant en politique intérieure qu’étrangère. La Russie poutunienne s’oppose à l’Occident en cherchant à s’appuyer sur un « Sud global ».
L’auteur, Jean de Gliniasty, a eu une riche carrière de diplomate, notamment comme ambassadeur de Russie. Il est aussi directeur de recherche à l’IRIS. Il publie en 2025 une nouvelle édition actualisée (la première date de 2018) de cette Géopolitique de la Russie, aux éditions Eyrolles, dans une collection dirigée par Pascal Boniface.
En 184 pages, l’ouvrage comporte 40 fiches, toutes illustrées. Il contient un index et une bibliographie en français (manifestement pas actualisée depuis l’édition de 2018).
Asie ou Europe ?
Dans la première fiche, partie 1 de présentation générale, l’auteur insiste sur l’eurasisme, et même le néoeurasisme russe, antioccidental, qui explique les relations de la Russie avec ses voisins, notamment issus de l’ex URSS, et l’échec de la CEI de Boris Elstine. Ceci donne naissance à des cadres institutionnels, dont l’OTSC (Organisation du traité de sécurité collective), souvent sur le modèle européen, à ceci près qu’il existe un énorme déséquilibre de puissance entre la Russie et les autres partenaires. Cet antioccidentalisme apparaît idéologique et comme un retournement de la thèse de Samuel Huntington.
Outre les 40 fiches, le livre comporte aussi des « focus », par exemple la présentation de Piotr Tchaadaev (XIXe s), idéologue de la réforme pour qui il n’y a pas de salut pour la Russie en dehors de l’Europe, ce qu’avait compris Pierre le Grand.
Des pages font une bonne place à l’histoire, que ce soit la carte de l’Etat de Kiev aux IX-Xe s., ou la fiche sur l’économie russe tout au long du XXe s., d’ailleurs remarquablement dense et concise. Les données statistiques sont bien mises à jour, tenant notamment compte de la guerre en Ukraine.
Ainsi, on peut lire qu’en 2023 l’Inde et la Chine représentent 60% des exportations de pétrole russe. L’auteur rappelle aussi utilement que le GNL n’est pas sous embargo, ce qui permet encore à la Russie de financer son effort de guerre. Dans ce contexte de guerre, la paix civile est maintenue notamment par une couverture sociale substantielle (2e poste du budget après la Défense).
Est posée l’épineuse question du régime politique russe. L’auteur revient sur l’héritage soviétique et sur la constitution de 1993 inspirée de la Ve République française. Il montre comment le président (Poutine) exploite les souplesses de la constitution, cumule les pouvoirs, plus encore parce que les quatre grands partis de la Douma ont fait allégeance. Son pouvoir est d’autant plus fort qu’il a la haute main sur le FSB, la police, l’armée. Concernant la liberté de la presse, le pays passe de la 121e place en 2002 à la 162e en 2024 (sur 180 pays). Les gouverneurs, nommés par le président, s’avèrent plus jeunes et obéissants car sans clientèle locale. Les tensions internationales servent les intérêts de Poutine et son programme de « verticale du pouvoir ». Un organigramme plus complet que celui proposé (page 37), montrant les interactions entre pouvoirs, aurait été bienvenu.
L’auteur montre donc le durcissement sur régime et évoque les emprisonnements politiques, tout en admettant que le nombre de détenus (266000) est le plus bas depuis 80 ans : des délits ont été déclassifiés (litiges économiques) et des condamnés ont été envoyés sur le front ukrainien.
Des pages sont consacrées à la puissance militaire (au-delà ses capacités de son économie : « puissance du pauvre »). L’instrument militaire représente maintenant 7% du PIB. Il a encore gagné en puissance avec les missiles hypersoniques. C’est la flotte de haute mer qui s’avère la moins au niveau. Depuis la doctrine Kouznetsov (mort en 1974), la défense du littoral prévaut. L’actuelle doctrine militaire intègre désormais le concept de guerre hybride. Depuis 2020 la Russie a publié une doctrine nucléaire spécifique qui definit les cas d’emploi de l’arme nucléaire. Celle-ci a été complétée en 2024 (attaque contre la Biélorussie, soutien d’une nation nucléaire à une attaque menée par une puissance non-nucléaire – l’Ukraine). L’emploi en premier de l’arme nucléaire est aussi prévu : emploi tactique selon le concept « d’escalade pour la désescalade »).
Enjeux stratégiques
Après la présentation générale de la Russie, l’auteur étudie « dix enjeux stratégiques ». Par exemple, est posée la question de l’hypothèse de la reconstitution de l’URSS. Si la nostalgie est puissante, le retour au passé s’avère impossible. D’ailleurs la chute continue des performances électorales du PC en est l’une des preuves.
L’une des questions les plus stimulantes est celle-ci : La Russie a-t-elle perdu Ukraine ? Le mot Ukraine signifie « territoire des confins », considéré comme le berceau de la civilisation russe. Pour autant, le territoire connaît une histoire au confluent de différents groupes ethniques, linguistiques, religieux, idéologiques. Un sentiment national ukrainien existe, cimenté par le souvenir de l’Holodomor. Jean de Glianisty revient sur le balancement entre pro-Russes et pro-Occidentaux, la Révolution orange en 2004 et Maïdan en 2014. Avec l’invasion de la Crimée puis celle de 2022, le divorce est désormais bien consommé.
Parmi les nombreux autres thèmes, on citera l’influence russe en Asie centrale (en baisse), et l’équilibre évolutif avec la Chine. Ce sujet permet d’ailleurs un focus sur le projet chinois BRI. D’autres enjeux sont traités, concernant le Caucase, le djihadisme et les séquelles des guerres d’Afghanistan, les liens entre Poutine et Assad, la présence russe en Afrique qui a toutefois du mal à s’affirmer.
Société russe
La troisième partie s’interroge sur la société russe. L’une des questions est « la Russie est-elle une dictature ? » Après l’URSS, la constitution de 1993 a créé un exécutif fort, notamment parce que Elstine avait besoin d’un tel pouvoir pour sa « thérapie de choc ». Poutine s’en est servi pour sa « verticale du pouvoir ». Le pouvoir autoritaire parvient néanmoins à se faire légitimer par les urnes, avec bien entendu l’éviction de candidatures gênantes. Il n’empêche que la majorité de la population russe trouve cela normal et souhaitable : la période Elstine a discrédité les valeurs libérales et démocratiques. La guerre en Ukraine, présentée comme une réponse à l’agression occidentale, a renforcé l’élan patriotique. Avec la réforme constitutionnelle de 2020, approuvée par referendum, Poutine pourra se présenter à nouveau en 2030, pour un mandat de six ans.
Viennent ensuite des pages sur le retour de la religion, le rapport à l’histoire, etc.
Défis
Enfin, la 4e partie termine l’ouvrage avec les défis de ce pays : l’hypothèse d’une future normalisation avec l’Occident, la question de la sécurité en Europe, la baisse démographique et l’enjeu de l’immigration (et l’intégration des migrants, notamment musulmans), la lutte contre la corruption, les inégalités sociales, etc.
Des défis territoriaux majeurs sont passés en revue : la développement de la Sibérie et la concurrence chinoise, la frontière arctique et la route du nord rendue plus accessible avec le réchauffement climatique.
La 40e et ultime fiche demande quelle pourrait être la succession de Poutine. Medvedev a pu paraître comme potentiel successeur, mais parmi ses faiblesses il y a le fait que celui-ci est accusé de s’être fait « rouler » par les Occidentaux dans la crise libyenne. L’expérience « libérale » Medvedev n’a donc pas semblé concluante. A priori, rien ne laisse présager une alternance. La passation de pouvoir (avec qui ?) devrait avoir lieu sous étroite surveillance.
Un ouvrage sérieux et pratique
En somme, cet ouvrage apparaît pratique, bien organisé, clair et argumenté. Le format de fiches-questions permet de parcourir le livre dans l’ordre souhaité, selon les centres d’intérêt ou les besoins du lecteur. C’est son principal atout. Les focus, avec graphiques, cartes, infographie, pourraient utilement servir aux collègues : les documents sont accessibles à des lycéens et accompagnés de notices concises. Un ouvrage sérieuse de moins de 200 pages et bien plus dense qu’il n’y paraît.