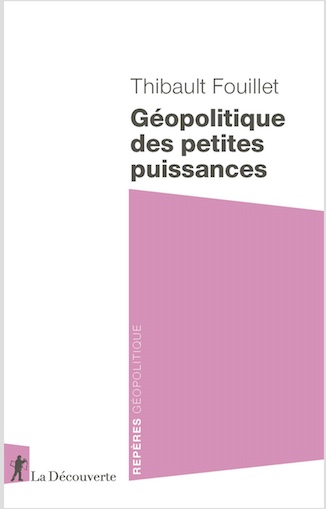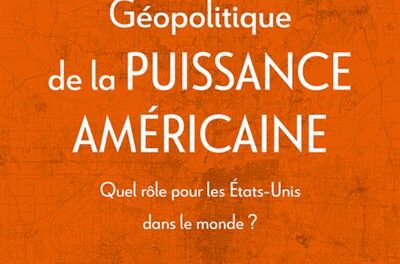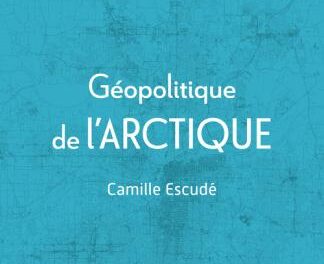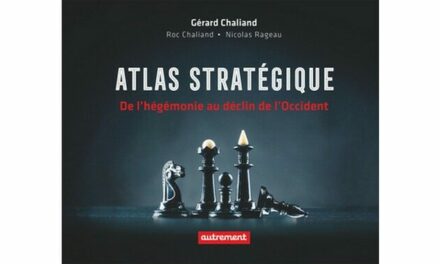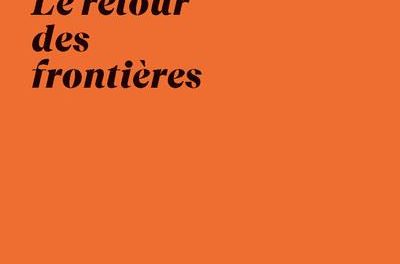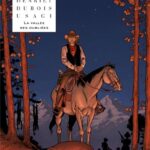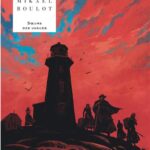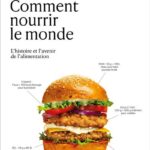Etats-Unis, Russie, Chine ou encore Inde : dès qu’on parle de puissance, certaines références s’imposent comme une évidence. Thibault Fouillet, docteur en histoire et spécialiste des études stratégiques, propose un pas de côté en se penchant sur les petites puissances.
Concepts et méthodes
Un Etat n’est pas qu’une puissance militaire ou une population. Sa situation dépend du contexte régional et mondial dans lequel il évolue. La puissance est conditionnelle. Avant tout, il convient de définir cette notion de petite puissance. D’emblée, l’auteur précise qu’il n’en existe pas de définition consensuelle. En tout cas, comprendre la géopolitique des petites puissances revient à abandonner la lecture traditionnelle des relations internationales, centrée uniquement sur les grandes puissances. Les petites puissances veulent conserver leur indépendance et autonomie de décision, assurer leurs intérêts par le recours à des alliances et développer leurs avantages par la spécialisation dans des secteurs de niche. L’auteur s’appuie notamment sur le cas de Singapour.
La géopolitique des petites puissances : une problématique actuelle
Les petites puissances profitent de l’ouverture mondialisée. Le cas de la Corée du Sud et de sa domination mondiale dans la téléphonie et les ordinateurs, à parité avec les Etats-Unis, est symptomatique de cette diversification de la puissance. L’auteur s’arrête ensuite sur les petites puissances dans les conflits contemporains à travers les exemples de Taïwan et de l’Ukraine. Ce ne sont pas les seuls cas si l’on pense à Israël ou encore aux petites puissances en Afrique. Elles sont devenues des acteurs incontournables de la politique étrangère.
Hard power et petites puissances : une efficience réelle
Il s’agit de battre en brèche l’idée reçue de leur incapacité militaire et diplomatique. En effet, elles peuvent disposer d’un poids diplomatique régional et développer une force militaire crédible et une stratégie pertinente. L’OTAN est un bon exemple de développement des capacités de survie pour les petites puissances européennes. Autrement, le fait de ne pas apparaître comme une menace potentielle suscite une confiance naturelle. Etre une petite puissance permet une spécialisation diplomatique qui la place à la pointe d’une question internationale. Pour illustrer cela, Thibault Fouillet prend les exemples de la Lituanie et du Costa Rica. Il reprend également le cas de Singapour qui a développé progressivement une réelle capacité militaire. Cette armée est aujourd’hui capable de défendre son territoire, de conduire des opérations offensives dans la profondeur. Pour estimer la situation, il faut également tenir compte du fait qu’on évolue en situation de guerre irrégulière ou de guerre de haute intensité. Diplomatie comme puissance militaire sont des atouts non négligeables que les petites puissances peuvent mettre en œuvre avec efficacité.
Les voies alternatives de la puissance : moyens géopolitiques privilégiés des petites puissances
Quatre aspects sont à prendre en considération : les ressources naturelles, le pouvoir bancaire et financier, le pouvoir technologique et le pouvoir culturel. Pour les ressources naturelles, il faut trouver une balance entre la dépendance technologique envers des exploitants étrangers et une maitrise nationale des revenus de ces matières premières. Cette exploitation peut permettre de devenir leader d’une niche. Un des exemples les plus emblématiques est le Qatar. L’auteur s’arrête ensuite sur le pouvoir bancaire et financier. Deux aspects le constituent : l’atout de la fiscalité et la maitrise des flux financiers. Le pouvoir technologique peut être lui illustré par la Corée du Sud. Enfin, au niveau culturel, trois aspects sont à retenir : la création d’un modèle de vie attractif, le développement d’une présence mondialisée par la capitalisation sur les diasporas et le leadership religieux ou culturel pour devenir une référence.
Des limites structurelles qui demeurent
Il ne faudrait pas tomber dans le « small is beautiful » et l’auteur entreprend donc de souligner les limites des petites puissances. L’hégémonie militaire est impossible. La capacité régionale reste le fruit d’un contexte régional particulier. Deuxièmement, la puissance économique reste volatile. Enfin, un parrainage des grandes puissances reste souvent indispensable. Afin de mieux comprendre, Thibault Fouillet développe les cas de Singapour et du Qatar.
En conclusion, l’auteur insiste sur le fait que la géopolitique mondiale est influencée par les petites puissances. Il invite à considérer leur poids, que ce soit en terme de hard ou de soft power. Elles parviennent souvent à développer des compétences de niche. Cet ouvrage offre un angle original et est très utile pour la spécialité HGGSP en Première autour de la question sur la puissance.
Pour en découvrir un extrait, c’est ici.