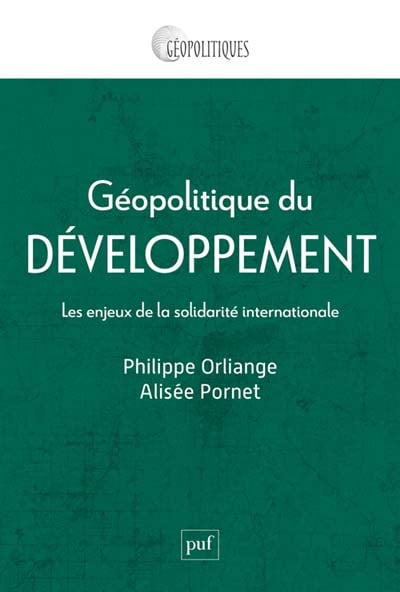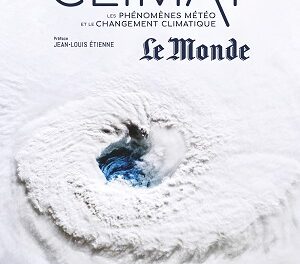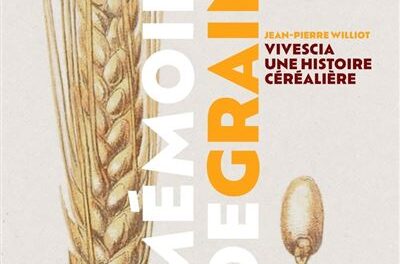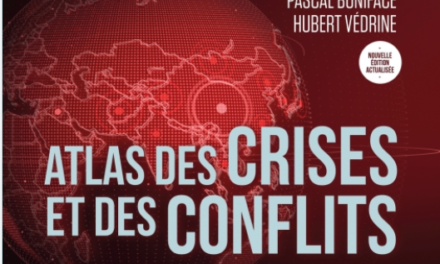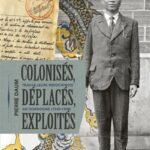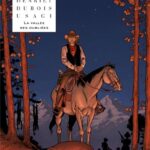L’actualité, avec les décisions récentes du président Trump, a remis en lumière le système de l’aide au développement, né aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale. Cet ouvrage Géopolitique du développement présente l’évolution et la situation actuelle de l’aide internationale.
Géopolitique et Développement
Quels sont les liens entre ces deux termes ?
La géopolitique d’un développement n’est pas seulement la politisation de l’aide publique au développement. Les auteurs définissent les mots. Les relations entre développement et géopolitique sont des « impensés de la littérature en relations internationales ». (p. 29)
Les auteurs rappellent les différentes conceptions du développement : économique, fonctionnaliste et les critiques ; une approche théorique intéressante. Il faut attendre le XXIe siècle pour que la dimension politique et géopolitique de l’aide soit théorisée.
Dans un second temps, l’approche devient épistémologique de l’héritage de l’école française de géopolitique à l’évolution vers une géopolitique au service de la stabilité mondiale.
Pour comprendre la compétition stratégique entre les USA et la Chine, les auteurs font référence au « piège de Kindelberger » qui établit un lien entre les biens publics mondiaux, la stabilité internationale et la transition de puissance :
« Si une ancienne puissance hégémonique n’a ni la volonté ni la capacité de fournir les biens publics mondiaux nécessaires, alors les puissances émergentes sont incapables ou refusent de le faire, un vide de leadership se crée dans la gouvernance mondiale et conduit à une instabilité globale. » (p. 51-52)
Dans la littérature des relations internationales, les choix du développement sont considérés comme neutres et choix souverains des États.
De la coopération à la compétition stratégique
Ce chapitre retrace les évolutions du concept de développement et des étapes de l’aide publique, de la définition par TrumanIntéressante carte des pays éligibles à l’aide américaine en 1952. On remarque l’absence de l’Afrique noire, encore coloniale à cette date. (p. 63) jusqu’aux ODD.
Coopération et compétition sont présentes dès le début, dans le contexte de la Guerre froide et en lien avec l’ONU. Les diverses formes de l’aide APD sont décrites en détail. Les acteurs privés, comme la fondation Gates, ne sont pas oubliés.
On assiste aux grandes étapes de la mise en œuvre de l’aide de la reconstruction de l’après-guerre à Bandung, consensus en pleine Guerre froide. Le rôle des Nations Unies et ses différentes agences (FAO, OMS, HCR…) avec les outils financiers (FMS, Banque mondiale) tient une grande place dans ce chapitre. À partir de 2015, on parle de fragmentationÀ noter un focus sur l’aide chinoise pendant la COVID avec une vive critique de la coopération internationale.
Géopolitique du développement et Sud global
Les thèmes abordés dans ce chapitre : les biens publics mondiaux, la gouvernance des instances internationales.
Les auteurs décrivent longuement le consensus de Pékin, une alternative au modèle occidental. Ils abordent d’autres modèles : Brésil, Inde, Turquie, Russie, Émirats Arabes Unis.
La solidarité occidentale à l’épreuve des crises
Trois crises affectent aujourd’hui la solidarité internationale :
- La critique de la capacité universaliste à répondre aux urgences
- Une crise de la mobilisation financière, du fait des tensions budgétaires en Europe et de la concurrence des investissements dans la défense.
- La remise en cause de l’idée même de solidarité internationale par les opinions publiques du Nord dans un contexte où les enjeux nationaux dominent.
Les difficultés sont renforcées par la remise en cause du multilatéralisme, notamment aux États-Unis. La prévention des crises et la consolidation de la paix sont mises à rude épreuve.
Pour une géopolitique de la solidarité
Partant des négociations récentes, au sein de l’OMS, du projet d’accord sur le « renforcement de la prévention, la préparation et la riposte face aux pandémies (avril 2025), Philippe Orliange et Alisée Pornet montrent les fragilités actuelles : fragmentation de l’aide, surdétermination géopolitique de l’aide, par exemple la conditionnalité migratoire.
« La chute de l’aide publique à destination des pays les moins avancés, au prétexte de leur absence d’intérêt stratégique direct pour les pays donateurs, constituerait un virage idéologique préoccupant (p. 190)
Les auteurs développent une piste de réflexion : passer de l’aide à l’investissement public mondial.
Voilà un ouvrage qui fait un point utile sur les conceptions du développement, de l’aide et leurs évolutions depuis 1945 et devient une base utile pour tout enseignant de lycée.