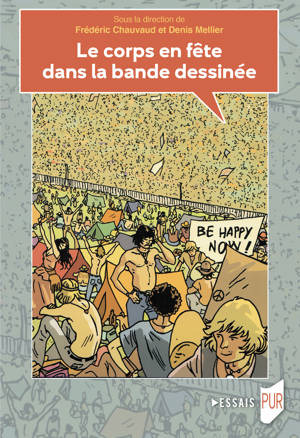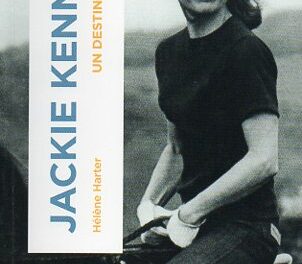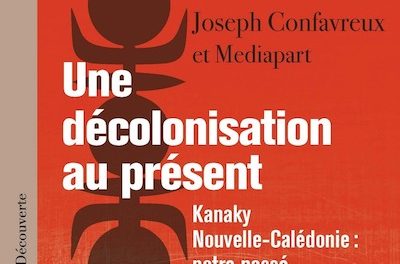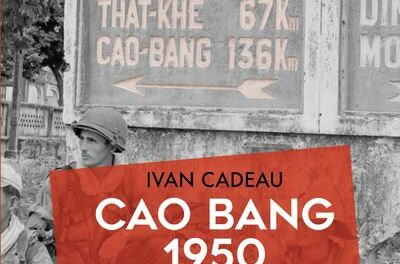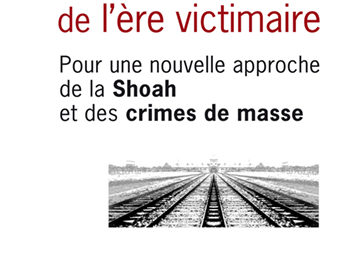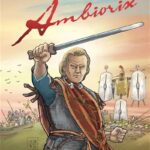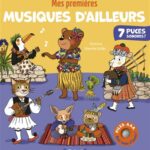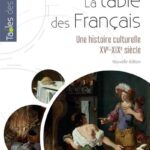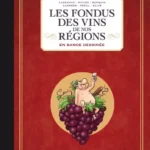Cet ouvrage n’est pas à proprement parler un ouvrage d’historiens. C’est un ouvrage écrit à multiples mains, par des historiens certes, mais aussi des philosophes, des conservatrices, des professeurs de lettres et des spécialistes de l’art, bref, tout un panel de disciplines, de spécialités et de passions pour mettre un valeur un art trop souvent rangé, par un public médisant et inculte, dans la catégorie « c’est pour les enfants ».
La bande dessinée franco-belge, et pire encore, le manga et le comics, sont rangés trop souvent du côté des productions artistiques dénuées de tout intérêt intellectuel, du simple divertissement qui ne permettrait pas à celui qui en profite d’apprendre de « vraies » informations, de s’épanouir et de s’enrichir intellectuellement.
Pourquoi démarrer cette critique par des propos aussi durs? Tout d’abord, parce que c’est une rengaine qui court dans notre société, y compris et surtout en salle des professeurs de nos établissements. Ensuite, et surtout, parce que c’est la force de cet ouvrage de nous montrer toute la complexité, toute la richesse, tout le travail qu’il y a derrière la réalisation d’une bande dessinée, de la France au Japon, en passant par les Etats-Unis.
Pour les plus sceptiques, voici un extrait du sommaire de cet ouvrage: « Corps sur scènes, corps en fête ? Du théâtre sur les planches, de Doré à Masbou ; La défaite du corps en fête ? Occurrences, enjeux et déconstruction des lieux communs dans Dragon Ball ; Fête, carnaval, corporalité dans la BD conte de fées de Grimm : Les musiciens de Brème, Cendrillon ; Le blues, le blues, presque rien que le blues ; L’euphorie du corps dansant : Ryoko Yamagishi et le tournant de l’histoire du « ballet manga »; La Bd-SM : s’imaginer agenré(e) ; Aimer, se nourrir, voyager : exploration festive de l’autre chez les femmes dessinées ; Goinfrerie, corps informes et compétitions culinaires dans le manga… »
L’ouvrage est divisé en 3 temps : « l’exploration du corps festif » ; « en chantant, en dansant »; « sexe et nourriture ». Chacune de ces parties mêle donc de multiples formes d’art présents et mis en avant dans des titres de BD plus ou moins connus du grand public.
A travers ces arts, c’est le questionnement de la place du corps dans notre société qui est mis en avant, avec au passage l’ensemble des réflexions sur la question du genre, sur la place de chacun , sur notre rapport au corps.
A travers chacune des interventions des auteurs, c’est aussi une réflexion sur le dessin, le graphisme, la manière dont les auteurs de BD et les lecteurs s’approprient les corps, les mettent en valeur, les déforment, les caricaturent..
Derrière tout cela, il y a aussi une réflexion sur le contexte religieux, philosophique, sociétal de l’utilisation par l’Homme de son propre corps. Avec, en filigrane, les préjugés et leur dépassement, les contraintes morales et leurs processus de libération.
Dernier avantage majeur de ce livre: le nombre de références hallucinantes faites par les auteurs. Au-delà des notes classiques de bas de page, toutes les interventions mentionnent, au final, des dizaines de spectacles de danse, de romans, de BD, de musiciens… De Motorhead à Robert Johnson, en passant par les frères Grimm, Akira Toriyama (disparu récemment), les auteurs antiques, les auteurs contemporains… bref, une litanie de références qui permettront au lecteur de se préparer une magnifique pile à lire, à regarder ou à écouter pour cet été.
Une litanie de références qui font le background de tous ces auteurs mis en avant dans cet ouvrage, qui nous font dire chaque jour à quel point la bande dessinée est un univers de foisonnement intellectuel et d’ouverture culturelle. Et, surtout et enfin, qui nous font dire que cet ouvrage est un vrai plaisir de lecture.
Présentation du livre et des auteurs
Frédéric Chauveau est professeur émérite de histoire, contemporaine et coordinateur scientifique du Réseau régional de recherche Nouvelle-Aquitaine en bande dessinée.
Denis Meslier et professeur de littérature générale et comparée.
Tous les deux sont enseignants-chercheurs à l’université de Poitiers, et ont codirigé, en 2023, Squelettes, ectoplasmes et fantômes dans la BD (PUR, coll. « Essai »)
« La fête peut être l’occasion d’une expérience singulière pour les corps dessinés. Elle est surtout une expérience collective où s’assemblent familles et groupes, amis et voisins, tribus et foules. Nul doute que les bals, les défilés, les manifestations, les concerts, les festivals, les cérémonies qui marquent les âges de la vie, ou encore les matchs de boxe, de basket ou de football sont autant de circonstances qui permettent de saisir la puissance expressive des corps. En effet, les rituels, les costumes, les accessoires, les lieux et les parcours, les poses et les comportements, ordonnés ou débridés, sont autant d’occasions d’observer les liens qui unissent les personnages selon les époques et les genres de la bande dessinée. La silhouette, que Georges Vigarello a étudiée, n’est pas la même au XIXe et au XXe siècle et elle se retrouve dans les récits graphiques qui traversent les imaginaires et les cultures.
L’ouvrage, pluridisciplinaire, entend souligner que la fête peut être tantôt inquiétante, tantôt porteuse d’une énergie ludique culminant lors du carnaval ou d’un vaste rassemblement. Mais qu’elle soit conformiste ou subversive, elle nécessite de porter une grande attention à toutes les configurations festives. Elle fait dialoguer, aussi bien dans les bandes dessinées franco- belges que dans les comics ou encore dans les mangas, les forces du rire et de l’effroi, du plaisir et de la retenue, de la codification et de la démesure. Pour mener à bien l’exploration du corps festif, défilent les scènes théâtrales, mais aussi les chants et la musique, du blues au rock, la danse, le sexe et la goinfrerie. »