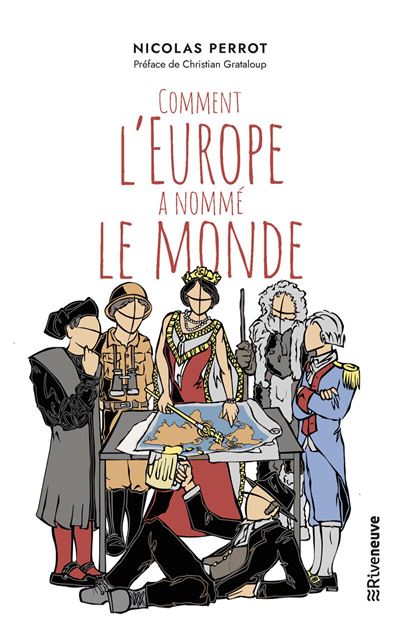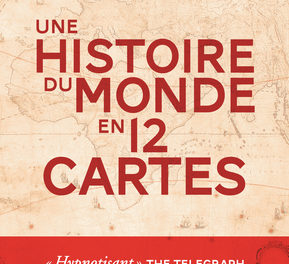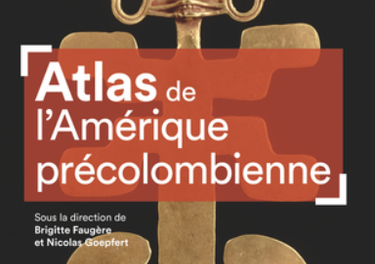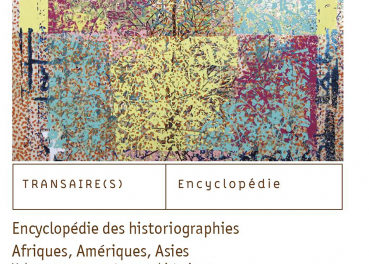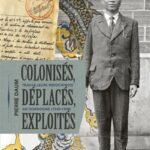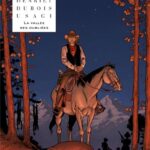Nicolas Perrot, géographe franco-canadien, est passionné de cartographie, il propose ici un voyage en toponymie Comment l’Europe a nommé le monde. À travers les océans, les archipels, les continents il montre l’inspiration européenne de très nombreuses dénominations spatiales.
C’est une invitation à un tour du monde non-exhaustif, chaque lieu est rapidement décrit, son nom vernaculaire cité quand il existe et les choix de dénomination passées ou actuelles explicités. Il rappelle qu’il y a toujours une dimension politique dans le choix d’un nom pour un lieu : descriptif, hommage au découvreur européen ou à une autorité politique.
Après quelques grands repères, des ordres de grandeurs et une grille de départ, le lecteur peut commencer son voyage d’abord, dans une première partie sur les mers et océans puis, dans la seconde partie, sur les continents. Dans chaque chapitre, les différents lieux sont passés par ordre alphabétique.
Comme il n’est pas question de tout retenir, quelques exemples illustreront chaque chapitre.
Les Océans
Pour l’océan Arctique, l’auteur propose une étude détaillée de l’archipel Île d’Anjou, en Sibérie qui doit son nom à son découvreur Piotr Anjou, descendant d’un Huguenot français, en 1820.
Plus classique est la présentation de l’origine de Groenland, quand la « montagne pointue » définit le Sptizberg.
Le nom de l’océan Atlantique, apparut au XIVe siècle, évoque le Titan de la mythologie grecque. La lointaine Sainte-Hélène reçut son nom de baptême du jour de sa découverte, un 21 mai, fête de cette impératrice byzantine, mère de l’empereur Constantin 1er.
L’océan Indien doit son nom au fleuve Singhu, rivière en sanscrit. L’archipel Crozet a été baptisé par Marc Joseph Marion du FresneVoir L’illusion d’un monde commun – Tahiti et la découverte de l’Europe, Antoine Lilti, Flammarion, col. Le présent de l’histoire, 2025 en 1772 du nom de son second envoyé à terre.
Pour le Pacifique, on peut retenir le choix, par Cook en 1774 d’une comparaison avec l’Écosse dans la dénomination de la Nouvelle-Calédonie.
Les Continents
Si l’Asie est finalement peu présente, mais il y avait là des civilisations anciennes et brillantes à l’arrivée des Européens, quelques lieux portent pourtant la marque coloniale à commercer par l’Everest, le Qomolanga des Tibétains ou Sagarmatha des Népalais. L’auteur fait, bien sûr une place à la ville de Constantinople devenue Byzance puis Istanbul.
Les deux continents qui retiennent l’attention sont L’Afrique et l’Amérique où la marque occidentale est la plus forte.
Pour l’Afrique on peut citer le Cap de Bonne-Espérance que Diaz appelait Cabo Tormentoso, appellation jugée pessimiste par le roi Jean II de Portugal qui le rebaptisa.
La toponymie évoque parfois les ressources espérée ou appréciées comme la Côte-d’Ivoire.
Les vicissitudes et compétions coloniales expliquent les noms changeants : au Sénégal, la Palma des Portugais devenue Goede Reede pour les Hollandais, nom déformé en Gorée par les Français.
L’histoire impose ainsi sa marque, notamment à Freetown. Dans un temps plus contemporain, il est vrai que des noms autochtones effacent la trace coloniale.
Le voyage en Amérique conduit, par exemple, le lecteur du Canada, directement tiré du Kanata iroquois : village à l’histoire d’une querelle de limites au New Hampshire qui une fois réglée donne le nom de Concord à la capitale de l’État. Quant à la Californie, elle a une origine romanesque.
Un ouvrage à déguster par petites incursions géographiques pour s’évader du quotidien.