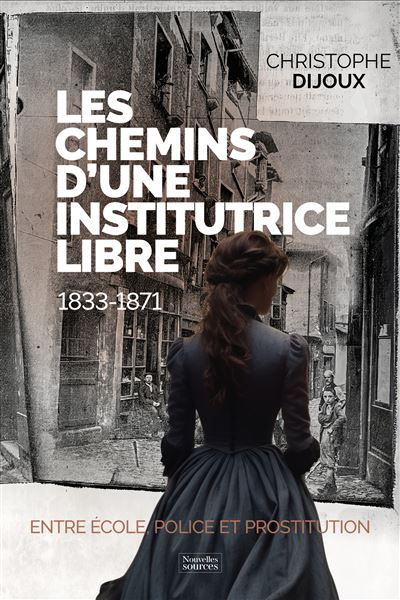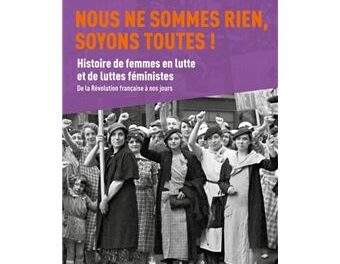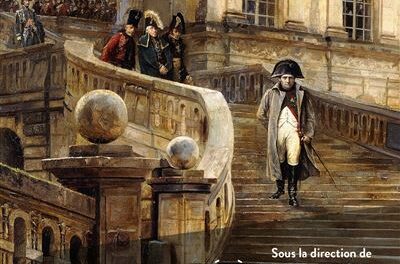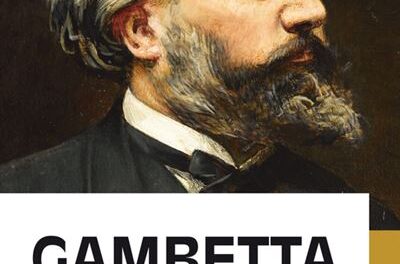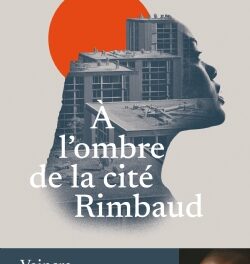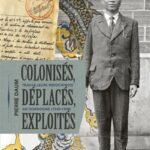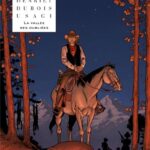Dans la lignée de la microhistoire, Christophe Dijoux a trouvé son Louis-François Pinagot. C’est donc à partir d’une femme Marie Dijoux, chef d’institutrices, femme mariée, 23 ans, retrouvée dans un recensement de 1856 que l’enquête nous mène dans l’éducation avant l’école de Jules Ferry et plus largement dans le Limoges ouvrier et populaire du milieu du XIXe siècle.
La genèse d’une découverte
Christophe Dijoux explique son cheminement de la curiosité généalogique à la recherche historique. Il inscrit son travail dans le courant historiographique né en Italie au milieu des années 1970Carlo Ginzburg, Le fromage et les vers. L’univers d’un meunier frioulan du XVIe siècle, Paris, Aubier, 1976, partir d’un individu pour éclairer les caractéristiques du monde qui l’entoure. C’est donc une histoire à la fois sociale et culturelle. C’est un courant historique présent dans la production actuelle avec les titres comme Les Lumières minuscules d’un vitrier parisien : souvenirs, chansons et autres textes (1757-1802) de Jacques-Louis MénétraDaniel Roche (dir.), Chêne-Bourg, Georg Éditeur, 2023, Marie Bryck et ses frères, une histoire de survie et de destin dans la France du choléraLaurence Giordano, Éditions Payot, 2020, La Femme nue de la rue des Anglais. Enquête sur un crime non élucidéBruno Bertherat, Grenoble, éditions Jérôme Million, 2024, Nicolas Delacour. Le pouvoir au village au cœur du XVIIe siècleJean-Marc Moriceau, Tallandier, 2025.
La microhistoire propose la monographie d’un siteVoisins de passage – une micro histoire des migrations, Fabrice Langrognet, La Découverte, 2023, le parcours d’une famille, une biographie pour réinterpréter la mémoire des hommes à travers l’analyse des structures sociales. L’auteur tente cette reconstitution, conscient des difficultés :
« Les lacunes ou plutôt les découvertes ne sont que le reflet imparfait, parfois trouble, d’une vie qui, à l’époque, ne laissait pas autant de traces qu’aujourd’hui ». ( p. 17)
On choisit ses amis, pas sa famille
Marie-Adrienne est pour une part originaire d’une famille de paysans lettrés de Flavignac, au Sud-Ouest de Limoges. Les enfants d’un second lit perdent, à la mort du père, tous droits à la terre, ils migrent vers la ville à la fin du XVIIIe siècle. Ce sont les grand-père, grands-oncles et grand-tante de Marie-Adrienne. L’auteur reconstitue leur installation en ville grâce aux liens de solidarité avec la famille du marquis de Faye propriétaire des terres de Flavignac. Pour l’autre part, la grand-mère de Marie-Adrienne est aussi née dans une famille arrivée à Limoges à la fin du XVIIIe siècle et venue de Chalus. La famille a une histoire trouble : reconnaissance tardive de leurs enfants, tenue d’une maison close, le début d’une aisance faute de respectabilité.
L’auteur reconstitue minutieusement l’environnement familial à chaque génération. Il décrit au XIXe siècle le milieu des tailleurs, profession du père et du mari de Marie-Adrienne.
La grand-mère Anne PouretLe mariage entre Jean-Baptiste Dijoux et Anne Pouret date de 1801 est une citadine, dans une famille de bouchers de Limoges. L’auteur décrit une professionSur ce thème : Les bouchers du Château de Limoges – Une corporation, une confrérie et une rue des origines à nos jours, Laurent Bourdelas, Editions la Geste, 2019 et un quartier, plutôt repoussant de saleté.
La description des origines familiales se poursuit avec le tableau des Faucher-Pérenquereur, sa belle-famille. Le mariage de Marie-Adrienne avec Martial Pérenquereur, un tailleur, a lieu le 22 janvier 1850, à Saint-Priest-sous-Aixe ; la date est importante au lendemains de la révolution de 1848. C’est une famille issue de l’immigrationLe père de Martial est venu de Hongrie, la mère née dans une famille de tailleurs.
La présentation des frère et sœur, nièces et neveu et de la grand-mère Vertout, tenancière de maison closeQui donne l’occasion d’un point sur la prostitution à Limoges au XIXe siècle, et en particulier dans la rue Froment., de Marie-Adrienne complète le tableau de l’entourage social.
1833-1850, l’enfant et l’adolescente
À partir des données des recensements, Christophe Dijoux tente de reconstituer les premières années de la vie de Marie-Adrienne, dans les rues et quartiers populaires qui furent les siens. Un quartier qui fut détruit lors de l’incendie de 1864.
L’auteur retrace la sociologie des lieuxMétiers exercés dans la rue du Cheval-Blanc à Limoges de 1841 à 1851 p. 81-84 et la situation de l’école au milieu du XIXe siècle.
1850, devenir institutrice
Comment devenir institutrice à cette époque ? Le Brevet de capacité, exigé pour les enseignants « libres »Non liés à une congrégation, était régit par l’ordonnance du 29 février 1816 et influence par la formation des Frères de la Doctrine chrétienne. C’est aussi à cette époque que l’enseignement est fille commence à être envisagé. Si en 1824, le nouveau ministère de l’Instruction publique développe les écoles normales d’instituteurs préparant à un brevet de capacité délivré par l’inspecteur d’académie, il n’en existe pas en Haute-Vienne. L’auteur rappelle la loi Guizot de 1833.
Devenir enseignant n’était pas simple, l’école normale pour les institutrices n’est réellement crée qu’en 1883. L’auteur décrit la préparation et l’examen du brevet de capacité, un espace de concurrence entre les établissements primaires.
Marie-Adrienne a été formée par une voisine, Madame Emma Bramwell, une institutrice libre, avant de se présenter à l’examenExamen décrit en détail à partir d’un exemple en 1855. le 28 août 1851.
Marie-Adrienne, diplôme de brevet supérieur obtenu, appartient à la catégorie des institutrices libres. Il y en avait 49 dans l’arrondissement Limoges en 1869. Elle ouvre sa première école en 1854, elle a 21 ans, l’âge minimum requis depuis la Loi Falloux.
1851-1854, Marie-Adrienne, Sœur Marie-Delphine et les prostituées repenties
On suit le jeune ménage de rue en rue dans Limoges et le milieu social de petite classe moyenne de ce quartier.
Si les débuts de carrière sont difficiles à retracer, puisque Marie-Adrienne est qualifiée de sans profession, dans les recensements, cette période semble être marquée par les relations avec une religieuse du couvent du bon Pasteur qui accueillait des « jeunes filles repenties » de la prostitution. Il est possible que Marie-Adrienne ait été occupée surveillante au Bon Pasteur.
1854, Marie-Adrienne, une institutrice libre
En 1854, elle ouvre sa première école rue Haute-Vienne. L’auteur dresse un portrait des institutrices libres au milieu du XIXe siècle, produits de l’école et de l’Église, elles sont réputées de bonnes mœurs et dévouées à leur travail. L’auteur évoque les difficultés des fins de carrière avec des pensions très modestes.
1859, Marie-Adrienne, entre écoles congréganistes et communales
En 1859, le couple se sépare, alors même que la loi Falloux favorisait l’instruction des filles, une opportunité pour Marie-AdrienneEn 1856, elle est qualifiée de « chef d’institutrices », malgré la concurrence des écoles confessionnelles.
L’auteur tente de décrire ce que pouvait être l’école ouverte par Marie-Adrienne. La motivation n’était pas le salaire, si on en croit Jules Simon
« pour obtenir des élèves, il faut avoir une carrière à […] offrir [aux institutrices]. [Or], un tiers des institutrices communales [gagnait, selon lui], tout compris, 90 centimes par jour » et d’ajouter que « ce [n’était] pas là, on en conviendra, un grand motif d’attraction. » dans la Revue des Deux Mondes en 186Cité p. 162 .
Peut-être pour un emploi indépendant dans une ville qui fait peu d’effort pour l’éducation des filles, comme le montre l’étude des écoles limougeaudesp. 164- 182.
L’étude des conditions de travail, les horaires, les méthodes d’enseignement, les effectifs… avant Jules Ferry occupe une grande place dans ce chapitre.
1833-1871, Sa vie dans une ville qui change
Les archives sont plutôt muettes concernant la vie et le travail de Marie-Adrienne, durant cette période.
L’auteur la replace dans l’évolution de la ville et le vécu des événements politiques.
1863-1864, le torchon brûle et le quartier des Arènes aussi
Un court chapitre est consacré à ces deux années marquantes pour Marie-Adrienne : la séparation de biens de ses parents le 17 janvier 1863 et l’incendie du 15 août 1864.
1870-1871, les derniers moments, les années terribles
La santé de Marie-Adrienne se dégrade et la baisse des effectifs (En 1871, elle n’avait plus que 10 élèves.) annoncent une triste fin le 15 septembre 1871.
Voilà une enquête minutieuse qui concourt à un tableau de la société limougeaude, et à faire revivre les trajectoires sociales de la famille et de Marie-Adrienne, une institutrice.