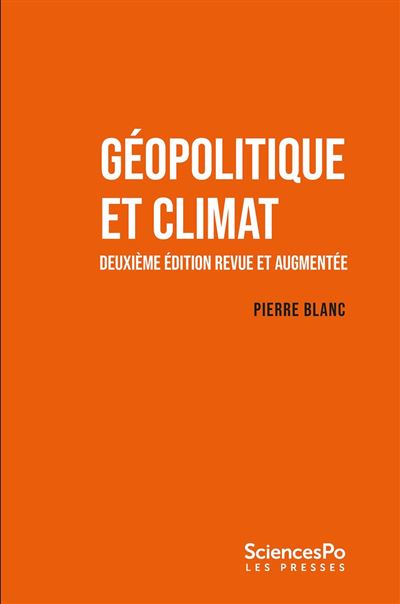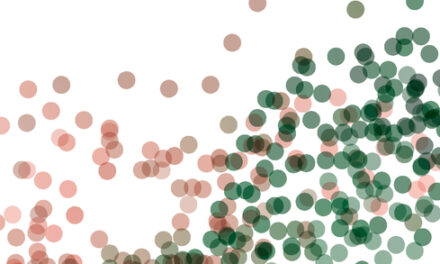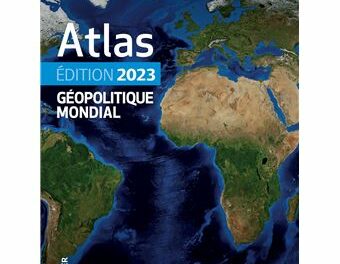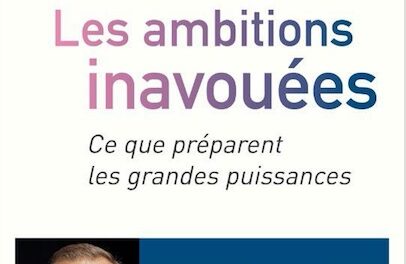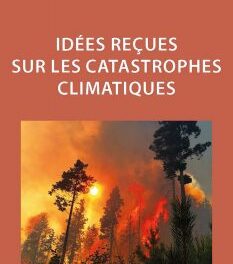Inondations dévastatrices au Pakistan, incendies destructeurs en Californie, vagues de chaleur sans précédent en Europe. Face à ces défis, le constat est sans appel, il est impératif d’« éviter l’ingérable » par des politiques d’atténuation des gaz à effet de serre et d’« éviter l’inévitable » grâce à des stratégies d’adaptation.
Dans cette deuxième édition, récemment publiée aux Presses de Sciences Po, Pierre Blanc, spécialiste des enjeux hydriques et agricoles, met en lumière la complexité des dynamiques climatiques et leurs implications géopolitiques sur le temps long. Ainsi, le climat a toujours façonné les puissances, mais à l’ère de l’Anthropocène, il semble que ce sont les puissances qui façonnent le climat. L’auteur explore cette relation à travers le prisme du passé, du présent et du futur : des empires ayant prospéré grâce à un climat clément aux sociétés fragilisées par des crises environnementales, des dynamiques de domination fondées sur l’exploitation des ressources aux conflits et rivalités exacerbés par les dérèglements climatiques. Face aux tensions croissantes, il interroge l’avenir : qui seront les gagnants et les perdants du dérèglement climatique ?
Climat et puissance
Pierre Blanc inscrit son analyse dans le temps long et met en évidence les relations complexes entre climat et puissance étatique. Il structure son approche autour de quatre dynamiques .
La puissance par le climat : Certaines civilisations ont prospéré grâce à des conditions climatiques favorables. L’Empire assyrien, dont l’expansion a coïncidé avec des périodes de précipitations abondantes, en est une illustration, tout comme l’Égypte antique, où la régularité des crues du Nil a permis le développement d’une agriculture florissante. D’autres civilisations fluviales, comme celles des rives du Tigre et de l’Euphrate, ont également tiré profit de conditions climatiques propices à la sédentarisation et à la prospérité. Cependant, cette relation n’est pas toujours aussi linéaire, et certaines sociétés ont su s’adapter à des conditions plus difficiles.
Le climat contre la puissance : Comme ont pu le souligner des ouvrages comme celui de Jared Diamond (Effondrement) et des études récentes, notamment celles d’Ashish Sinhk, des bouleversements climatiques ont fragilisé et parfois précipité le déclin d’empires. La civilisation maya, victime d’une série de sécheresses prolongées, est un exemple marquant. Plus récemment, la « petite ère glaciaire » (XIVe-XIXe siècle) a joué un rôle dans les crises agricoles européennes et les tensions sociales qui en ont découlé. Pourtant, certaines sociétés, comme les civilisations fluviales, ont réussi à développer des techniques d’adaptation face aux changements climatiques. Pierre Blanc fait également référence aux travaux des historiens et géographes qui ont étudié le rôle ambigu du climat dans le développement économique, notamment en Europe.
La puissance contre le climat : Avec l’Anthropocène (Paul Josef Crutzen), ce n’est plus le climat qui façonne les civilisations, mais bien l’activité humaine qui modifie le climat. On parle d’un « capitalisme fossile » ou de « choix du feu » (Alain Gras) qui s’est épanouit autour du triptyque gaz pétrole charbon. « Les États puisent dans le sous-sol les moyens d’assouvir leur rêve de puissance « , une puissance notamment économique et militaire, avec pour conséquence la multiplication par sept des émissions de gaz à effet de serre depuis 1945.
Le temps de l’action pour le climat : Aujourd’hui, la question se pose de savoir si les États peuvent inverser cette dynamique. L’auteur examine les leviers possibles : progrès technologique, soft power climatique porté par l’Union européenne et son Green Deal et divergences entre démocraties et régimes autoritaires face à ce défi. Pierre Blanc s’interroge sur l’efficacité des solutions proposées, notamment l’innovation technique, qui pourrait offrir des résultats à long terme mais présente des risques liés à la manipulation du climat. Il met également en avant l’importance du soft power, en soulignant l’approche proactive de l’Union européenne, qui, malgré ses faibles ressources extractives, dispose d’une expertise technologique dans les domaines zéro carbone. La position européenne est renforcée par des acteurs comme le Pape François et son encyclique Laudato Si puis Laudato Deum, qui, à travers sa critique de l’anthropocentrisme dévastateur, soutient une vision plus respectueuse de l’environnement. Toutefois, face aux choix économiques souvent moins sensibles aux enjeux climatiques de certains pays émergents et autoritaires, la politique de l’Union européenne devra se traduire par des actes concrets.
Climat et pouvoir
Pierre Blanc examine également les relations entre le pouvoir politique, entendu comme le régime politique, et le climat.
Les démocraties : Il n’y a pas de « myopie » démocratique sur la question du climat. Toutefois, les démocraties, en raison de leur pluralisme et des pressions électorales, éprouvent parfois des difficultés à adopter des mesures ambitieuses sur le long terme. L’auteur observe que ces régimes font preuve d’une certaine timidité face aux changements de politique climatique conséquents. Cependant, il conclut sur une note d’espoir en mettant en avant le rôle fondamental de l’implication citoyenne dans la transition environnementale.
Les régimes nationaux-populistes : À l’inverse, ces régimes sont souvent associés à un scepticisme climatique, ce qui limite les actions concrètes en faveur de l’environnement. L’auteur évoque la figure des « climato-rassuristes », qui dénoncent une écologie punitive et flattent l’électorat en le dédouanant de son mode de vie à forte empreinte carbone. Il illustre cette dynamique avec des exemples marquants, tels que l’impact politique de l’arrivée de Donald Trump à la présidence des États-Unis ou la politique récente de Jair Bolsonaro en Amazonie, montrant ainsi comment certains dirigeants ont soutenu des industries polluantes au détriment des enjeux climatiques. Ces régimes ont recours à des méthodes offensives pour faire taire ou discréditer les contre-pouvoirs, souvent en s’appuyant sur un « capitalisme de connivence ».
Les régimes autoritaires : Ils ont, comme ceux de la Chine et de la Russie, la capacité d’imposer rapidement des politiques énergétiques et climatiques, mais ces initiatives restent généralement motivées par la défense d’intérêts économiques puissants. Des entreprises telles que Gazprom, China Energy ou Saudi Aramco sont au cœur de ces collusions entre sphères politique et économique. La Chine, premier émetteur mondial de gaz à effet de serre, mène une stratégie visant à promouvoir une « civilisation écologiste », poursuivant ainsi un objectif géopolitique clair : réduire sa dépendance aux énergies fossiles étrangères. Toutefois, cette politique présente de nombreuses limites : manque de transparence, dépendance encore massive au charbon, et exploitation forcée de la main-d’œuvre, notamment pour l’extraction du silicium polycristallin nécessaire à la production des panneaux solaires.
Insécurités et conflits
L’auteur s’intéresse à la manière dont le changement climatique accentue les inégalités et génère de nouvelles formes d’insécurités humaines. Il explore notamment l’interconnexion entre les dimensions économique, alimentaire, environnementale et politique de la sécurité, mettant en lumière la manière dont ces facteurs s’influencent mutuellement.
Traditionnellement, la sécurité a longtemps été définie par l’absence de conflits militarisés. Cependant, Pierre Blanc élargit cette conception en y intégrant d’autres composantes de la sécurité humaine : économique, alimentaire, sanitaire, environnementale, politique, personnelle et communautaire. Cette approche permet d’analyser comment les perturbations climatiques affectent les populations à travers le monde et interagissent avec d’autres vulnérabilités sociales et politiques.
Pierre Blanc déconstruit l’idée de « guerres climatiques », préférant examiner comment le climat agit comme un facteur aggravant des crises existantes. Il illustre cette analyse à travers le cas de la Syrie, où une sécheresse prolongée a favorisé l’instabilité sociale en accélérant l’exode rural, sans pour autant constituer la cause principale du conflit. Il aborde également les tensions au Darfour, où la diminution des précipitations a intensifié les affrontements entre pasteurs nomades et agriculteurs sédentaires, dans un contexte caractérisé par l’incapacité d’un État en déliquescence.
L’ouvrage regorge d’exemples. En Afrique du Nord et au Moyen-Orient, l’auteur préfère parler de « violences hydrauliques » entre États plutôt que de « guerres de l’eau ». Il met en avant la situation d’ »hydro-hégémonie » de pays comme la Turquie, Israël ou l’Égypte vis-à-vis de leurs voisins. Dans cette nouvelle édition, Pierre Blanc intègre également des événements récents ayant des répercussions géopolitiques majeures. La guerre en Ukraine, par exemple, a eu des conséquences dramatiques sur la sécurité alimentaire mondiale, en provoquant une flambée des prix des céréales et en aggravant une insécurité alimentaire déjà exacerbée par les crises climatiques, notamment les sécheresses prolongées. Cette situation illustre le rôle du climat dans l’intensification des conflits géopolitiques et économiques, et la manière dont ces crises se renforcent mutuellement.
Au-delà des conflits armés, l’ouvrage met en exergue des formes d’insécurité variées : les migrations forcées, les crises alimentaires et les tensions sociales engendrées par les transformations des modes de vie. L’auteur insiste sur le fait que la vulnérabilité d’un territoire face aux dérèglements climatiques repose avant tout sur les décisions politiques et économiques des gouvernements en place.
Prospectives et enjeux pour l’avenir
Pierre Blanc esquisse les scénarios futurs de la géopolitique climatique en proposant des pistes prospectives.
Les gagnants et les perdants directs : Ainsi, la Russie pourrait être un gagnant direct grâce au dégel du pergélisol, qui libérera de nouvelles terres agricoles. L’auteur estime que la surface agricole pourrait être multipliée par deux d’ici 2025. Toutefois, cette fonte entraînera également des conséquences négatives : libération de gaz à effet de serre, fragilisation des infrastructures existantes et résurgence de formes de vie bactériennes. Par ailleurs, la disparition progressive de la banquise offrira un accès accru aux ressources sous-marines (cobalt, nickel, cuivre, étain, etc.) et ouvrira de nouvelles routes commerciales entre l’Europe et l’Asie, réduisant de 5 000 km le trajet entre Hambourg et Shanghai. Cependant, l’exploitation de ces ressources restera extrêmement coûteuse dans un environnement hostile. L’exemple du Groenland, attisant de nombreuses convoitises, notamment de la part des États-Unis, est également développé. A l’inverse, les perdants directs sont nombreux. Selon le Global Climate Risk Index, sept des dix États les plus vulnérables face aux changements climatiques se situent en Asie (Bangladesh, Inde, Pakistan, etc.). Toutefois, la bande sahélienne, la Corne de l’Afrique et l’Amérique centrale sont également fortement impactées.
Les gagnants et perdants indirects : La transition énergétique vers des modèles moins carbonés enclenche des dynamiques favorables pour certains pays. Les États du Golfe, par exemple, ont lancé des programmes de diversification. L’Arabie saoudite développe ainsi l’hydrogène bleu et investit dans l’énergie solaire. Par ailleurs, la demande croissante en lithium devrait avantager des pays comme ceux du « triangle du lithium » (Bolivie, Argentine et Chili). L’Indonésie joue également un rôle clé dans l’extraction de minerais stratégiques. À l’inverse, les perdants indirects incluent des pays comme le Venezuela, l’Irak, l’Iran, l’Angola et l’Algérie, qui peinent à convertir leur économie extractiviste en un modèle plus diversifié. La République démocratique du Congo, malgré l’abondance de minerais, notamment dans la région du Katanga, souffre d’une corruption persistante héritée des années Mobutu et Kabila. En conséquence, l’État s’est tourné vers la Chine, ce qui conduit l’auteur à évoquer une « sinisation minière du monde ».
En conclusion, l’ouvrage de Pierre Blanc met en lumière l’interdépendance entre climat, puissance et régime politique à travers l’histoire et les dynamiques actuelles. Face aux dérèglements climatiques, il est crucial d’adopter des politiques d’atténuation et d’adaptation pour prévenir des crises géopolitiques et sécuritaires de plus en plus graves. Si certains pays pourront tirer profit de la transition énergétique, la vulnérabilité climatique exacerbera les inégalités mondiales, rendant les défis à venir d’autant plus urgents à relever.
Ce livre est une ressource précieuse pour les enseignants du secondaire, en particulier en histoire, en géographie et en HGGSP. Il offre une véritable grille de lecture et de compréhension, tout en proposant de nombreux exemples concrets. Grâce à ces perspectives variées, il permettra d’enrichir la réflexion des élèves sur les défis environnementaux mondiaux, leurs implications géopolitiques et les réponses politiques qui y sont apportées !