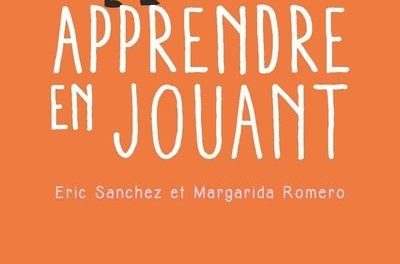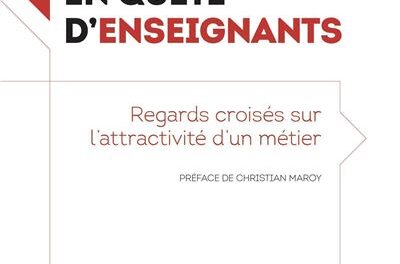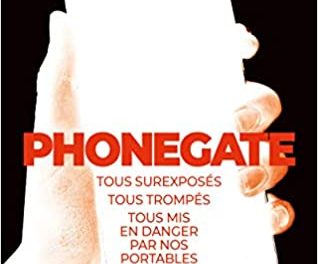Dans un contexte indéniable de crise de leurs effectifs, les structures syndicales de l’Education Nationale se sont renouvelées avec une professionnalisation de leurs modalités d’actions. Avec des réformes toujours plus nombreuses et un panel d’acteurs (associations, collectivités locales…) également en hausse voulant prendre aux syndicats une part du gâteau de la représentativité de la profession, un état des lieux de ces défenseurs du métier était nécessaire.
Professeur en sciences de l’éducation et de la formation à l’Université Paris Nanterre, Ismaïl Ferhat s’acquitte de cette tâche dans ce petit ouvrage aux 6 chapitres complémentaires dont les contenus s’appuient sur l’étude de publications syndicales, des questionnaires aux militants et des entretiens.
L’étude se focalise sur les 20 dernières années. Cet après 2000 est justifié par plusieurs raisons : de fortes grèves à ce moment-là, le transfert des personnels techniciens, ouvriers et de service aux collectivités locales, la réforme du débat sur le foulard islamique dans les établissements publics d’enseignement. Il y a surtout eu à cette époque un départ à le retraite massif de personnels ayant eu à gérer la massification de l’enseignement accompagnée d’une forte phase de militantisme. En regard, s’est installée une nouvelle génération moins revendicative. La participation très faible aux élections professionnelles en est un signe, le fort morcellement des structures en est un autre.
Le premier chapitre positionne la question du syndicalisme dans le champ des sciences humaines et sociales. Un bon graphique n°2 recense les chercheurs interviewés dans des revues syndicales entre 2003 et 2020 : beaucoup de représentants des sciences de l’éducation et de la formation ainsi que des sociologues. La FSU présente une meilleure interdisciplinarité. D’un autre côté, on peut estimer également la production scientifique des chercheurs ayant été militants enseignants. L’analyse bibliographique recense 10 % de femmes et 30 % de travaux issus clairement de syndicalistes. Les enseignants représentent 85 % des objets des travaux laissant peu de place aux autres acteurs du monde éducatif. 30 % des travaux sont interdegrés. 40 % portent sur le second degré. La moitié des travaux sont en histoire, 20 % en sciences de l’éducation, 15 % en science politique et 10 % en sociologie.
Le chapitre 2 traite de la représentativité des structures syndicales. La fragmentation des organisations syndicales, la baisse de la syndicalisation et la multiplication des réformes publiques ne sont pas pour aider. Durant les Trente Glorieuses, les taux étaient très hauts et pouvaient atteindre les 100 % dans certains secteurs ruraux. Le virage s’annonce dan les années 1990 avec l’éclatement de la FEN ayant donné naissance à l’UNSA et à la FSU. 60 % des votes exprimés sont pour la FSU et l’UNSA cumulés de nos jours et ce, dans un contexte de très faible participation. En parallèle, des structures comme le « Pas de vagues » ou les « Stylos rouges » ont émergé mais, s’ils sont diversement appréciés par les syndicats, apparaissent comme non structurés malgré les gros effectifs qu’ils drainent.
Le chapitre 3 s’intéresse au profil des militants syndicaux. Un questionnaire administré en 2022 ayant recueilli plus de 1000 réponses (dont 90 % de répondants rattachés à l’Education Nationale) montre que l’âge moyen des répondants se situe aux alentours des 45 ans, un âge plus avancé que celui du reste de la profession enseignante. L’autopositionnement culturel et social est assez haut. Les sondés sont très majoritairement titulaires. 60 % précisent ne pas avoir eu de carrière dans le privé avant (cela peut toutefois être handicapant avec une sociologie du métier qui évolue avec beaucoup de reconversions).
La chapitre 4 traite de modèles militants. Le militantisme a démarré assez jeune (au lycée parfois) chez certains et peut être associé à un engagement associatif et /ou politique. Il peut y avoir aussi ce multipositionnement avec l’échelle nationale. La durée de l’engagement est plus longue chez les enseignants titulaires. Parfois, il n’y a que 5 ans entre la première adhésion et l’engagement dans une première responsabilité syndicale. Malgré tout, à l’image du « #Payetonburnoutsyndical », l’épuisement est de mise et il y a un certain pessimisme à pouvoir faire bouger les lignes de l’administration. Le syndicalisme est devenu davantage précis, technique, professionnel et n’autorise finalement que très peu les militants à aller défendre de manière plus large les inégalités de la société.
Le chapitre 5 revient sur la préférence jacobine et centralisatrice qui sert de garantie face aux pressions locales qui pourraient être faites sur les personnels. L’intérêt envers la question chute dans la presse syndicale. La tendance est lourde et unanime sauf du côté de la CFDT qui apparait plus ouverte aux aspects décentralisateurs.
Le chapitre 6 lui s’attarde sur le fort attachement à la laïcité. Des divergences syndicales sont à relever avec une plus forte hostilité de la CGT, de SUD et de la FSU à vouloir financer l’école privée avec des deniers publics. Il y a unanimité sur la question de l’interdiction du port de signes religieux dans les établissements publics scolaires en lien avec la loi du 15 mars 2004.
La conclusion n’est pas des plus optimistes avec des troupes qui s’étiolent et se morcellent et un service public toujours affaibli et peu enclin à pouvoir accéder aux requêtes des organisations syndicales. Malgré tout, le syndicalisme enseignant a su faire preuve d’adaptation à travers les âges et c’est sur cette capacité qu’il faudra pouvoir compter à l’avenir pour continuer à peser.