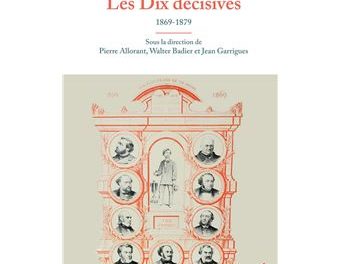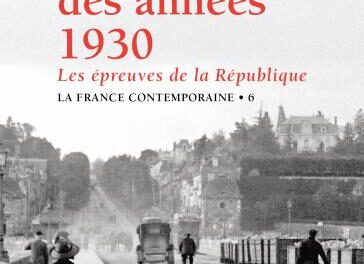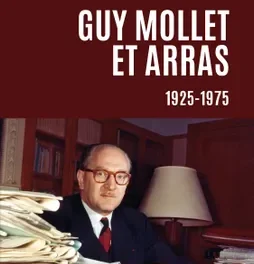On attendait Mandel… et ce fut de Gaulle
Curieuse problématique pensera-t-on sans doute, tant le personnage est tombé dans l’oubli ; et l’on aura du mal à comprendre qu’il aurait été moins étonnant de trouver Mandel que de Gaulle pour incarner le refus de l’armistice et la volonté de continuer la guerre. Et pourtant ce n’est pas exagéré : dans ce rôle c’est Mandel qu’on attendait.
L’auteur nous rappelle dès les premières pages que le 13 juin 1940, alors que la défaite paraît consommée, apprenant que de Gaulle s’apprête à rédiger sa lettre de démission du gouvernement, Mandel (qui était alors ministre de l’Intérieur) demanda à rencontrer le général et le dissuada de démissionner en avançant cet argument repris par de Gaulle dans ses Mémoires : « Ne pensez qu’à ce qui doit être fait pour la France et songez que, le cas échéant, votre fonction actuelle pourra vous faciliter les choses ». En effet de Gaulle ne conserva une parcelle de légitimité que parce qu’il était membre du gouvernement Reynaud. C’est cette légitimité qui justifie son voyage à Londres, comme envoyé officiel du président du Conseil le 16 juin, lui donnant l’occasion d’une nouvelle rencontre avec Churchill et les siens ; d’où l’avion anglais qui lui permit aussi de repartir, le 17 juin au matin vers son appel historique. La place que prit de Gaulle paraissait aux yeux des dirigeants anglais et de beaucoup d’autres, assignée à Georges Mandel.
« Le rendez-vous manqué »
Georges Mandel est entré comme ministre des Colonies dans le gouvernement de Daladier le 10 avril 1938 et est resté à ce poste quand Paul Reynaud a remplacé Daladier le 21 mars 1940 ; il est devenu ministre de l’Intérieur le 18 mai 1940. Il est très proche de Reynaud et anime à ses côtés le camp de la fermeté : il plaide au Conseil des ministres qui se tient au château de Cangé le 13 juin 1940 pour la résistance à tout prix. Il se heurte au général Weygand et prône le repli du gouvernement en Afrique du nord. Nul n’a alors oublié que depuis son discours à la Chambre le 9 novembre 1933, il incarne une volonté de résistance à l’Allemagne, à Hitler et au nazisme. « Tous les témoignages attestent de sa lucidité quand à la future guerre mondiale, fondant sa conviction : il faut continuer la lutte en dehors de la métropole et signer un armistice serait criminel ».
Il semble qu’il se tienne prêt à être l’homme de ce refus. Il apparut durant quelques jours, comme celui qui pouvait incarner le sursaut. Il perpétuait l’esprit de Clemenceau dont il avait été le plus proche collaborateur ; à 55 ans, il avait la maturité et la pratique du pouvoir ; sa notoriété était internationale et la haine que lui vouait l’extrême droite augmentait son prestige dans la gauche antimunichoise. Churchill l’appelle « Mandel le grand » et affirme qu’il était « l’énergie et le défi personnifiés ». Or par deux fois il refuse de partir pour Londres quand c’est encore possible et qu’on le lui demande.
Le 16 juin 1940 au soir le général Spears, envoyé spécial de Churchill, cherche un Français de premier rang pour représenter aux yeux du monde, depuis Londres, une politique qui s’oppose à l’armistice. Paul Reynaud se dérobe. Spears va trouver Mandel qui hésite puis décline l’offre : « On croirait que j’ai peur et que je me sauve ». Trois jours plus tard l’ambassadeur britannique met à sa disposition un destroyer qui pourrait le prendre à la pointe de Grave : il se dérobe à nouveau.
Il choisit de partir pour l’Afrique du nord et s’embarque sur le Massilia qui appareille le 20 juin à 16h. C’est à bord, deux jours plus tard, qu’on apprend l’armistice. Parvenu à Casablanca le 24 juin au matin Mandel cherche à rencontrer le général Noguès, résident général au Maroc. Mais Noguès a senti le vent tourner. Churchill voulant encore croire à la création d’un gouvernement de résistance en Afrique du nord y envoie un ministre et un général. Le ministre cherche à rencontrer Mandel ; les autorités l’en empêchent.
Mandel est arrêté, transféré en métropole, interné, condamné par Pétain à l’emprisonnement dans une enceinte fortifiée (ce sera le fort du Portalet), livré aux Allemands qui le détiennent comme otage près du camp de Buchenwald (en compagnie de Léon Blum), et finalement remis par la Gestapo à la Milice qui l’assassine en forêt de Fontainebleau le 7 juillet 1944 Sur les causes et les auteurs de cet assassinat : François DELPLA, Qui a tué Georges Mandel (1885-1944) ?, l’Archipel, Paris, 2008. Compte-rendu dans le n° 406, mai 2009, de la revue Historiens et Géographes (p. 353). La thèse de l’auteur est que Mandel a été sacrifié sur ordre des plus hautes autorités SS afin de compromettre Pétain qui lui vouait une forte haine et de lui montrer qu’il n’était qu’un instrument à la disposition de l’occupant.
J.-N. Jeanneney cherche ensuite à comprendre ces refus de Mandel : pourquoi n’accomplit-il pas « le geste qui force le destin » ?
L’ombre de Clemenceau
Mandel est devenu en 1903 le collaborateur de Clemenceau alors directeur de L’Aurore. Plus tard, au gouvernement, il devient son plus proche conseiller et son chef de cabinet. Clemenceau apprécie et utilise la profonde érudition politique de Mandel et son exceptionnelle mémoire ; déversoir des haines et des frustrations, Mandel protège aussi la popularité de Clemenceau. Il lui est indispensable. Mais tout l’orgueil de Clemenceau se refuse à admettre qu’il dépend de Mandel et il ne supporte pas les allusions fréquentes qui laissent entendre que Mandel gouverne Clemenceau.
Alors Clemenceau se montre cruel à l’égard de Mandel et lui signifie sans ménagement qu’il est voué à rester dans l’ombre ; il n’hésite pas à l’humilier en lui montrant sa position subalterne.
N’aurait-on pas dans cette complexe relation une première clé d’explication de la « dérobade » de juin 1940 : « N’intégra-t-il pas en lui-même, au secret de son âme, le doute que le Tigre avait tout fait pour lui instiller – quant à sa capacité d’être un jour le numéro Un ? »
L’image de soi
Mandel aurait-il été rongé par le doute de soi ? Il ne s’aime pas ; il est laid. « Tout dans son comportement nous indique qu’il n’était pas réconcilié avec l’apparence physique que le nature lui a donnée (…) Sa laideur fait l’objet, parmi ses contemporains, d’une rare unanimité ». Il endura d’innombrables attaques au cours de ses campagnes électorales (il fit une carrière politique en Gironde : maire de Soulac, conseiller général, président du Conseil général, député). « Le décrire, c’est presque l’injurier » écrit par exemple Le Girondin du 31 octobre 1919 qui insiste aussi sur sa petite taille. Mais l’argument ne convainc pas et d’ailleurs l’auteur évoque « la longue théorie des hommes petits qui surent trouver dans leur sentiment d’infériorité physique le ressort d’une quête infatigable du pouvoir »…
Mandel est juif, surtout dans le regard des autres car on n’imagine guère de famille mieux intégrée. A sa naissance, il s’appelle Louis Rothschild. Il n’a aucun lien de parenté avec les banquiers mais ce hasard ouvre un large champ aux attaques antisémites ; aussi choisit-il de prendre le nom de sa mère pour son action publique. Le changement de prénom répondit au désir de ne pas être confondu avec son oncle, Louis Mandel.
Mandel dut supporter toutes les ignominies de l’antisémitisme. Le 29 septembre 1938 la première page de L’Action française, détournant un couplet de L’Internationale proclamait :
S’ils s’obstinent ces cannibales,
A faire de nous des héros,
Il faut que nos premières balles
Soient pour Mandel, Blum et Reynaud…
On touche sans doute ici au plus profond de son refus de quitter le territoire français en juin 1940. Déjà il avait refusé en mars 1936 de démissionner du gouvernement pour montrer sa désapprobation de l’inaction du président du Conseil devant la remilitarisation de la Rhénanie, affirmant qu’il ne voulait pas prêter le flanc aux stéréotypes du juif traître en se désolidarisant de l’équipe gouvernementale. Il reprit le même raisonnement au moment de Munich. Mais en ne démissionnant pas, il reste engagé dans les responsabilités et les compromissions gouvernementales. En 1940, il paraît à ses proches comme paralysé devant la perspective d’un départ pour Londres, « par le risque d’être accusé d’avoir émigré selon la pente éternelle des siens : le Juif errant, le déserteur… ». Le soir du 16 juin 1940, il répond à Spears qui le presse de gagner Londres : « Vous êtes inquiet parce que je suis juif. C’est justement parce que je suis juif que je ne partirai pas demain ».
Quelques autres pistes sont explorées pour expliquer l’attitude de Mandel : c’est un homme de droite peu convaincu, que la droite ne reconnaît pas vraiment mais que la gauche repousse ; c’est un pragmatique dont la réflexion idéologique n’a pas été suffisante pour remettre en cause les cadres institutionnels de la Troisième République, paralysé peut-être par « son dessein de s’intégrer dans le système tel qu’il était, désir d’autant plus violent que tant de gens essaient de l’en exclure en le figeant dans sa différence ».
L’injustice d’un oubli
« Le plus impressionnant dans le destin de G. Mandel, dès lors que le sort eut basculé du mauvais côté, est de voir combien les traits qui le faisaient si différent de la plupart des autres et qui auraient pu le rendre si utile aggravèrent son malheur et sa solitude ».
Chez les gaullistes, à Londres, dont il avait préparé le combat, il ne fit pas l’unanimité. Du Portalet en août 1942, il adressa une lettre d’admiration et d’allégeance à de Gaulle. Mais certains conseillers se murmuraient à eux-mêmes que Mandel libre aurait pu fournir à Churchill un homme de rechange.
La haine de Pétain à son égard était notoire. Mandel lui télégraphia le 11 novembre 1942, au moment où les Allemands entraient en zone Sud : « Me maintenir au Portalet quand la France entière va être occupée équivaut à me livrer à l’ennemi. Je tiens à ce que vous soyez averti afin qu’il soit bien établi devant l’Histoire que vous serez éventuellement responsable de ce crime ». Il ne reçut pas de réponse.
Les collaborationnistes voulaient sa mort. Brasillach réclamait qu’il fût pendu ; Je suis Partout voulait le voir abattu « comme un chien » ; Doriot voulait le « coller au mur ».
Soixante après sa mort, sa mémoire n’a pas laissé beaucoup de traces : une avenue à Paris, une stèle au bord de la nationale 7 en forêt de Fontainebleau. Les gaullistes l’ignorent ; l’extrême droite le poursuit toujours de sa haine ; à gauche, il n’est pas de la famille. « L’homme solitaire qui manqua de si peu la grande Histoire est resté sur le quai, noble et très pathétique »