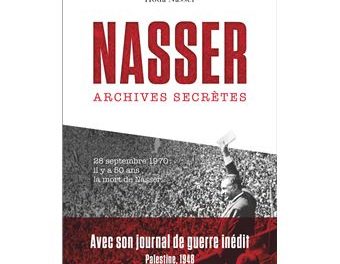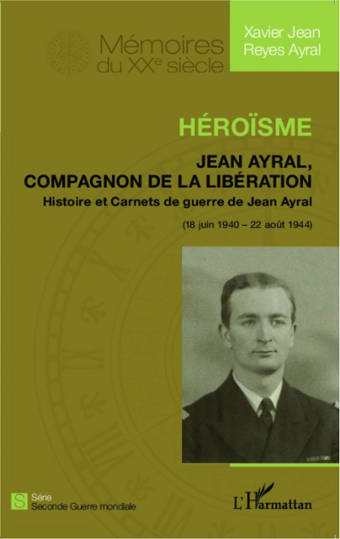
Né en 1921, fils d’un cadre supérieur du transport transatlantique, Jean Ayral préparait Polytechnique à Dax lorsqu’il entendit l’appel du 18 juin 1940 et se mit en tête, non point d’abord de rejoindre le général de Gaulle, mais de quitter le sol français. Il y parvint sur un navire dont il ignorait s’il se rendait au Maroc ou à Gibraltar. Pendant un an et demi, sa guerre est celle d’un Fabrice à Waterloo, qui rêverait vainement de se battre. Il s’égare sur un faux navire corsaire commandé par un pittoresque aventurier, Claude Péri dit Jack Langlais : un cargo baptisé Rhin, devenu en juillet 1940 le HMS Fidelity. Langlais, qui a capté on ne sait comment la confiance des Britanniques, les intéresse sans doute pour d’autres raisons que son navire, rarement engagé ; il finit cependant par être torpillé et perdu corps et biens, en décembre 1942. Ce commandant disait beaucoup de mal des gaullistes et de leur chef, ces « planqués », et seul son besoin éperdu d’action avait incité Ayral à rejoindre la France libre, dans l’espoir de se rendre plus utile, au début de 1942. C’est ainsi qu’il est envoyé en France pour le compte du BCRA[1], après des stages d’entraînement qui lui ont fait côtoyer Daniel Cordier et toute une petite équipe à laquelle ont rendu récemment hommage le livre et les films intitulés Alias Caracalla.
Parachuté avec Cordier près de Montluçon dans la nuit du 25 au 26 juillet 1942, il s’est pris le pied dans une sangle et atterrit sur la tête, ce qui lui vaut un hématome cérébral opéré plus tard en Angleterre, moyennant un mois d’hospitalisation. Entre-temps, l’artiste a produit l’essentiel de son œuvre, organisant les parachutages d’armes à destination de la Résistance à la tête du Bureau des opérations aériennes (BOA) et côtoyant de près Jean Moulin… ce qui nous vaut des pages très dures sur Pierre Brossolette et sur le chef du BCRA, André Dewavrin dit Passy, qui mettent tous les bâtons possibles dans les roues de Moulin. L’occupant ne reste pas inactif, infiltre le BOA et arrête une bonne partie de sa direction, dont Ayral, le 28 avril 1943. Les prisonniers sont conduits dans un commissariat de quartier de la Gestapo, boulevard Raspail. Fatale imprudence : ils s’entendent par signes pour tenter une évasion… et réussissent. Ayral, qui a foncé le premier et tué deux sentinelles, échappe aux regards en tournant dans la rue de Grenelle et se réfugie dans un grenier ; la complicité providentielle d’un habitant et du concierge fait le reste. Jean Moulin le félicite par écrit d’abord (le document est reproduit) puis personnellement.
La guerre ne semble pas avoir altéré ses idées politiques quelque peu droitières et, lorsqu’il est exfiltré à Londres, il ne veut plus entendre parler de la Résistance, à la fois trop « socialo-communiste » à son goût, et trop restauratrice des « hommes d’avant-guerre ». Ses réflexions, avant comme après l’entrée de l’URSS dans la guerre, sur les inconvénients d’une alliance avec elle vont dans le même sens. Il ne veut plus que combattre directement l’ennemi et c’est ainsi que, toujours sous l’égide du BCRA, il se fait envoyer en Corse pour préparer le débarquement de Provence. Il y trouve la mort le 21 août, à la fois glorieusement –il commande, avec le grade de lieutenant, un des premiers détachements qui entrent dans Toulon avec six semaines d’avance sur le planning, en ayant tourné les défenses ennemies par des chemins inattendus- et de la façon la plus bête : il s’avance vers des troupes amies dont il a reconnu l’uniforme, bras levés, mais en ayant gardé un revolver à la main, ce qui lui vaut d’être abattu d’une rafale.
L’auteur du livre, petit-neveu de Jean Ayral, a le sens de la narration et sait nous rendre son héros très proche, notamment grâce à son journal de guerre, dont la publication intégrale à la fin du volume est l’un des principaux intérêts de celui-ci. En revanche, le contexte historique est un peu schématique, et parfois franchement inexact