Les éditions Arkhê proposent une Histoire de la misogynie de l’Antiquité à nos jours. Cet ouvrage rédigé par Adeline Gargan, spécialiste des textes littéraires du XVIIIe siècle et enseignante à l’université de Nouvelle-Calédonie, et par Bernard Lançon, Professeur d’Histoire ancienne à l’Université de Limoges, ne traite pas de la femme et de la féminité mais de la défiance, du mépris voire de la haine dont la femme est victime (p. 7).
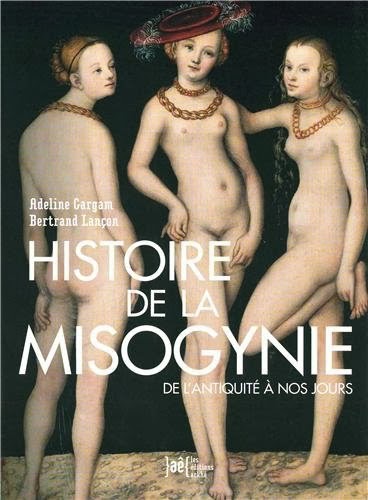
Patiemment, les auteurs montrent que la misogynie est une construction. D’essence masculine, cette construction est l’œuvre des hommes en faveur de la domination masculine. Avec précision, ils distinguent la misogynie du « machisme », posture masculine de domination qui se traduit par un refus d’assumer des tâches et des affects prétendument dévolus aux femmes, du « sexisme » qui traduit une attitude discriminatoire et de la « phallocratie » qui désigne la pensée et les actions selon lesquelles le pouvoir revient aux hommes (p. 9).
L’ouvrage suit une méthode archéologique. Le terme de misogynie, s’il est attesté dès la Renaissance, ne devient usuel qu’au XIXe siècle. Mais les auteurs proposent une étude de la pensée misogyne, dans ses formes et représentations, ses argumentations et ses prolongements depuis la mythologie de la Grèce archaïque. En effet, la misogynie est un invariant. Seules ses justifications se renouvèlent.
La misogynie s’enracine dans les représentations antiques de la femme. D’abord, les textes mythologiques antiques, gréco-romains (p. 17-41) et bibliques (p. 43-70), présentent la femme comme maléfique. Les harpies et les furies sont violentes et presque animales. Pandore est trop curieuse. Les déesses sont ombrageuses, jalouses, inquiétantes. Les Amazones sont féroces et meurtrières. Ève est transgressive, tentatrice et fauteuse.
Débile et fragile
Les textes scientifiques présentent la femme comme physiologiquement faible. Hippocrate, Aristote et Galien présentent la femme comme « débile » et fragile (p. 71-77). Dès l’Antiquité, le discours misogyne est organisé.
Le sexe de la femme, très longtemps regardé comme un animal errant et concupiscent, concentre les attentions (p. 99-129). Philosophes, théologiens et scientifiques contribuent à présenter la femme comme lubrique et dangereuse.
Les découvertes scientifiques des XVIIe et XVIIIe siècles ne modifient pas fondamentalement ce portait féminin (p. 78-85). Certes les scientifiques s’appuient sur les découvertes en anatomie osseuse pour admettre que la femme est anatomiquement « correcte » même si elle est différente de l’homme. Mais ils s’appuient sur l’observation des fibres nerveuses féminines, plus petites et plus délicates de celles de l’homme, pour affirmer que la nature féminine est faible et fragile. Le surplus de sensibilité introduirait une faiblesse dans son système cérébral.
Les découvertes des XIXe et XXe siècles ne modifient pas davantage ce portrait. Au XIXe siècle, les scientifiques s’appuient sur la phrénologie pour justifier l’infériorité féminine (p. 85-89). Le poids moindre du cerveau serait la cause d’une infériorité intellectuelle. La féminité dans sa conception scientifique et mentale est donc toujours marquée par la défectuosité. Au XXe siècle, les scientifiques s’appuient sur la génétique, l’endocrinologie et les neurosciences pour confirmer voire consolider le dimorphisme sexuel (p. 89-92). Le discours archaïque se pare des atouts de la modernité.
Un trait dominant
Ces discours ont eu des conséquences domestiques, cantonnant la femme à des tâches ménagères et d’enfantement, politiques, l’écartant du pouvoir et des institutions politiques, et éthiques, faisant de la femme un être dont les hommes peuvent abuser. La misogynie a été scellée par le droit mais aussi par un discours moralisant (p. 191-224). La domination masculine est donc sociétale, culturelle, politique, économique… Les institutions en sont ses instruments de contrôle. Son emprise est telle que les femmes ont intégré ce discours et celles qui la remettaient en cause ont été suspectées d’hérésie au Moyen Âge ou de maladies mentales plus récemment (p. 273-275).
Aujourd’hui, le discours continue de se transformer et a tendance à se fondre dans un discours misanthrope. Les violences domestiques, le harcèlement sexuel et les viols, dont les auteurs sont majoritairement des hommes, continuent de manifester la domination masculine violente (p. 288-304). Cependant, les auteurs constatent une évolution récente. Grâce à l’action des féministes, le terme de misogynie désigne aujourd’hui une incorrection philosophique, une survivance ridicule voire une pensée arriérée (p. 298). Selon les auteurs, la misogynie n’échappera pas à l’évolution récente qui érige toute distinction en discrimination.
Riche d’exemples, bien rédigé, cet ouvrage est une réussite dont la lecture devrait intéresser le plus grand nombre. Il montre combien la misogynie est un trait dominant et pérenne des sociétés occidentales. Il se termine par une question : la raison de la misogynie n’est-elle pas la peur masculine exacerbée par l’altérité féminine ? (p. 304). Cette question aurait méritée une réponse. Voire même d’être un point d’appui du raisonnement d’ensemble. Peut être les hommes ont-ils peur des femmes sans vouloir réellement savoir pourquoi ils en ont peur. Ce qui contribuerait à expliquer leur volonté sans cesse renouvelée de re-justifier leur domination. L’ouvrage de Jean Cournut, Pourquoi les hommes ont peur des femmes, paru aux P.U.F. en 2001 et réédité en 2006, apporte des éléments de réponses à cette question.

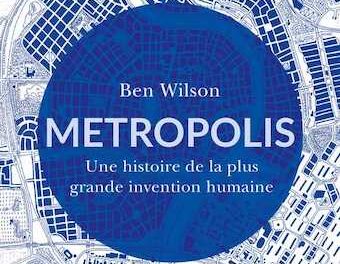


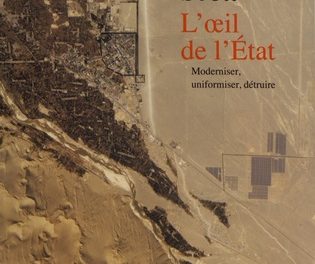









j’ai pourtant fait des études hellénistiques,traduit des textes (en particulier Aristophane,qui écrit que la femme est un
fléau) et il faut que j’arrive maintenant pour m’en apercevoir!
J’avais une véritable passion pour cette civilisation que je trouvais exceptionnelle.
Merci!