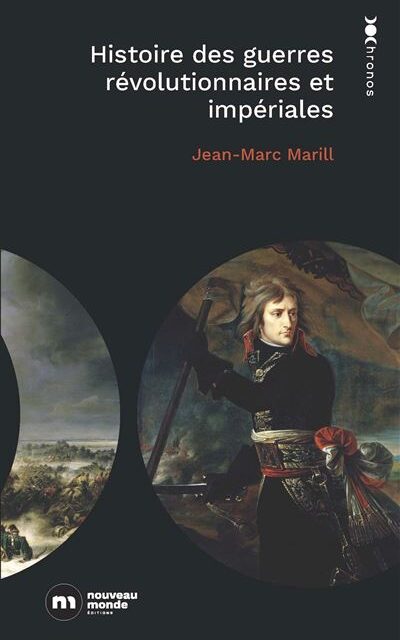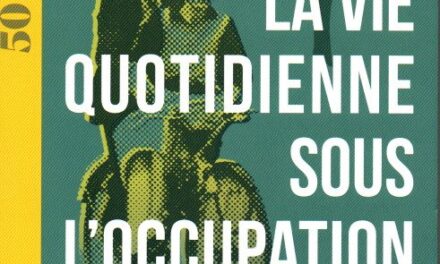Le général Marill, ancien directeur du centre historique de la Défense et docteur en histoire contemporaine est l’auteur d’une synthèse sur les guerres de la Révolution et de l’Empire qui constitue tout à la fois un récit des campagnes menées par les armées françaises et une réflexion sur les transformations importantes qui les affectent, dans le sillage de la « révolution militaire » de l’époque moderne.
Désireux d’enjamber la césure que représente le coup d’État de Brumaire, pour restituer la cohérence propre à ce conflit de près vingt-cinq ans, l’auteur adopte une démarche chronologique en faisant le récit des campagnes qui aboutissent entre 1794 à 1812 à l’extrême dilatation de la France qui établit alors son hégémonie sur l’ensemble de l’Europe. Pour cela, il centre son propos sur les transformations de l’armée française qui passe, à la faveur de la Révolution, d’une force professionnelle, pour moitié constituée de régiments étrangers, à une armée de masse, faite de citoyens-soldats issus de la conscription, avant de s’internationaliser à la fin de l’Empire, en accueillant des contingents originaires des pays alliés. Cette armée connaît également une profonde mutation de son organisation par l’introduction à partir de 1793 du principe divisionnaire théorisé par Guibert, puis par celle des corps d’armée, confiés au maréchaux. Cette organisation nouvelle favorise la mobilité et l’autonomie des troupes, ce qui les rend beaucoup plus manoeuvrières que les armées d’Ancien Régime et contribue à une transformation de la conduite des opérations, caractérisée par la concentration des forces dans le but de livrer des batailles décisives. Le combat en lui-même, l’échelon tactique, fait l’objet de remarques intéressantes. L’auteur montre ainsi comment se transforment les systèmes d’armes avec le développement de la cavalerie lourde et de l’artillerie à cheval qui permet aux armées française de dominer leurs adversaires à la fois par le choc et par le feu, ce qui s’avère décisif notamment à Wagram en 1809, où Napoléon, en constituant une grande batterie de près de 80 canons, emporte une bataille jusque-là mal engagée.
Mais Jean-Marc Marill évoque également les limites de ce « système de guerre ». La première tient à la question de la logistique. Carnot, en 1794, alors membre du Comité de Salut Public, ordonne aux troupes françaises de « vivre sur le pays », ce qui règle dans un premier temps le problème de l’approvisionnement et favorise la projection en territoire ennemi. Mais ce faisant, l’occupation française devient insupportable aux populations vaincues qui se révoltent sur les arrières des armées. La guerre d’Espagne à partir de 1808 est un bon exemple de ce qu’on nomme alors la « nationalisation » des guerres. Jean-Marc Marill rappelle, après d’autres, que les guérillas espagnole et portugaise, soutenues par les Britanniques, préfigurent l’effondrement de l’Empire. La campagne de Russie agit, quant à elle, comme un révélateur des carences logistiques de « l’armée des vingt nations », lorsque celle-ci, malgré la victoire de Borodino et la prise de Moscou, finit par se dissoudre dans l’immensité et dans l’hiver russes. L’autre grande limite réside dans l’incapacité de la Révolution et de l’Empire à reconstituer le potentiel maritime qui était celui de la monarchie finissante et qui s’était manifesté, lors de la guerre d’Amérique, par la victoire de Chesapeake en septembre 1781. Celle-ci avait contraint Cornwallis, le généralissime anglais, à capituler à Yorktown un mois plus tard. Ce succès, lié à un effort amorcé sous le ministère Choiseul, à la fin du règne de Louis XV et poursuivi sous Louis XVI avait donné à la Royale, pendant quelques années, une certaine supériorité sur la Navy, permettant à la la France d’envisager une guerre à grande échelle contre la Grande-Bretagne. Cette ambition est reprise par la Révolution et surtout par l’Empire. Mais l’émigration massive des officiers confrontés aux mutineries massives à Toulon puis à Brest, les désertions de matelots, le vieillissement prématuré des navires, en raison de l’incurie des autorités maritimes, désorganisent la marine qui ne peut opposer à l’Angleterre, en février 1793 que 20 vaisseaux et 22 frégates, alors qu’en 1791 elle en comptait respectivement 82 et 67. Tout cela permet aux Anglais, qui bénéficient en outre, pour un temps, du renfort de la marine espagnole, de contrôler la Méditerranée et de menacer les communications vers les Antilles. La marine française se cantonne alors à des missions d’escorte de convois. La bataille de Prairial en 1794 illustre sa faillite. Commandée par Villaret-Joyeuse et par le représentant Jeanbon Saint-André, l’escadre française perd 5000 hommes contre 1148 Anglais malgré l’épisode du Vengeur, héroïsé par la Convention, qui coule en emportant une partie de son équipage. Napoléon Bonaparte dès son arrivée au pouvoir s’attache à reconstituer une marine de guerre. C’est ainsi qu’entre 1804 et 1814, les Français construisent 84 vaisseaux, reprenant les orientations de la politique maritime de Louis XVI. Il modernise en outre l’armement en adoptant très tardivement le système anglais de la caronade (canons dont les fûts sont raccourcis et qui compensent leur moindre précision par une cadence de tir supérieure). Pour cela, il encourage le développement des chantiers navals en Méditerranée, à Toulon, Gênes mais aussi La Spezia, Venise, Trieste et sur la côte atlantique, de la Manche et de la Mer du Nord, Rochefort, Lorient, Cherbourg et Rotterdam. Après l’échec de Trafalgar, dont l’auteur relativise la portée, l’Empereur encourage la guerre de course, notamment privée, qui est étendue, après la mise en place du blocus continental, aux navires des pays commerçant avec la Grande-Bretagne. Marill nuance fortement le rôle de la supériorité maritime de l’Angleterre dans l’échec final de Napoléon, rappelant que ce dernier s’était joué sur le continent lors de la campagne de Russie. Bien au contraire, en maintenant la crainte d’un débarquement français en Angleterre et en encourageant la course, il a contraint la Grande-Bretagne à consentir un important effort financier qui l’a quasiment acculée à la faillite.
La fin de cette guerre fait l’objet d’intéressants développements qui montrent tout à la fois les limites logistiques du système de guerre napoléonien, lors de la campagne de 1812, tout en insistant sur ce que nous appellerions aujourd’hui sa capacité de résilience dont témoignent la reconstitution rapide d’une armée en 1813, lors de la campagne d’Allemagne ou la capacité à tenir en échec les armées coalisées, en 1814 encore, pendant plusieurs semaines, avec à peine 60 000 hommes.
Le livre de Jean-Marc Marill constitue, en somme, un manuel utile et une bonne introduction à l’histoire militaire de la période. L’expérience du commandement qui est celle de l’auteur lui permet d’éclairer les décisions des stratèges. Pour autant, on regrettera que les interactions entre la conduite de la guerre et les transformations du pouvoir politique ne soient pas toujours suffisamment explicitées. Si Jean-Marc Marill rappelle à juste titre le rôle joué par la crise de la société militaire dans le déclenchement de la Révolution (tensions entre officiers nobles et roturiers, entre l’encadrement et la troupe, refus à l’été 1789 des régiments étrangers de marcher sur Paris, mutineries comme celle de Chateauvieux et de Nancy), son analyse de l’action militaire du gouvernement révolutionnaire (1793-1794) a tendance à reprendre un certain nombre de lieux communs de la légende noire, en particulier sur l’action des représentants en mission comme Saint-Just, qu’il décrit comme des proconsuls autoritaires et incompétents, agents de la Terreur aux armées. Il s’agit là d’un stéréotype dont a fait justice Michel Biard dans son livre, Missionnaires de la République. Les représentants du peuple en mission (1793-1795). De même, sa présentation des violences de la guerre de Vendée comme le fruit d’un dérapage sanguinaire, attribué aux seuls montagnards aurait gagné à s’appuyer davantage sur les travaux de Jean-Clément Martin. De façon générale, la bibliographie utilisée fait la part belle aux mémoires d’acteurs du conflit et à des synthèses déjà anciennes bien qu’utiles, comme l’histoire militaire de la France sous la direction d’André Corvisier, alors que le champ de l’histoire militaire de la période a connu ces dernières années un important renouvellement, notamment autour d’Hervé Drévillon. Pour autant, cet ouvrage s’inscrit à sa manière dans le renouveau de l’histoire militaire autour, notamment, de la notion d’histoire-campagne qui s’intéresse à rebours de l’ancienne histoire-bataille, anecdotique et parfois franchement chauvine, à l’échelon opératique qui permet de mieux saisir l’articulation entre commandement militaire et pouvoir politique.