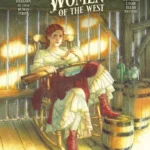La structure de la revue ayant été déjà présentée dans les comptes rendus des précédents numéros, nos commentaires porteront désormais essentiellement sur le contenu des articles.
Thomas Rabino s’entretient avec Yves Guéna dans la rubrique « Passeur d’Histoire » qui ouvre chaque numéro, mais dont on regrette qu’elle ait été réduite à deux pages seulement. 88 ans, co-rédacteur de la constitution de 1958, plusieurs fois ministre sous la Ve République, membre puis président du Conseil constitutionnel, président de la Fondation Charles de Gaulle, Yves Guéna témoigne de son engagement dans la France libre.
Breton, il apprend d’un voisin le 18 juin au soir « qu’il y a un général français qui demande qu’on le rejoigne pour continuer la guerre ». « Je me suis dit que c était formidable (…) J’avais 20 km à faire, sans moyen de transport. Le lendemain matin, je suis parti vers le port du Conquet, à la pointe du Finistère. Il y avait un bateau qui partait vers Ouessant et j’ai sauté dedans. De là, j’en ai trouvé un à destination de l’Angleterre. C’était dans la nuit du 19 au 20 juin ». Le 6 juillet, le jour de ses 18 ans, il signe son engagement dans ce qui va devenir la France libre, obéissant à une motivation essentiellement patriotique. Au début de l’été 1941, il part pour la campagne de Syrie. Il participe en juillet 1942 à la bataille d’El-Alamein : « Nous attendions cela depuis plus de deux ans. C’était exaltant. Superbe. La bataille a été rude, âpre. J’y ai perdu des camarades. Mais la traversée des champs de mines, les sapeurs de la Légion qui déminaient, les bandes blanches indiquant le passage, les terribles tirs d’artillerie italienne sur nos automitrailleuses, c’était formidable (…) On m’a déjà demandé si j’avais eu peur. Evidemment non. On ne s’engage pas pour avoir peur. »
Patrick Rouveirol signe un article intitulé « Un royaume, un occupant, deux entités », consacré aux nationalismes flamand et wallon dans la Belgique occupée. Quatre mouvements nationalistes existent en Belgique à la veille de la guerre, deux flamands et deux wallons.
– Le Verdinaso (Union des nationaux-solidaristes thiois) fondé par Joris van Severen milite en faveur de la résurrection des Dix-sept provinces (Belgique, Pays-Bas et Flandre française) telles qu’elles avaient existé au XVIe siècle ; il s’appuie sur une formation paramilitaire.
– Le VNV (Union nationaliste flamande) fondé en 1931 par Staf de Clercq, parti germanophile et antisémite qui se bat pour un Etat flamand séparé de la Wallonie.
– La Légion nationale créée en 1922, avec pour chef Paul Hoornaert, avocat liégeois germanophobe, plus proche de l’Action française que du fascisme.
– Le mouvement Rex, lancé par Léon Degrelle en 1935, du nom de la maison d’édition Christus-Rex dont il était le directeur. Dénonçant les « politiciens corrompus », le parti rexiste obtient 11% des voix en 1936 mais seulement 4% en 1939.
Les occupants de la Belgique, interlocuteurs des nationalistes flamands et wallons, sont divisés entre nazis convaincus (les représentants d’Himmler) et nostalgiques de l’Allemagne monarchique, incarnés par le général von Falkenhausen, nommé en mai 1940 commandant de la Belgique et du nord de la France.
Au sein du Verdinaso, les modérés sont écartés, tandis que d’autres rejoignent la Résistance. Jef François, ancien chef de la formation paramilitaire du mouvement, s’empare de la direction et impose une ligne dure de collaboration. Contraint par les autorités allemandes de passer un accord avec le VNV et Rex en mai 1941, le Verdinaso perd de son influence. Affaiblissement qui profite dans un premier temps à son rival flamand le VNV, qui se lance dans une politique de collaboration active avec le Reich, organise une campagne de recrutement au profit de la SS et commet des actions antisémites violentes. Staf de Clercq déclare publiquement à Anvers le 3 décembre 1940 sa pleine confiance en Hitler, son second est nommé au poste de bourgmestre de Gand par l’occupant. Le VNV est cependant débordé par un mouvement nationaliste flamand encore plus extrémiste, « De Vlag », qui demande l’intégration de la Flandre au Reich et bénéficie de l’appui de Himmler. Son chef, Jef van de Wiele, fait figure de futur leader d’une Flandre allemande. 23 000 Flamands partirent de 1941 à 1945 à la guerre sur le front russe au sein d’une légion SS « Flandern ».
Du côté wallon, la Légion nationale fait profil bas dès le début de l’occupation tout en tissant des liens avec la Résistance, ce qui conduit les Allemands à l’anéantir. « La voie est donc libre pour Léon Degrelle (…) qui décide de jouer sans vergogne la carte de la collaboration, via une série de concessions qui éloignent de lui une grande partie de ses militants ou sympathisants d’avant-guerre. » Degrelle incite les Wallons à s’engager dans la Wehrmacht, recrute des volontaires pour le front de l’Est et s’engage lui-même comme simple soldat dans ce qui devient la Légion Wallonie (Wallonisches Infanterie-Bataillon 373). En 1944 il aura atteint le grade de colonel de la Waffen SS.
« Grâce à leurs lourdes pertes estimées à 1500 tués et 1500 blessés, et à la renommée de leur chef, les Wallons, bientôt réunis dans la 28e division SS de grenadiers « Wallonien », réussissent ainsi à éclipser l’engagement plus précoce et plus massif de leurs compatriotes flamands qui ont pourtant consenti un sacrifice (sic) plus élevé. » Décoré de la Croix de Fer par Hitler en personne en 1944, Degrelle aurait sans doute joué un rôle de premier plan dans une Europe nazie, mais rien ne permet de savoir « quelle aurait été la solution politique adoptée au sujet de la Belgique par un IIIe Reich au cœur duquel le courant pangermaniste restait majoritaire ».
Matthieu Boisdron consacre un court article à « l’annexion des pays baltes par l’URSS ». Le pacte germano-soviétique du 23 août 1939 et plus encore le traité de délimitation et d’amitié signé entre l’Allemagne et l’URSS le 28 septembre, ont délimité les zones d’influence allemande et soviétique et scellé le sort des pays baltes, abandonnés à Staline. Bien que l’Estonie, la Lituanie et la Lettonie se soient déclarées neutres, l’accord germano-soviétique et l’attaque de la Pologne « permettent à Moscou d’exercer une forte et fatale pression sur la région ». Les trois États baltes sont forcés d’accepter sur leur territoire l’implantation de bases aériennes et navales dès octobre 1939.
Après une série d’incidents de frontière fabriqués par Moscou, trois ultimatums sont lancés en juin 1940 ; privés de soutiens extérieurs, les trois pays cèdent et acceptent l’établissement de nouveaux gouvernements contrôlés par les Soviétiques. Les élections de juillet donnent naturellement la victoire aux listes communistes qui recueillent plus de 90% des voix des électeurs. L’incorporation des Etats baltes à l’URSS est votée par les trois Assemblées nationales ; les Etats baltes deviennent les 14e, 15e et 16e Républiques socialistes soviétiques. Leurs armées sont intégrées à l’Armée rouge ; sociétés et économies subissent une prompte et violente soviétisation : nationalisation des entreprises, collectivisation, arrestation, déportation et exécution de la quasi-totalité des dirigeants politiques des trois nations.
Bernard Lachaise présente « le premier entourage du général de Gaulle » dans un article intitulé « Été 1940. Ceux de l’Appel ». Ce sont des militaires, de nationalité française ou non, qui se rallient les premiers, un millier d’hommes qui constituent « le fer de lance des FFL ». Aux militaires présents en Angleterre le 18 juin 1940, s’ajoutent « des Français, civils ou soldats, venus de métropole –principalement depuis la Bretagne et le Pays basque- mais aussi des colonies. Parmi eux, les marins de l’île de Sein, de futurs personnalités politiques gaullistes, alors jeunes gens, comme Yves Guéna, Christian Fouchet, Robert Galley, Maurice Schumann ; d’autres encore destinés à de brillants parcours ultérieurs dans les arts ou les sciences, tels Daniel Cordier ou François jacob. Les plus nombreux sont de simples Français libres, hommes et femmes, venus spontanément (…) et demeurés totalement anonymes après la guerre. »
Si parmi les premiers ralliés figurent de nombreux officiers de carrière subalternes (capitaine Dewavrin, capitaine Koenig, capitaine de Hautecloque), on trouve peu d’officiers supérieurs ou de généraux (lieutenant de vaisseau d’Estienne d’Orves, vice-amiral Muselier, général de brigade Legentilhomme). Durant l’été 1940, la tête de la France libre est limitée au général de Gaulle et à un entourage proche restreint et peu influent : le lieutenant-colonel Geoffroy de Courcel et Claude Bouchinet-Serreules, ses aides de camp ainsi que Claude Hettier de Boislambert. Les autres figures majeures de l’entourage sont, chez les civils, René Cassin, René Pleven et Maurice Schumann, et du côté des militaires, le vice-amiral Muselier, Geoffroy Thierry d’Argenlieu et le capitaine Dewavrin : on remarque « l’absence de tout notable de la politique, de l’administration, de la diplomatie ou des affaires ».
La diversité caractérise ce premier noyau : diversité générationnelle, professionnelle, politique (avec cependant une dominante de la droite), diversité des modalités d’arrivée à Londres. Cassin le juriste et Pléven le négociateur ont pour tâche de contribuer à la fondation d’un État ; Muselier, Thierry d’Argenlieu, Dewavrin et Schumann ont pour mission de « lutter contre l’ennemi » et « libérer la France » en fondant une force militaire, en ralliant les colonies, en organisant des services spéciaux et en développant la « voix de la France » en liaison avec la BBC. Vaste programme ! Ces premiers « compagnons » ont posé les bases du « gaullisme de guerre ». Certains sont restés fidèles à De Gaulle jusqu’au bout, d’autres se sont éloignés très vite (Muselier) ou ont pris leurs distances plus tard.
Sous le titre « Une colonie française en danger », Yann Mahé montre comment l’Indochine entre dans la « sphère de co-prospérité de la Grande Asie orientale ». Le 30 août 1939, le général Catroux est nommé gouverneur général de l’Union indochinoise, fédération regroupant Annam, Tonkin, Cochinchine, Laos et Cambodge, peuplée de 22 millions d’habitants, dont seulement 39 000 Européens. Le Japon profite de la défaite de la France pour multiplier et accroître ses exigences. Catroux dispose de peu d’hommes, de peu d’armes et doit constater l’indifférence de la diplomatie américaine : il n’a d’autre choix que de céder à la première exigence nippone, celle de fermer la frontière avec la Chine, s’attirant les protestations énergiques de Tchang-Kaï-Chek.
Limogé pour avoir cédé, Catroux se rallie au général de Gaulle, tandis que l’amiral Darlan le remplace par l’amiral Decoux. Généraux et amiraux japonais ont imposé à l’empereur un plan qui consiste à faire pression sur la France pour s’installer au Tonkin, afin de le transformer en base arrière dans la guerre contre la Chine et, plus largement, de faire entrer l’Indochine dans la « sphère de co-prospérité de la Grande Asie orientale », appellation de l’immense espace dont la conquête est désormais projetée. Decoux va devoir lui aussi céder aux exigences nippones croissantes : les Japonais obtiennent l’utilisation de trois aérodromes au Tonkin et le droit de transit de leurs troupes à travers la province. Le 22 septembre 1940, l’armée japonaise viole l’accord, franchit la frontière tonkinoise à Langson et entre dans Haïphong. Encerclées, bombardées, les troupes françaises doivent se rendre après que plus de 800 hommes aient été tués. « L’incident de Langson a révélé à l’Asie toute entière l’extrême vulnérabilité de la position française en Indochine ».
David Zambon présente « La guerre parallèle de Mussolini » en septembre 1940. Mussolini souhaite à la fois profiter d’une victoire allemande qui lui semble acquise et, en même temps, ne plus rester dans l’ombre de son puissant allié. Hitler ayant décliné son offre de participation à l’invasion de l’Angleterre, il décide de lancer l’armée italienne à l’offensive, malgré les réticences d’une bonne partie de son entourage et de ses généraux, plus réalistes que lui.
Début août 1940, c’est l’attaque du Somaliland britannique, puis en septembre l’offensive de Graziani contre l’Egypte à partir de la Libye. L’armée italienne pénètre de 80 km en territoire ennemi. Mussolini jubile tandis que Graziani constate, devant les difficultés de la logistique, le bien-fondé de ses réticences. Furieux de voir les troupes allemandes pénétrer en Roumanie et d’être mis devant le fait accompli, Mussolini décide d’attaquer la Grèce à partir de l’Albanie. Il compte sur un effondrement grec au moment où les troupes italiennes franchiront la frontière ; il ne croit pas au soutien britannique à la Grèce et compte sur une attaque conjointe de la Bulgarie, soucieuse de récupérer la Thrace perdue en 1919 ; il ignore les difficultés logistiques à prévoir. Le 28 octobre 1940, les troupes italiennes franchissent la frontière grecque. Supérieurs en nombre, animés d’un fort esprit patriotique, les Grecs organisent la contre-attaque.
Les conséquences de ce fiasco italien sont importantes sur la poursuite de la guerre. Graziani se verra privé de renforts au moment de l’offensive britannique en décembre, les Allemands devront intervenir en avril dans les Balkans, ce que Mussolini voulait éviter à tout prix, et ce qui retardera Hitler dans ses plans d’offensive contre l’URSS.
Vincent Bernard consacre un article à la mise en place du régime de Vichy (« Travail, Famille, Patrie. Vichy, 1940 »), le vote du 10 juillet, l’établissement de la dictature, le choix de la collaboration et de la révolution nationale, et un autre à l’échec des Français libres devant Dakar en septembre 1940 (« Les Trois Piteuses » de Dakar» ), « camouflet cinglant » pour la France libre naissante.
Intitulé « Bataille d’Angleterre. Le grand bluff ? », le dossier est composé de trois articles : « Débarquer en Angleterre ! L’impossible opération Seelöwe » par Yann Mahé, « La bataille d’Angleterre a-t-elle eu lieu ? » par François Delpla, « Le duc de Windsor. Un souverain déchu courtisé par les nazis » par François Kersaudy. Un autre article de François Delpla consacré à « La diplomatie allemande dans l’automne 1940 » est complémentaire de ce dossier.
L’opération « Seelöwe » (« Otarie ») de débarquement allemand et d’invasion de l’Angleterre y est présentée comme une vaste entreprise d’intoxication destinée à dissimuler à Staline les préparatifs de l’invasion de l’URSS. Hitler espère d’abord que les préparatifs de l’opération suffiront à inciter Londres à accepter la paix « généreuse » qu’il lui propose. La Kriegsmarine se sait incapable de s’opposer à la Royal Navy, la Luftwaffe ne parvient pas à obtenir la maîtrise du ciel, il s’en faut de beaucoup. Généraux et amiraux font donc tout leur possible pour pousser Hitler à reporter l’opération et finalement à la remettre définitivement au printemps 1941.
Dès le 13 juillet, Hitler pense à une attaque de l’URSS et se soucie de sa préparation diplomatique. Cette réorientation doit rester secrète car, connue, elle permettrait à Churchill de triompher et inquièterait Moscou qui pourrait envisager de se rapprocher de Londres. Churchill semble n’avoir jamais cru à la possibilité d’une invasion mais la menace est « essentielle à la mobilisation de l’Empire et de ses ressources »
A l’heure où la victoire sur l’Angleterre ne faisait guère de doute, un curieux projet semble avoir germé dans l’esprit du Führer qui aurait envisagé de faire appel au Duc de Windsor pour monter sur le trône d’une Angleterre vaincue. Ce duc est l’ex-roi Edouard VIII qui a abdiqué en 1936 afin de pouvoir épouser l’Américaine Wallis Simpson, deux fois divorcée. F. Kersaudy le présente comme un homme immature, influençable et vénal, connu pour ses sympathies nazies : en voyage en Allemagne en 1937 avec son épouse, il a rencontré Goebbels, Göring et Hitler, passé en revue des SS et fait le salut nazi ! Le SS Walter Schellenberg est chargé par Ribbentrop, ministre des affaires étrangères, de le contacter au Portugal dans l’été 1940 et de le rallier à la cause de l’Axe.
Cet ensemble d’articles apparaît un peu décousu et fait en partie double emploi avec ceux du numéro précédent consacrés déjà à la Bataille d’Angleterre ; il aurait sans doute gagné à être rassemblé dans un ensemble plus structuré et plus cohérent. Cohérence qui manque aussi entre l’article de Vincent Bernard sur le gouvernement de Vichy en 1940 qui aborde la rencontre de Montoire d’une façon claire mais assez superficielle et celui de François Delpla qui l’aborde dans le cadre d’un article très pointilleux sur la diplomatie allemande. Clarté et cohérence qui caractérisent cependant la plupart des articles et que l’on souhaite voir maintenues. Il est vrai qu’il n’est sans doute pas facile à une petite équipe d’assurer la parution d’une telle revue au rythme d’une livraison tous les deux mois ; ce numéro repose pour une majeure partie sur un petit nombre de contributeurs. Peut-être faudrait-il envisager d’en élargir l’assise, ce qui permettrait d’aborder des questions importantes qui ne l’ont pas été, telles que la stratégie du Komintern et la politique du PCF en 1940.
Signalons enfin deux courts articles consacrés l’un au cinéma français sous l’occupation (vraiment trop court !) et l’autre à la rentrée scolaire de 1940.