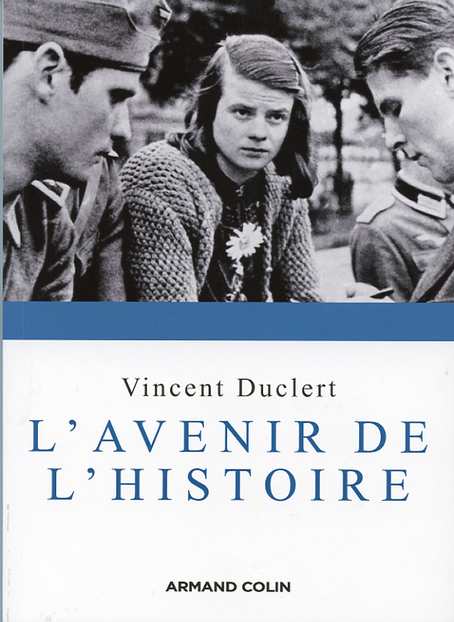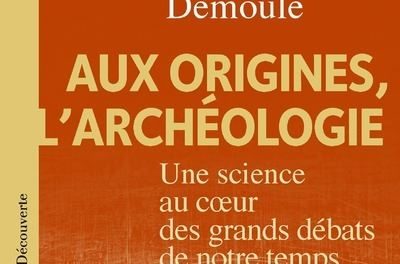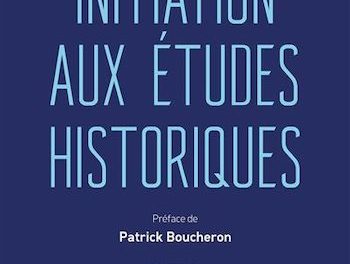Au moment où l’on assiste, et cela a déjà été écrit dans les articles de La Cliothèque, à une offensive idéologique visant à instrumentaliser l’histoire, cet ouvrage publié par Vincent Duclert professeur à l’école des études en sciences sociales, vient à point nommé.
Car cette offensive idéologique sur l’instrumentalisation de l’histoire est doublée d’une tentative visant à la vider de son contenu démocratique. Cette formule de l’auteur n’est pas anodine, car elle donne tout son sens à ce travail méthodique sur l’avenir de l’histoire.
Par-delà les palinodies que l’on peut lire trop souvent sur « l’histoire enseignée », c’est sur « l’histoire citoyenne », que l’auteur nous interpelle. Et cette histoire citoyenne est clairement l’affaire de tous, qu’ils soient enseignants ou non.
Ceci posé, l’auteur propose une réflexion particulièrement stimulante sur l’évolution passée des différents courants historiques qui se sont affrontés.
En effet, des bouleversements profonds ont affecté les savoirs littéraires auxquels l’histoire se rattache, et ces bouleversements sont tout autant techniques et matériels comme la disparition souvent annoncée du livre, que critiques et politique avec l’irruption de l’État et de la loi dans la définition de la vérité historique.
Pour ce qui concerne les livres, et notamment les livres d’histoire, la Cliothèque qui vise à promouvoir le livre dans la sphère numérique, s’inscrit clairement dans une mission défensive du pluralisme de la pensée historique. Et c’est à ce titre que cet ouvrage nous inspire très largement.
L’avenir de l’histoire, ce ne sont pas seulement les historiens dit l’auteur, mais tous ceux qui en appliquent les méthodes, en sont comptables. Les historiens sont tous des acteurs de l’histoire en train de se faire, car la connaissance historienne ne se limite pas simplement à penser le passé, mais surtout à en envisager l’avenir.
L’histoire se fait porteuse d’une vision de l’avenir car, en défendant par l’expérience la capacité de la raison critique à comprendre ce qui peut paraître parfois incompréhensible, il s’agit en réalité de maintenir en face de l’avenir une volonté de la pensée de résister à ce qui la menace et l’écrase.
Et c’est là tout l’enjeu d’un combat pour le maintien d’une histoire enseignée, d’une histoire vivante, qui ne soit pas simplement commentaire de l’actualité immédiate, comme certaines malheureuses réformes le préconisent.
L’invention démocratique
Car la méthode historique qui s’assimile à l’enquête, à la confrontation des sources, à l’investigation sur les mécanismes sociaux et politiques, ne peut s’assimiler à un simple récit du temps présent. C’est bien au contraire par les incessants allers-retours entre le présent et le passé que se construit la réflexion historique, et que ce que j’appellerai « l’histoire citoyenne » prend tout son sens.
Penser l’avenir de l’histoire, c’est définir ce que l’on entend par histoire afin de parvenir à la relation qu’elle entretient avec l’avenir et avec son propre avenir.
L’histoire, est considérée comme « science du passé », mais elle tend vers l’avenir. Car l’histoire apporte une vérité du passé, qui est absolument nécessaire à la conception des sociétés présentes.
La mise en histoire du passé est aussi ancienne que les civilisations de la tradition orale ou de l’écriture et du livre. La mise en histoire à accompagné les civilisations. Et cela se vérifie notamment dans la formation de la pensée grecque, telles que Jean-Pierre Vernant a pu la décrypter. L’histoire, comme recherche de la vérité du passé, contribue à la formation de la pensée démocratique.
L’autre grande tradition des historiens, évoquée dans l’introduction de cet Avenir de l’histoire, est celle que Jules Michelet a essayée de promouvoir. Jules Michelet met en scène un nouvel acteur collectif, «le peuple français». Cette recherche rencontre l’aspiration démocratique que l’installation de la république permet de satisfaire.
Dès le premier numéro de la « Revue Historique », l’éthique de vérité qui définit la discipline implique un engagement dans la vie nationale, et même internationale, afin de la doter d’une unité librement consentie faite de liberté et de raison.
Mais à ce moment-là, l’histoire courait le risque de l’instrumentalisation, de la production d’un discours certes porteur de valeurs humanistes, mais qui s’inscrivait clairement dans une confrontation idéologique avec une autre conception. Ernest Renan, ou Gabriel Monod, avaient d’ailleurs résolu cette contradiction, en associant au passé commun, formateur de la nation, un principe spirituel qui transcendait les époques.
C’est pour arracher l’histoire au risque des usages politiques et idéologiques que les historiens de l’École des Annales ont voulu ramener la discipline dans une sphère plus strictement scientifique. Mais dans le même temps, Marc Bloch, dans l‘Étrange Défaite, reprochait à ses confrères leur absence d’implication dans la vie de la cité. D’après l’auteur, l’historien a voulu « rattraper le temps perdu », ce qui explique sans doute son engagement y compris jusqu’au sacrifice ultime, dans la résistance.
Ce qu’écrivait Marc Bloch, alors, reste toujours d’actualité : « l’histoire est, par essence, science du changement. Elle sait et elle enseigne que deux événements ne se reproduisent jamais tout à fait semblables, parce que jamais les conditions ne coïncident exactement. Elle peut s’essayer à pénétrer l’avenir ; elle n’est pas, je crois, incapable d’y parvenir. Mais ces leçons ce sont que le passé recommence, que ce qui a été hier sera demain. Examinons comment hier a différé d’avant-hier et pourquoi il trouve dans ce rapprochement, le moyen de prévoir en quel sens demain, à son tour, s’opposera à hier. »
L’État et l’histoire
Le rapport de l’État à la mémoire, par le biais de l’histoire ne se limite pas aux seuls sujets sensibles. L’État, ou plus exactement l’idée républicaine incarnée dans les pratiques constitutionnelles de gouvernement, s’est donné pour mission de promouvoir la mémoire et l’histoire nationale.
C’est bien là une spécificité française, notamment sous la IIIe République avec l’écriture, grâce à des historiens « officiels », d’un véritable roman national déjà largement évoqué par ailleurs.
La question qui bien évidemment se pose est celle de la façon dont l’histoire très contemporaine, « du temps présent » est traitée. Sous la IIIe République, l’histoire immédiate était présentée dans des manuels « officiels » rédigés par des historiens « institutionnels » comme Ernest Lavisse. Depuis, l’État a toujours exprimé des réticences à soutenir la recherche sur le contemporain, c’est-à-dire sur lui-même et sur ses propres pratiques. En 1947, la naissance de la sixième section des sciences économiques et sociales dans le cadre de l’École pratique des hautes études, a été dans une certaine mesure assez problématique.
La République semble avoir accordé peu de moyens à la recherche, révélant ainsi une faible volonté pour soutenir les historiens dans leurs tâches reconnues de connaissance du passé et du présent. Depuis l’Institut d’histoire du temps présent, fondé en 1978, héritier du Comité d’histoire de la seconde guerre mondiale qui avait été créé en 1950, il semblerait que l’histoire contemporaine en France ne dispose pas d’un soutien public à la hauteur des intentions affichées par le politique et la tradition nationale.
Il semblerait que le discours politique sur le passé doive suffire. Force est de constater que les tendances actuelles, telles qu’elles ont été exprimées par la conception de l’histoire développée par l’actuel locataire de l’Élysée, si tant est que celui-ci qui en ait une à moins que cela ne soit celle de ses propres conseillers, s’appuient essentiellement sur une histoire mémorielle. Cette histoire met en avant le passé, et encore un passé très largement édulcoré et en tout cas magnifié, dont on essaie de retirer des références gênantes, sous couvert de refus de la repentance.
Et c’est peut-être ainsi, à la lumière de cet enseignement, que l’on peut analyser les tentations de vider l’histoire de son sens et de ses contenus. Consciemment ou non, l’appréciation que l’on peut porter sur les programmes dans leur version 2010 incite à de curieux rapprochements. En mettant l’accent sur des valeurs, des références puisées dans le passé, mais magnifiées jusqu’à en devenir intemporelles, on court le risque de vider la réflexion historique du « mouvement » qu’elle suscite.
La pensée historienne se voit, d’après l’auteur, « brutalisée ». Les usages partisans de l’histoire, que l’on évoque la nation et ses valeurs, l’identité nationale, ou encore la mal nommée expression de « devoir de mémoire », font courir non seulement à la discipline, mais à la culture démocratique un risque majeur.
Ce sont donc toutes ces questions que traite l’auteur présentant dans une première partie un certain nombre de « tournants critiques » que la discipline a dû amorcer. A dû négocier même, si l’on veut reprendre cette image du tournant, qui n’est jamais qu’un virage. Le premier tournant est celui de la reconquête du temps historique. Et notamment sur la montée du présentisme. Dans son ouvrage paru en 2001, avec Jacques Revel, François Hartog, dans Les Usages politiques du passé, explique que l’historien doit être un guetteur lucide du présent pour aider à le comprendre.
Le deuxième chapitre de la première partie traite de la pensée des archives. Au tournant des années 1990, les archives n’ont plus simplement été envisagées comme une source, mais par elles-mêmes, comme objet d’une politique d’archives. La législation a d’ailleurs évolué notamment après 2008 par le vote d’une loi nouvelle qui affirme le principe du droit d’accès immédiat aux archives publiques de tous les citoyens, et réduit dans l’ensemble les délais pour les archives réservées. Mais ce qui pourrait se révéler antidémocratique, comme la non communication de documents relatifs aux armes nucléaires biologiques et chimiques, c’est bien cette définition nouvelle très approximative de la vie privée articulée sur l’éventuel préjudice qu’impliquerait la communication de documents.
Le document d’archives, tout comme l’histoire d’ailleurs, devient objet construit. Une politique d’archives est l’objet d’histoire politique.
Dans le chapitre trois, entre états, politique et société, l’auteur reprend un certain nombre d’éléments déjà connus sur les relations complexes entre la communauté des historiens et l’État. Sous la IIIe République, les historiens sont des instituteurs de la nation. On appelait ainsi Ernest Lavisse.
Liberté pour l’histoire
Face à la mort qui renvoie définitivement les êtres dans le passé, les vivants s’arment pour l’avenir en conservant le meilleur des disparus. Pour les historiens, le meilleur apparaît comme la tradition vivante de la liberté de la recherche, de l’invention des concepts et des méthodes, de mise en question des certitudes pour conserver celles qui valent la peine de l’être. Avec l’affirmation de certitudes, d’une France contre une autre, on voit bien le risque démocratique que l’on fait courir au pays.
La pratique de l’histoire, son écriture, sa transmission, préparent l’avenir en assurant le présent. Il s’agit évidemment d’une défense de la corporation, de l’avenir de l’histoire en tant que discipline, savoir, institution. Mais il s’agit aussi de l’histoire au sens de destin commun de l’humanité.
L’imprévisibilité restera la règle, on le mesure chaque jour et même dans des domaines que les sociétés paraissaient parfaitement contrôler, ainsi de l’espace monétaire européen frappé en 2010 d’une crise dont l’Europe ne semble pouvoir se relever.
L’imprévisibilité de l’avenir devient une épreuve indépassable lorsque la pensée rationnelle manque pour l’analyser, lorsque la société – ses historiens compris – bascule dans l’empire des émotions, lorsque la déraison égare les consciences.
Devant les risques de l’avenir, l’histoire peut agir lorsqu’elle-même construit son avenir. Lorsque les historiens se préoccupent de l’avenir de leur discipline, de leurs méthodes, de leurs sources, mais aussi de leurs étudiants et pour une partie d’entre nous de leurs élèves, appelés à devenir des citoyens. Face à une « demande sociale » d’histoire, désordonnée mais parfois activiste sous couvert de références mémorielles, les historiens se doivent de répondre sur leur terrain, celui d’une science humaine.
Réfléchir à l’avenir de l’histoire, n’est-ce pas précisément rapprocher ce qui se sépare dans la discipline, lancer un pont entre l’étude du passé et l’examen du présent, un pont entre les contraintes de la méthode et les libertés du chercheur, entre l’enseignement et la recherche, entre les certitudes et les incertitudes, entre les rives des continents, entre les temps des civilisations, entre ce que nous savons et ce qui nous hante, Entre les personnes, entre les individus et les sociétés, entre les langues et les langages.
Partie prenante de la démarche historienne même la plus académique (ou qui devrait l’être), la pensée réflexive donne à l’histoire une dimension philosophique. Cela signifie qu’aucune question intéressant les sociétés ne peut rester dans l’ombre, enfermée dans des catégories ou des impensés. Cette disposition à la compréhension constitue un bien commun dont l’usage par des historiens de vocation (et non pas seulement de métier) rend l’avenir collectif moins imprévisible, plus sûr. Mais cela n’est possible qu’à condition de permettre l’acculturation de cette pensée historienne par le plus grand nombre. Elle est un moyen de comprendre son existence dans la société et dans le monde, au milieu des paysages et des nations, en face des pouvoirs et des morales, dans la souffrance et dans le bonheur, en tissant des relations et des liens qui construisent les identités vivantes. L’école, la lecture, les médias, le lien familial, les réseaux d’amis, l’expérience militante, aident à cette prise de conscience de la nécessité de penser historien, d’être historien.