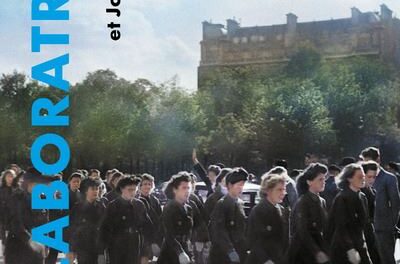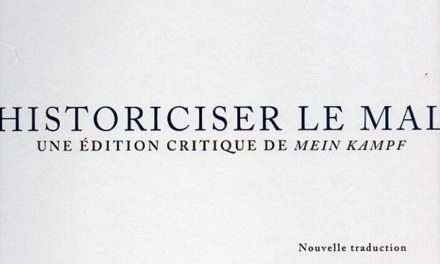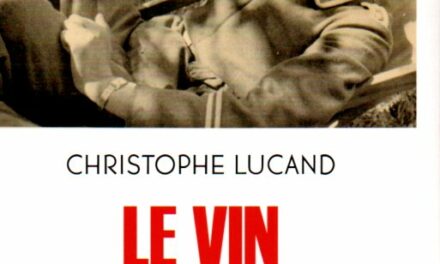Le numéro 6 de la revue est consacré aux mois de juillet et août 1940. La France est vaincue et occupée, Hitler envisage d’envahir l’Angleterre qui refuse la paix qu’il lui propose. On trouve dans ce numéro les articles attendus sur la Bataille d’Angleterre et sur Mers el-Kébir mais aussi quelques autres articles moins liés aux événements. Comme à chaque numéro, les 17 pages de chroniques permettent de suivre très simplement les événements principaux, semaine par semaine tandis que l’éphéméride qui se trouve dans la partie inférieure de chaque double page consacrée à une semaine caractérise très brièvement de nombreux autres faits internationaux. Quatre pages de chroniques bibliographiques dont deux pages jeunesse sont consacrées aux publications récentes.
François Delpla propose un court entretien avec Stéphane Hessel (qu’il rencontrera de nouveau sur d’autres moments de son expérience). Né allemand en 1917, d’un père juif et d’une mère protestante, venu en France à l’âge de sept ans, horrifié par le nazisme, pacifiste et munichois, collaborateur du général de Gaulle à Londres, arrêté en France et déporté à Buchenwald, diplomate, co-rédacteur de la Déclaration universelle des droits de l’homme, animateur de l’appel des « résistants » de 2004 répercuté en 2007 sur le plateau des Glières, Stéphane Hessel témoigne des conditions dans lesquelles il a vécu 1940. Etonné de la défaite française, fait prisonnier, évadé, il reprend ses cours de normalien à Montpellier puis décide de gagner Londres pour continuer le combat auprès de ce général dont il a entendu parler très tôt. Il prend le temps de mettre ses beaux parents à l’abri des persécutions antisémites par une rencontre avec le journaliste américain Varian Fry à Marseille, qui lui procure aussi de faux papiers. Il gagne Lisbonne avec son épouse, la quitte après avoir insisté pour qu’elle parte aux États-Unis avec ses parents puis gagne Londres au début de 1941.
Deux articles sont consacrés au « Vatican des années sombres aux années noires ». L’un de Jean-Thomas Nicole, « Le spectre de l’ambivalence » qui traite des relations du Saint-Siège et de l’Allemagne nazie de 1933 à 1938, et l’autre de Nicolas Anderbegani intitulé « Pie XII face à la guerre ».
Les nonces apostoliques, représentants diplomatiques du Vatican étaient les « yeux et les oreilles du Saint-Siège » en Allemagne hitlérienne. Leur description de la situation et leurs appréciations politiques formaient la matière première des jugements du Saint-Siège. Monseigneur Cesare Orsenigo est nonce apostolique en 1933 et le nazisme exerce sur ce diplomate « une fascination mystérieuse en même temps qu’elle provoque une angoisse diffuse ». Il « incarne en lui-même le dilemme des catholiques allemands qui oscillent entre le respect des normes épiscopales édictées contre l’idéologie nazie par la conférence des évêques réunies à Fulda en août 1932 (…) et la fascination pour le nouveau régime et son attitude politique. Il en résulte dans les réactions de l’épiscopat devant la législation nazie, une politique de l’autruche tendant à sauver les apparences ». L’attitude du Vatican est ferme à l’égard du droit international bafoué mais il ne fait rien en terme d’actes concrets et le sort des juifs n’est dans ce contexte qu’un aspect mineur de la question.
L’encyclique Mit Brennender Sorge (« Avec une vive inquiétude ») signée par le pape Pie XI le 14 mars 1937 peut être lue comme une condamnation du nazisme. Œuvre du cardinal Pacelli (futur Pie XII) et de l’aile la plus antinazie de l’épiscopat allemand, elle révèle au monde la querelle d’interprétation dont fait l’objet le concordat signé avec le Reich en 1933. Mais une autre lecture est possible : écrite en allemand, son sujet est limité à l’Allemagne et aux questions qui ne concernent que le clergé allemand ; elle ne critique ni ne condamne le totalitarisme et la dictature ; elle n’évoque pas les agressions nazies en politique extérieure. De 1933 à 1938, « l’Église catholique ne se risqua jamais à nommer le mal hitlérien de manière explicite et ainsi poser, en toute clarté, les nécessaires limites à l’intolérable et à l’injustifiable totalitaire ».
Né en 1876 à Rome, Eugénio Pacelli est ordonné prêtre en 1899 puis s’oriente vers la diplomatie et devient en 1914 le conseiller de Benoît XV en politique étrangère. Il est nommé nonce apostolique en Bavière en 1917. Jusqu’en 1929, il est témoin des soubresauts de la politique de la République de Weimar et se montre un grand admirateur de la culture allemande. Profondément anticommuniste, il défend l’idée d’une Europe fédérale groupée face au péril bolchévique. Sa nonciature terminée en 1930, il devient collaborateur de Pie XI et le principal artisan du concordat de 1933. Il estime que le nazisme est une négation de la culture judéo-chrétienne et, à la demande de Pie XI, il rédige l’encyclique Mit Brennender Sorge. Il demeure néanmoins partisan des régimes autoritaires et fervent défenseur du général Franco.
Elu pape en mars 1939, il est confronté à la menace de guerre. Il entend d’abord jouer un rôle de médiateur et demeure mesuré dans ses propos. Il s’efforce de maintenir l’Italie dans la neutralité et écrit dans ce sens à Mussolini. De fait, il ne dénonce pas ouvertement l’agressivité hitlérienne et consent aux événements. « Homme de diplomatie, admirateur de la nation allemande mais conscient assez tôt des dangers idéologiques du nazisme, pourfendeur infatigable du communisme (…), Pie XII a constamment tenté de maintenir une forme d’« impartialité », cherchant la pondération et la juste mesure, y compris aux pires heures de la guerre ».
Un court et clair article de Vincent Bernard fait le point sur la situation politico-administrative de la France occupée, écartelée entre zone occupée par l’armée allemande, Alsace-Lorraine annexée de fait et germanisée, zone interdite et zone réservée qui semblent vouées à la colonisation rampante, sur fond d’illusions vichystes et d’exploitation économique allemande. A la suite de cet article on trouve le texte de la convention d’armistice signée par la France le 22 juin 1940.
Jean-Louis Paniccaci consacre un article aux « territoires occupés par les forces armées italiennes » de juin 1940 à novembre 1942. C’est le spécialiste de la question à laquelle il a consacré sa thèse qui vient d’être publiée aux Presses Universitaires de Rennes. En 1940, l’armée italienne occupe 840 km2 du territoire français : 13 communes savoyardes, dauphinoises et azuréennes (Menton) ainsi que huit hameaux, peuplés de près de 30 000 habitants, sans compter 11 000 hectares d’alpages et de forêt. Les destructions préventives ordonnées par les autorités militaires françaises dans la nuit de 10 juin 1940 ont causé des détériorations importantes au réseau routier et ferroviaire, dégâts auxquels se sont ajoutés ceux consécutifs aux duels d’artillerie puis le pillage systématique par les soldats italiens des agglomérations dont la population avait été évacuée.
Désireux d’affirmer sa souveraineté sur les territoires occupés, l’Italie déploie d’importantes garnisons et y organise des opérations de propagande. Un décret du Duce marque une volonté de mainmise sur la gestion des communes occupées, préalable à une annexion ; la lire a cours légal ; la loi italienne s’applique en matière pénale ; les fonctionnaires français ne sont pas admis à réintégrer leur poste ; la langue italienne est obligatoire dans les services publics ; la police est assurée par des carabiniers et des miliciens fascistes.
Après l’occupation généralisée du 11 novembre 1942, les territoires occupés en juin 1940 demeureront détachés de l’ancienne zone Sud de la France, mais ils subiront une pression moindre puisqu’ils ne seront plus la « vitrine » de l’impérialisme fasciste, mais plutôt l’arrière-garde de la 4e Armée italienne déployée dans les dix départements du Sud-Est, Menton étant choisie comme siège du quartier général
François Delpla fait le point de manière précise sur les événements de Mers el-Kébir et leurs interprétations. Il a récemment publié un ouvrage détaillé sur le sujet et construit son article autour de « onze idées courantes à préciser, à corriger ou à nuancer ». Sur le fond de la question on pourra se reporter au compte rendu de son ouvrage proposé récemment par la Cliothèque.
Thomas Robinot, auteur d’un ouvrage publié chez Perrin en 2008 sur le réseau « Carte » signe un article intitulé : « La Proto-Résistance » et consacré à « l’aurore du combat clandestin ». En juin 1940 la guerre est finie et la résignation s’empare des esprits. Pour quelques-uns, très rares, la défaite n’est pas irréversible, à condition d’agir, de poursuivre le combat. Mais comment et avec qui ? La Résistance n’existe pas. Modèles et références sont à inventer ; il faut désobéir, transgresser, prendre des risques. Cette volonté donne naissance à « un large spectre d’actions, d’abord individuelles, ponctuelles et décousues, doublées d’initiatives à vocation collective, envisageant la lutte à long terme ».
Parmi les actes précoces, guidés par les circonstances et l’éthique de leurs auteurs, figure le célèbre geste de Jean Moulin. Autre exemple, celui d’Etienne Achavanne, ouvrier agricole âgé de 48 ans, réquisitionné par l’armée allemande pour travailler sur l’aérodrome de Boos, près de Rouen. Le 19 juin, il coupe les lignes de communication de la base aérienne. Dénoncé, arrêté, jugé par un tribunal allemand, il est fusillé le 4 juillet 1940 : « il est le premier mort d’une résistance presque désespérée, fruit d’une pulsion patriotique ». D’autres cherchent à sortir les Français de leur « torpeur traumatique », à alerter les consciences, à réveiller l’instinct national : ils lacèrent des affiches de propagande, rédigent et distribuent les premiers tracts et appels. C’est le temps des initiatives ponctuelles inspirées de réflexes patriotiques ou humanistes.
Puis se constituent de petits groupes en fonction de solidarités familiales, amicales, intellectuelles, artistiques, religieuses, syndicales, politiques etc. Les aires urbaines (Paris, Lyon, Marseille) jouent un rôle capital. Aux côtés des premières filières d’évasion pour militaires britanniques, polonais, tchécoslovaques, se développent d’autres canaux d’exfiltration utilisés par des réfugiés ou des victimes de persécutions, comme le Comité américain de secours de Varian Fry, à Marseille.
Enfin se créent les noyaux des futures organisations de résistance, réseaux et mouvements. Henri Frenay, capitaine d’active, prisonnier évadé, homme de droite, germanophobe, projette dès l’été 1940 de travailler à la Revanche en envisageant la création d’une future Armée secrète. Artiste peintre et homme du monde replié dans le Sud avec sa famille, André Girard rencontre le colonel Vautrin, responsable du Deuxième Bureau (Services secrets) de l’Armée de Vichy pour le Sud-Est, et jette avec lui les bases d’un réseau qui compte sur l’appui de la Grande Bretagne. En zone Nord naissent les premiers réseaux de renseignement. Le groupement constitué, à Paris, au sein du Musée de l’Homme fait office de précurseur : « rassemblés autour de la bibliothécaire Yvonne Oddon, de Boris Vildé et Anatole Lewitski -deux chercheurs russes naturalisés- ce premier noyau ne tarde pas à se rapprocher d’autres organisations embryonnaires (dont celle de Germaine Tillion) avec l’intention d’associer des activités de propagande, d’évasion et de renseignement : la situation caractéristique d’un mouvement de résistance ».
C.-J. Ehrengardt explique « comment la Luftwaffe a perdu la Bataille d’Angleterre ». Le bilan des combats aériens entre le 13 août et le 31 octobre 1940 fait apparaître la perte de 1666 avions allemands et de 1436 avions anglais. La mission de la Luftwaffe était de conquérir la supériorité aérienne, préalable à une hypothétique invasion de l’Angleterre. Elle a échoué, entraînant le désintérêt définitif de Hitler pour une opération en laquelle « il ne croyait que modérément ». Les raisons de cet échec peuvent être imputées au Haut Commandement de la Wehrmacht dont le chef suprême est Hitler et à celui de la Luftwaffe commandée par Goering. Elles sont ainsi résumées :
– Tergiversations sur la nécessité et la manière de vaincre militairement le Royaume-Uni.
– Absence de vision globale de la guerre aérienne stratégique.
– Incompréhension de la notion de supériorité aérienne et de ce qu’elle implique en terme de constance dans l’effort et de mobilisation industrielle.
– Inadaptation des appareils de la Luftwaffe à des opérations stratégiques (la Luftwaffe est une arme tactique équipée pour des combats de type continental).
– Défaillance des services de renseignement allemands sur la production aéronautique britannique, sur le choix des objectifs et sur l’estimation réelle des dégâts. Ici l’incompétence de Goering est largement engagée.
François Kersaudy (auteur d’une récente biographie de Goering) dresse un portrait de ce « premier paladin du Führer » à l’heure de la bataille d’Angleterre. Les illustrations révèlent les aspects grotesques du personnage ; l’article expose son incompétence immense en matière d’aviation, sa servilité à l’égard d’Hitler devant lequel il tremble, son goût immodéré pour le luxe et les plaisirs de ses villas, châteaux et de son stupéfiant palais de Carinhall, sa dépendance à l’égard de la drogue.
Vincent Bernard, montre que le ralliement de l’Afrique équatoriale française à de Gaulle en août 1940 fut la « première victoire de la France Libre ». Tchad, Moyen Congo, Oubangui-Chari et Cameroun se rallient à la France Libre les 26, 27 et 28 août 1940, sous l’action du gouverneur du Tchad Félix Éboué et de quelques envoyés du général de Gaulle : René Pléven, le colonel de Larminat, le commandant Leclerc et le commandant Colonna d’Ornano, avec l’appui logistique du gouverneur anglais du Nigéria. Ce ralliement permit d’augmenter les très maigres moyens matériels, militaires et économiques de la France Libre et de donner à de Gaulle les bases d’une souveraineté territoriale : il crée d’ailleurs un « Conseil de défense de l’Empire », première forme de gouvernement provisoire installé à Brazzaville.
Le numéro se termine par une analyse du film mythique de Michael Curtiz (1942), Casablanca.