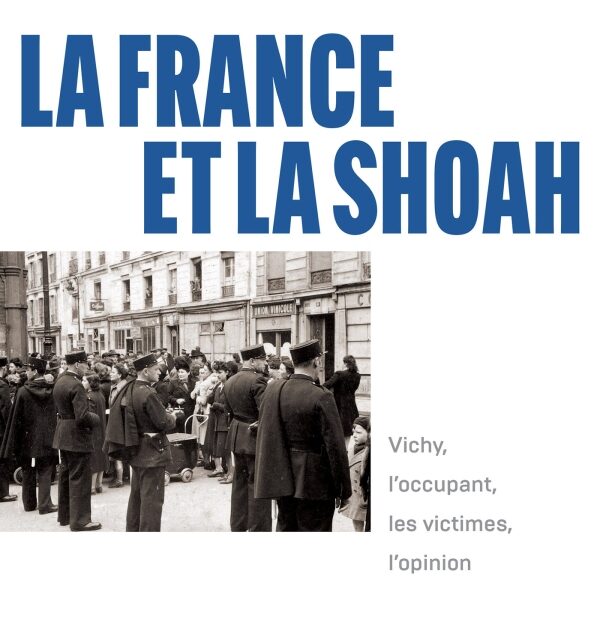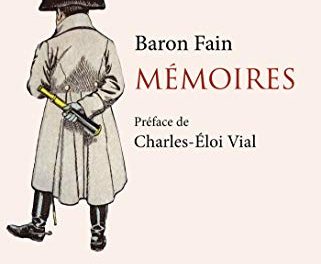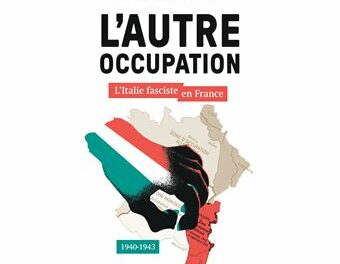« Le maréchal Pétain n’a livré personne. À la dure loi de l’ennemi, il n’a cherché qu’un palliatif » proclame Maître Jacques Isorni devant la Haute Cour de justice en 1945 afin de défendre son client. Toujours d’après l’avocat « c’est seule l’action du gouvernement du Maréchal qui les a (les « Juifs français »), peut-être faiblement, mais protégés quand même ». Deux mois plus tard, devant cette même Haute Cour de justice, Pierre Laval ose clamer « je souhaiterais n’être jugé que par des Juifs français parce que, maintenant qu’ils connaissent les faits, ils se féliciteraient de ma présence au pouvoir et ils me remercieraient de la protection que je leur ai accordée ».
Ces arguments devaient expliquer les « bons chiffres » de la France en termes de bilan de la Solution finale : « seulement » 74 150 déportés et 200 000 non-déportés. Bien sûr, dès les années 1950 et dans les décennies qui vont suivre, les travaux scientifiques sur la persécution des Juifs de Joseph Billig, Léon Poliakov, Robert Paxton, Michaël Marrus ou Serge Klarsfeld vont réduire à néant ces justifications des dirigeants de Vichy à la Libération. Le présent ouvrage, sous la direction de l’historien Laurent JolyDirecteur de recherche au CNRS, il est notamment l’auteur de « Vichy dans la solution finale. Histoire du commissariat général aux Questions juives (1941-1944) » (2006), « Les Collabos. Treize portraits d’après les archives des services secrets de Vichy, des Renseignements Généraux et de l’Épuration » (2011), « Naissance de l’Action française. Maurice Barrès, Charles Maurras et l’extrême droite nationaliste au tournant du XXesiècle » (2015), « L’État contre les juifs » (2018), « La Rafle du Vel d’Hiv » (2022) et « Le Cas Darquier de Pellepoix – Antisémitisme et fascisime français 1934-1944» (2023)., offre une mise au point actualisée prenant en compte les derniers acquis de la recherche française et internationale sur la Shoah en France. Ainsi, au travers d’une quinzaine d’articles, les historiens Tal Bruttmann, Michael Meyer, Renaud Meltz, Renée Poznanski, Jacques Semelin ou encore Daniel Lee nous livrent une analyse centrée sur l’appareil et les politiques de persécution, ses décideurs et ses exécutants, ainsi que sur le rôle de l’opinion et les stratégies mises en place par les victimes.
Chapitre 1 –
- le MbF, c’est-à-dire le commandement militaire en France et l’administration militaire qui lui était subordonnée. Au départ, ses compétences étaient la surveillance policière des Juifs et les questions économiques liées à l’aryanisation.
- l’ambassade d’Allemagne à Paris dirigée par Otto Abetz. Elle devait conseiller l’administration militaire sur les questions politiques et était en charge du contact avec le gouvernement de Vichy. Pour toutes les questions liées aux aspects militaires (c’est-à-dire presque toutes), Abetz devait agir en concertation avec le MbF.
- le délégué du chef de la Sipo et du SD, c’est-à-dire le représentant du RSHA. Il avait initialement assez peu d’influence du fait de l’action du premier commandant militaire en France Joseph Blaskowitz qui ne souhaitait pas que les représentants du RSHA puissent saper l’administration militaire comme ils l’avaient fait en Pologne. Le poste était occupé par Helmut Knochen dont le rôle, au départ, était informatif. Il ne pouvait prendre de mesures de manière autonome (arrestations de Juifs, promulgation d’ordonnances, …).
Michael Mayer dresse ensuite un tableau précis des schémas idéologiques gouvernant leur politique antisémite :
- Pour la Wehrmacht, la préoccupation principale était le maintien de l’ordre. Les mesures antisémites furent prises pour servir cet objectif.
- Pour l’ambassade, l’hostilité aux Juifs constituait un moyen tactique afin de consolider sa propre position à Paris. L’antisémitisme « faisait partie du projet d’entente franco-allemande » et « semblait être le véhicule qui donnait de l’élan à collaboration » (p.47-48). Abetz était conscient que les représentants du RSHA constituaient une force politique bien plus importante que la Wehrmacht, la collaboration fut donc de plus en plus étroite.
- Pour les représentants du RSHA, à partir de 1941, la priorité était de mettre en œuvre la Solution finale dans ses aspects organisationnels, pratiques et matériels.
Pour l’auteur, des intérêts convergents et des différends existaient quant à la question juive. En général, l’administration militaire préconisait plutôt d’appliquer des « mesures antisémites individuelles » (p.58) pour contrôler les Juifs alors que les représentants du RSHA souhaitaient mettre en œuvre avec la plus grande fermeté la « solution finale à la question juive ». L’ambassade oscillait souvent entre ces deux positions mais penchait généralement pour le RSHA.
Enfin, les conflits et contradictions internes à l’appareil d’Etat nazi en France ont influé sur la politique d’occupation. Suite aux attentats contre les synagogues de Paris (octobre 1941), le MbF, apprenant que les services de Knochen avaient mis à disposition des auteurs des attentats (le groupe d’Eugène Deloncle) des explosifs et des camions, demanda à Heydrich la révocation de Knochen. Le chef du RSHA le maintient dans ses fonctions puis, le 9 mars 1942, il nomme un HSSPF, (un chef supérieur des SS et de la police pour le territoire occupé) en la personne de Carl Oberg. Les représentants de Heydrich disposaient ainsi pour la première fois de leurs propres pouvoirs exécutifs et n’étaient plus tenus de les solliciter auprès du MbF. Le HSSPF constituait désormais le « troisième pilier à part entière de la force d’occupation » (Werner Röhr). Il ne restait plus au MbF « que le commandement des troupes allemandes en France, le contrôle de la zone d’occupation ainsi que la surveillance de l’administration français dont relevait notamment l’aryanisation économique » (p.64).
Dans cet article, Michael Mayer démontre brillamment qu’une « des clés essentielles pour comprendre la Solution finale en France réside dans « la synergie (pour partie non intentionnelle) des divers organes allemands d’occupation, une convergence consolidée par les modification institutionnelles intervenues entre l’été 1941 et le printemps 1942 » (p.65-66).
Chapitre 2 –
Tal Bruttmann démontre comment, en à peine trois mois, entre le 10 juillet et le 18 octobre, « l’Etat français a mis en place une politique antisémite, partie intégrante de le Révolution nationale, dont les fondements puisent en grande partie dans l’Action française et les théories de Charles Maurras, et dont certains sympathisants tiennent à l’été 1940 un rôle de premier plan au gouvernement, tel le garde des Sceaux Raphaël Alibert » (p.68). C’est ce dernier qui, le 1er juillet se réjouissait de préparer contre les juifs un texte « aux petits oignons » ! On ne peut oublier Adrien Marquet, Pierre Laval ou Jean Ybarnégaray. Ainsi, très rapidement, l’Etat français débute la construction d’un arsenal législatif destiné à jeter les bases de la Révolution nationale. Sous couvert de xénophobie, ces mesures ciblent les Juifs. Pour Tal Bruttmann, l’acte de naissance, est le décret qui conditionne l’appartenance aux cabinets ministériels au droit du sang (12 juillet). Dans les jours et semaines qui suivent, d’autres textes du même genre seront promulgués. Pour l’auteur, il est probable que la pause faisant suite cette salve de juillet corresponde au début de la réflexion autour de ce projet global, préparé notamment par Adrien Marquet et le ministère de l’Intérieur. Ainsi, l’annulation du décret-loi Marchandeau (30 août) et la loi de déchéance contre ceux qui ont quitté le pays (6 septembre) sont des jalons qui doivent mener au plan global basé sur des mesures progressives et d’ordre général permettant de viser les Juifs afin d’amener l’opinion à les accepter.
La pression et la concurrence de l’occupant allemand vont bouleverser cette stratégie des « petits pas ». Le 7 septembre, les autorités allemandes annoncent que des mesures vont être prises contre les Juifs. Cela fait craindre une mainmise de l’occupant sur l’économie française : la dépossession des biens juifs allant enrichir les Allemands et non l’Etat français ! Débute alors un « cycle d’intensification mutuelle » (Christopher Browning). Le Conseil des ministres, durant le mois de septembre, construit une législation spécifiquement antisémite sur des propositions d’Adrien Marquet et de Marcel Peyrouton (qui travaille sur la possibilité d’expulser les Juifs sur l’île de Madagascar, abrogation du décret Crémieux). Les ministères de la Justice et de l’Intérieur ont ainsi été les moteurs dans cette construction mais il ne faut pas oublier le rôle joué par Laval et Pétain. Tal Bruttmann décrit les tractations au sein du Conseil qui mènent à l’adoption du statut. C’est finalement la ligne antisémite la plus dure qui l’emporte. Cette loi qui acte « que les Juifs, par essence, ne peuvent être membre de la nation française et participer à la vie publique du pays » (p.98-99) est finalement adoptée le 1er octobre 1940 et promulgué le 3. Ce « statut des Juifs » est adressé aux Allemands pour accord et il doit s’appliquer à l’ensemble du territoire. A noter, qu’à cette date le gouvernement français ignore encore le contenu de l’ordonnance allemande du 27 septembre qui n’a pas encore été rendue publique !
Chapitre 3 –
Dans ce chapitre, Michael Mayer s’intéresse à la coopération franco-allemande à propos de la politique antijuive. Pour la France, c’est le système de l’Aufsichtsverwaltung (administration de contrôle) qui est le concept de l’occupation allemande. Le pays possède son propre gouvernement mais la force d’occupation reste néanmoins le supérieur hiérarchique. L’auteur souligne que c’est avec moins de 50 000 personnes que l’administration de contrôle fonctionna en France, ce qui explique sa dépendance à la coopération avec l’administration française ! Les 3 objectifs principaux du MbF sont de maintenir la paix et l’ordre dans le pays, d’assurer la sécurité des troupes d’occupation et d’exploiter la France pour l’économie de guerre, « le reste de la politique d’occupation fut subordonnée à ces objectifs » (p.118). La politique antijuivre paraît nécessaire car les Juifs sont une « menace sur les intérêts de la Wehrmacht ».
Pour l’application des ordonnances visant les Juifs dans le domaine économique, le MbF dépend de l’administration française. Ainsi, cette dernière établira par exemple les « fichiers juifs » et nommera des administrateurs pour les entreprises juives. A noter que des contrôles ponctuels permettront de surveiller le travail des autorités françaises. Pour Michael Mayer, « la coopération franco-allemande dans le domaine de l’aryanisation s’avéra ainsi extrêmement efficace » (p.125).
Le statut des Juifs du 3 octobre 1940 n’éveille pas l’intérêt de l’occupant car le but des ordonnances françaises est de déposséder les Juifs de toute influence politique, militaire, artistique et intellectuelle alors que les allemandes ont pour but de leur enlever toute influence économique. Il paraît donc peu judicieux de peser sur la politique française ! Mais l’influence allemande sur l’administration française se renforce nettement au cours de la guerre. Pour Michael Mayer, c’est donc « la politique antijuive de la deuxième moitié de l’année 1940 ainsi que de l’année 1941 (avec des réserves) qui est la plus à même de témoigner des intentions antisémites françaises » (p.129).
De son côté, l’administration française, sous l’impulsion de l’énergique commissaire général aux questions juives Xavier Vallat, perfectionne et durcit la loi donnant naissance, le 2 juin 1941, au second statut des Juifs. Cela démontre la « nette volonté française de poursuivre une politique antisémite propre à la France » (p.137).
Chapitre 4 –
Bénédicte Vergez-Chaignon interroge la responsabilité de Pétain quant à la « question juive ». L’auteure commence par souligner les 80 ans de quasi-silence du maréchal qui ne se fait remarquer par aucune position publique identifiée au moment de l’affaire Dreyfus, lorsqu’il devient ministre de la Guerre dans le gouvernement d’union nationale, après l’émeute du 6 février 1934 ou lors du Front populaire. A l’approche de la guerre, la réflexion du maréchal est davantage fondée sur « la xénophobie, la méfiance envers des immigrés forcément louches et très probablement subversifs » (p.145). Ainsi, il s’inquiète de l’éventuel afflux en France d’un nombre élevé d' »indésirables » dont de Juifs en déshérence. Afin d’expliquer la défaite, Pétain n’incrimine pas les Juifs mais les Français d’origine étrangère.
Dès les premiers mois de l’Etat français, des lois xénophobes sont proclamées puis le premier statut des Juifs. Ce dernier a été corrigé de la main de Pétain lui-même. Pour Bénédicte Vergez-Chaignon « ce statut est donc le sien : il ne lui a été imposé ni par des ministres manipulateurs, ni par des Allemands impérieux. La crainte d’être dépassé par l’occupant a obligé à forcer l’allure, mais non le trait » (p.149). Son attitude reflète un antisémitisme français traditionnel, non pas militant, mais basé sur des préjugés : l’influence des Juifs davantage préoccupés par leur intérêt personnel que par l’intérêt national, les Juifs étrangers ou fraichement naturalisés forcément suspects et vus comme des parasites ou des agents de la subversion révolutionnaire. Mais, pour Pétain ce statut est incomplet dans ses exclusions, d’où le travail du CGQJ afin de multiplier les lois antisémites puis de produire un second statut.
Au moment des rafles de l’été 1942, Pétain n’est pas « au cœur du processus de décision » (p.154) mais il se fait remarquer par ses silences lors des séances du Conseil des ministres. Il approuve tout de même les « mesures particulières » envisagées contre les Juifs arrivés en France depuis septembre 1939. Suite aux inquiétudes et aux protestations des évêques français, le Maréchal rejette la responsabilité sur l’occupant et fait part au consul allemand à Vichy de sa désapprobation devant cette ingérence ecclésiastique.
Son manque d’empathie, sa xénophobie et son antisémitisme traditionnel, sa vision d’une France purgée de ses éléments néfastes, l’ont donc mené à « accepter l’inacceptable » (p.162). Mais, pour l’auteure, son antisémitisme, à la différence des nazis, ne débouchait pas sur le meurtre.
Chapitre 5 –
Renaud Meltz démontre comment, dès les années 1920, Pierre Laval, cet « antisémite qui s’ignore », n’hésite pas à instrumentaliser l’antisémitisme de la société française au travers d’attaques ponctuelles. Les émeutes du 6 février 1934 et l’ébauche du Front populaire marquent une polarisation de la vie politique française. Son discours devient alors « plus complaisant aux haines du temps » (p.172). S’il n’est pas un idéologue, il prend position et joint sa voix aux préjugés racistes et antisémites. Avec la guerre, Laval devient un acteur central de l’antisémitisme d’Etat en 3 étapes :
- Avec la défaite et ses responsabilités au cœur de l’Etat français son antisémitisme qui accompagne sa « xénophobie décomplexée » (p.174) prend de plus en plus de place dans sa rhétorique et justifie la réforme des institutions. La mise en place d’une politique antisémite en lien avec l’occupant doit alimenter la collaboration mais aussi marquer la survivance d’une souveraineté française.
- Avec son retour aux affaires en avril 1942, son antisémitisme se radicalise et il l’articule « à une conception nationalitaire qui doit réserver la déportation et la mort aux étrangers » (p.177). En plaçant Bousquet à la tête de la Police, il apporte l’aide de la police française aux déportations allemandes en zone occupée.
- Laval, qui répond favorablement aux demandes allemandes en termes d’objectif à atteindre et propose de lui-même, lors de la séance du Conseil des ministres du 26 juin 1942, de livrer les enfants de moins de 16 ans lors des rafles en zone sud. Lors de la séance du 10 juillet, il présente cela comme une mesure humanitaire. Ainsi, il n’a aucun scrupule à devancer les attentes allemandes.
Les rafles de l’été 1942, et notamment celles perpétrées en zone non occupée, illustrent le système de Laval : une logique nationalitaire et de discrimination entre Juifs étrangers et Juifs français afin de répondre aux objectifs. Alors que la situation militaire de l’Allemagne se dégrade, Laval joue la montre, il s’oppose aux dénaturalisations et se montre plus ferme vis-à-vis des demandes allemandes. Il sera s’en vanter lors de son procès.
Chapitre 6 –
Wolfang Seibel se penche sur les effets politiques des protestations religieuses de la part de l’Eglise durant l’année 1942.
Dès 1940, l’Eglise catholique et ses hauts dignitaires sont un des piliers du nouveau régime et les témoignages de sa loyauté sont innombrables. Jusqu’en 1942, l’Eglise est indifférente moralement et politiquement face aux premières lois antisémites, des pans entiers de la hiérarchie ecclésiastique les légitimant même ! Cette position de l’Eglise est grandement influencée par la doctrine du « double protectorat » : la protection de l’individu et ses droits inaliénables tout en consentant à l’Etat le droit de se protéger lui-même contre ses ennemis intérieurs et extérieurs.
L’année 1942 est un tournant, elle est marquée la mise en place de « la solution finale de la question juive » en France, la nomination de Carl Oberg en tant que HSSPF et par le retour de Laval aux affaires. Les intérêts français et allemands convergent et débouchent sur les accords de police Oberg-Bousquet de l’été 1942. Ils actent la collaboration de la police française à l’arrestation et la déportation des Juifs ainsi que la remise de ces derniers aux autorités allemandes. Pour l’auteur, les « digues étaient rompues, Vichy garantissait la mise en œuvre complète et unifiée de l’arrestation des Juifs de nationalité étrangère par la police française » (p.223).
Dans les jours qui suivent la rafle du Vel d’Hiv, les cardinaux et archevêques de la zone occupée rédigent une lettre de protestation adressée à Pétain. Ses effets politiques sont limités. Pour l’auteur, « c’était toutefois la première fois que l’Eglise en tant qu’institution, et pas seulement ses dignitaires à titre personnel, s’adressait directement à Pétain pour blâmer expressément les pratiques de son gouvernement et donc celles d’un régime dont elle était par ailleurs solidaire sur le plan idéologique et politique » (p.227). En zone non occupée, le cardinal Gerlier, archevêque de Lyon, écrivit à Pétain et l’archevêque de Toulouse Monseigneur Saliège adressa à son clergé une lettre pastorale qui fut lue en chaire dans la plupart des paroisses. Les lettres pastorales se multiplièrent alors (Théas pour le diocèse de Montauban, Gerlier pour celui de Lyon ou Delay pour celui de Marseille). Pour l’auteur, elles « avaient cependant ceci de remarquable qu’elles éludaient toute critique à l’encontre de Vichy et qu’elles accompagnaient la protestation d’une empathie politique pour les problèmes que rencontrait supposément le régime de Vichy ainsi que de témoignages de loyauté appuyés » (p.232). Laval et Bousquet lors d’entrevues avec Oberg, Abetz, Knochen ou Hagen évoquèrent cette résistance et rendirent caduc le calendrier fixé par Eichmann. Mais, avec une solide marge de manœuvre, ils continuèrent d’intensifier les mesures de persécution. Presque quotidiennement, les hauts dignitaires signifiaient leur désaccord tout en conservant leur loyauté. A partir de septembre 1942, les autorités allemandes reconnaissent qu’il ne sera plus possible de de mettre en œuvre la « solution finale à la question juive » selon les termes de départ.
Certains dignitaires ecclésiastiques, représentants de l’Eglise, ont donc concouru de manière décisive au ralentissement voire à la neutralisation de la logique de collaboration dans le domaine de la persécution des Juifs.
Chapitre 7 –
Renée Poznanski revient tout d’abord sur l’histoire mêlée de la mémoire et de l’historiographie de l’opinion durant l’après-guerre à partir de « deux cheminements parallèles. Le premier est suivi par les Juifs en France (ex : le CDJC) et l’autre par les non-Juifs (ex : le CH2GM). Pour l’auteure, l’attitude de la population française face aux persécutions bénéficiait « de l’indulgence des premiers et n’était pas même abordée par les seconds » (p.268). L’intégration de l’histoire des Juifs et de la mémoire de leur persécution doit beaucoup au film de Marcel Ophuls Le Chagrin et la Pitié ainsi qu’aux livres La France de Vichy de Robert Paxton et Vichy et les Juifs de Michaël Marrus et Robert Paxton. Ces œuvres dévoilaient la face collaboratrice de la France y compris l’antisémitisme haineux qui sévissait au sein d’une partie non négligeable de la population ainsi que les ressorts de le politique antisémite du gouvernement de Vichy. Ces sujets « sensibles » tombaient alors dans le domaine public. Ils furent précisés lors de travaux ultérieurs. Le discours de Jacques Chirac le 16 juillet 1995, reconnaissant la responsabilité de la France dans le sort des Juifs, instaurait « une dichotomie entre un Etat persécuteur et une société protectrice » (p.271) permettant ainsi de sauvegarder une image positive de l’histoire de France. Par la suite, les travaux de Jacques Semelin témoignèrent, en opposition aux thèses paxtoniennes, d’une protection diffuse (voir épilogue).
Si l' »antisémitisme larvé » (Marc Bloch) qui régnait en France peut expliquer l’acceptation de la législation antisémite, l’auteure souligne une différence géographique importante :
- dans la zone occupée, la législation antisémite passait moins du fait qu’elle était assimilée à l’envahisseur allemand instigateur de cette politique discriminatoire (ex : port de l’étoile jaune).
- en zone sud, la propagande antisémite française apparaissait comme une vérité et avait donc une portée importante.
A partir des journaux, témoignages, lettres ou rapports, Renée Poznanski souligne que l’été 1942 a marqué un tournant car les rafles suscitèrent de nombreuses indignations qui s’étendirent au sud de la ligne de démarcation. Ainsi, le sort des enfants séparés de leurs mères étaient mentionnés partout. Mais, cet acte inhumain ne pouvait être imputé qu’à l’occupant et les rafles étaient le signe d’une soumission. L’historienne revient à son tour sur l’importance des protestations de certains grands dignitaires de l’Eglise catholique.
Chapitre 8 –
Alexandre Doulut analyse lui aussi la réaction de l’opinion face aux rafles de 1942 mais à partir du « contrôle technique », c’est-à-dire les trois moyens de communication que sont le courrier, les télégrammes et les conversations téléphoniques qui donnaient lieu à des synthèses locales (départements, préfectures) et nationales (ministère de l’Intérieur). L’auteur souligne tout l’intérêt de ces archives contrairement aux réserves formulées par Pierre Laborie dans son ouvrage sur l’opinion (paru en 1990). Il ressort que :
- en zone occupée, la population, déjà anti-allemande, fait preuve d’une réelle empathie à partir de la promulgation du port de l’étoile (8 juin 1942).
- en zone libre, durant l’été 1942, une réelle hostilité de la population se développe à l’égard des réfugiés juifs qui affluent et qui provoqueraient une raréfaction et un enchérissement des denrées. On les accuse même d’arrogance. Il faut attendre septembre pour que l’effet des messages des évêques et archevêques se fasse sentir dans les interceptions. C’est dans le rapport du 8 septembre qu’un retournement de l’opinion publique est perceptible.
De manière générale, durant l’année 1942, l’adhésion à la personne de Pétain mais surtout à sa politique commence à fléchir « sans qu’on puisse relier cette brèche aux rafles des Juifs » (p.321). L’étude des synthèses au niveau local confirme que « les persécutions contre les Juifs n’ont finalement été au cœur des préoccupations des Français qu’à une période critique, l’été 1942. Avant et après, elles brillent par leur absence » (p.330).
Chapitre 9 –
Isabelle Backouche, Sarah Gensburger et Eric Le Bourhis mènent un enquête fouillée sur l’opinion des gérants immobiliers face à la dépossession des Juifs de leur logement à Paris. Cette approche par l’histoire sociale invite à mettre en tension pratiques et opinions.
En croisant la persécution des Juifs et le logement à Paris, ils traitent donc de l’opinion socialement et spatialement. La politique de spoliation visant à déposséder les Juifs de leur logement montre « comment s’occuper du sort d’un appartement anciennement occupé par une famille juive disparue relève d’une forme d’accélération, puis de banalisation de l’ostracisme qu’ils subissent » (p.375). L’opinion ou plutôt le point de vue des gérants est éclairée par la connaissance qu’ils ont de la législation et du sort de leurs locataires mais s’inscrit aussi dans la perspective d’action de relouer les appartements au plus vite.
Pour ceux qui refusent de se plier à ces expulsions locatives, les raisons semblent davantage liées à des préoccupations professionnelles (ex : formalisme juridique) qu’à des motivations idéologiques.
Chapitre 10 –
Afin de décrypter l’ordinaire de la persécution, Aurélie Audeval s’intéresse à la catégorie des « indésirables » et à la politique d’internement des étrangers en zone libre jusqu’en 1942.
Depuis le milieu du XIXe siècle, en Europe, aux Etats-Unis ou en Australie, les autorités désignent certaines personnes comme « indésirables ». Bien sûr, ce terme est dénué de définition juridique. Pour l’auteure, on « retrouve cependant un critère récurrent d’indésirabilité : l’origine – sociale, raciale ou politique » (p.382). Ce sont, par exemple, les vagabonds, les anarchistes ou les Juifs. L’émergence du terme coïncide avec le moment historique de la construction des Etats-nations modernes à partir de la constitution des populations nationales.
En France, durant les années 1930, on assiste à une inflation de l’usage du terme. Ceci est à relier au contexte de l’afflux de réfugiés juifs étrangers (vus comme des concurrents sur le marché du travail des professions libérales) en lien avec l’arrivée au pouvoir de Hitler, aux annexions successives ou à la guerre civile espagnole. La pression exercée notamment par les groupements professionnels des médecins, juristes et commerçants se traduit par la mise en place de quotas professionnels, de contrôles aux frontières, de refoulements, d’expulsions, de tracasseries administratives et, avec l’arrivée des Espagnols, de contrôles sanitaires et de rapatriements collectifs.
Les décrets de 1938 instituent l’assignation à résidence et l’internement comme mesures administratives possibles pour ceux que l’on considère dangereux. Cette création de camps d’étrangers ne répond pas à la crise espagnole mais « bien au développement sur dix ans de politiques publiques visant à trouver des solutions toujours plus efficaces afin de se débarrasser de certaines populations » (p.388). Avec l’entrée en guerre, l’armée procède à des internements mais il existe une différence de taille : l’objectif n’est pas le même, il s’agit non pas d’interner pour expulser mais pour immobiliser. En effet, ce ne sont pas les « étrangers indésirables » qui sont visés mais les « ressortissants ennemis ».
Aurélie Audeval analyse ici l’exemple de Marseille. En 1939 et 1940, tous les navires sont contrôlés ce qui débouche sur des arrestations. La présence de femmes et d’enfants et de personnes âgées constitue une contradiction majeure avec les textes règlementaires en vigueur (il faut attendre mai 1940 pour que l’état-major se décide à interner des femmes et à étendre la limite d’âge sur tout le territoire). Les personnes arrêtées sont conduites dans deux camps : le camp des Milles (les hommes) et celui d’Aubagne (puis vers l’hôtel Terminus de Marseille). Avec l’Etat français, l’auteure souligne les ambivalences d’une politique qui oscille entre laisser partir ou retenir. Les « étrangers indésirables » de la Troisième République deviennent avec Vichy des « Juifs étrangers ». A Marseille, la politique d’émigration est le fruit d’un partage des responsabilités entre le Ministère de l’Intérieur (recensement national afin d’évaluer le nombre de candidats au départ) et la préfecture (organisation de l’hébergement). Le camp des Milles ainsi que les hôtels Bompard, Terminus et Le Levant servent de lieu d’internement. Des blocages à cette émigration existent aussi : les délais trop longs, les conditions de l’armistice avec la livraison des ressortissants allemands, la fermeture des frontières des potentiels pays d’accueil et l’entrée en guerre des Etats-Unis. Ainsi, le centre-ville de Marseille devient « un vaste camp de transit » (p.405).
La concentration des compétences de la préfecture en fait un acteur central de cette politique. Le personnel reste relativement stable. A noter la nomination du capitaine de frégate Maurice de Rodellec du Porzic à la tête des services de police de la ville et du département. Avec le développement de la politique antisémite des services spécifiques voient le jour : le « service juif » est mis en place à la préfecture en juin 1941. En 1942, est mise en place, au niveau national et à Marseille, la police aux Questions juives qui sera remplacée par la Section d’enquête et de contrôle. Rodellec du Porzic coopère activement afin de mettre en place l’aryanisation économique, de rechercher d’éventuelles infractions au statut des Juifs ou de lutter contre le marché noir. A partir de l’été 1942, il orchestre aussi les déportations depuis la zone sud. Le camp des Milles devient un lieu de rassemblement des personnes destinées à la déportation.
Chapitre 11 –
Johanna Lehr se penche sur le poids de l’infraction pénale dans le parcours de persécution des Juifs détenus à la Santé et à Fresnes de 1941 à 1944. Cette étude éclaire les effets d’une routine administrative qui a souvent directement menée ces « délinquants » des geôles parisiennes au camp de Drancy puis à la déportation. Ce transfert de la prison au camp a pu s’opérer grâce à la « consignation provisoire » permettant l’internement administratif des populations « indésirables ». Ce mécanisme administratif éclaire sous un jour nouveau la participation du régime de Vichy à la politique de déportation.
A partir de chiffres collectés dans les archives, Johanna Lehr décrit les flux d’entrants qui connaissent une augmentation en 1941, un plateau en 1942 avant de s’amenuiser à partir de 1943. En effet, « la voie judiciaire se faisant plus rare et ne s’accompagnant plus de détention provisoire, les Juifs arrêtés à Paris sont désormais directement amenés au camp de Drancy par les policiers français qui les arrêtent (271 jusqu’à la Libération) » (p.422-423). Sur près de 1350 Juifs détenus dans les deux prisons, 600 ont été déportés dans les convois « raciaux ». Les motifs d’arrestation sont divers : infraction économique, à la carte d’identité ou à l’état civil, violences, outrages, … Pour ces « délinquants », il s’agit bien souvent de leur première expérience carcérale.
Mais, à partir de 1941 et le second statut des Juifs, Vichy soumet désormais au pouvoir d’internement des autorités préfectorales les Juifs de nationalité française, indépendamment de la commission d’une infraction. Vichy se dote de « moyens légaux de réprimer lui-même pénalement et administrativement tous les Juifs sur la totalité du territoire » (p.428).
Si la détention fondée sur infraction a bien ouvert la voie à l’internement des prisonniers juifs, l’auteure montre aussi comment elle a pu paradoxalement avoir un effet protecteur à partir de l’année 1943. Certains Juifs n’hésitent pas à s’accuser de délits imaginaires afin d’être dirigés dans la voie judiciaire et espérant écoper de peines de prison assez longues.
Chapitre 12 –
Roger Arditi s’intéresse ici à l’éviction des Juifs du ministère de l’agriculture.
Une première vague commence avec la loi du 3 octobre 1940 qui interdit aux Juifs d’occuper des emplois publics conférant du pouvoir ou de l’influence. L’article 3 précise quelques exemptions possibles. Les ministères doivent préparer des licenciements. Le secrétaire général adjoint René Huguet demande aux chefs de services les noms des Juifs devant être licenciés et de ceux bénéficiant d’une dérogation. Pour les révoqués (16 au 19 décembre 1940), l’auteure précise que le ministère continue à suivre administrativement les agents touchés et à veiller à leurs intérêts financiers. Le 13 janvier 1941, une émission antisémite de Radio-Paris accuse le ministère de l’Agriculture de réembaucher des fonctionnaires révoqués à des postes d’auxiliaires. Les milieux collaborationnistes soulignent aussi le manque d’ardeur antijuive du ministère. La création du CGQJ précipite l’écriture et la parution d’un second statut des Juifs qui étend le nombre de personnes visées. Aux enquêtes lancées par le CGQJ, Huguet répond en retransmettant les informations récoltées par son service sans grand empressement.
Au final, si Huguet n’a jamais affiché d’antisémitisme particulier et a effectué les remontées avec lenteur, en fonctionnaire consciencieux, il n’a pas hésité à destituer 3 agents qui dépendaient de son autorité directe et n’a jamais exprimé de désaccord avec les demandes de sa hiérarchie. Au total, 21 fonctionnaires ont été exclus et 12 ont été maintenus.
Chapitre 13 –
Daniel Lee, à partir de l’exemple du chantier rural des éclaireurs israélites de France (EIF) à Lautrec (Tarn), analyse la coexistence et ses limites entre le régime de Vichy et la jeunesse juive de France. L’auteur commence par souligner qu’à l’origine Vichy ne chercha pas à exclure les Juifs désireux de contribuer à la renaissance nationale. Le retour à la terre et la vie au grand air sont bien au cœur de la « Révolution nationale ».
A Lautrec, une communauté de scouts juifs devait permettre de vivre en autosuffisance tout en inculquant l’amour de la terre, le sionisme et la spiritualité juive. Plus de 200 « pionniers » y vécurent pendant la guerre ! Malgré des réticences en haut et en bas de la hiérarchie administrative, le soutien de Vichy aux localités agricoles des EIF comme Lautrec demeura. L’auteur précise aussi que si le CGQJ s’intéressa assez peu à la communauté, la Légion française des combattants joua un rôle actif afin de la faire fermer.
L’année 1942 marqua un tournant. Le sauvetage des enfants juifs devint la priorité des chefs des EIF et Lautrec joua un rôle déterminant dans ces opérations de sauvetage. Le chantier rural fut utilisé comme « étape transitoire pour des centaines d’enfants juifs étrangers récemment retirés des camps de Gurs ou de Rivesaltes » (p.509). Mais comme les rafles et les déportations se multiplièrent, héberger des jeunes Juifs devint trop dangereux. Le chantier finit par fermer ses portes en mars 1944.
Cet article démontre la « flexibilité » de Vichy en autorisant les jeunes Juifs français à participer à la révolution nationale ainsi que la laborieuse application de la législation antisémite jusqu’à l’échelon local. Pour l’auteur, « il incomba aux officiels locaux d’interpréter et d’appliquer les nouvelles lois, ce qui fut réalisé de façon inégale en zone non occupée. » (p.511).
Epilogue –
Jacques Semelin propose une approche multifactorielle de la survie ou du sauvetage des Juifs en France. En effet, comment expliquer que « seulement » 25% des Juifs en France ait été déportés (contre 43% pour la Belgique ou 76% pour les Pays-Bas) ?
- la dispersion géographique, d’autant plus que le territoire français est bien plus étendu que celui de la Belgique et des Pays-Bas. En France, pays rural, les Juifs qui peuvent faire preuve de mobilité tendent à se réfugier dans des coins reculés, à la campagne.
- l’attitude des Français qui ne font pas tous preuve d’un antisémitisme virulent. La compassion, l’entraide ou les silences ont parfois été plus forts que la stigmatisation ou la dénonciation. Pour qualifier ces « petits gestes », surtout visibles de 1942 à 1944, l’auteur utilise l’expression de « réactivité sociale ». Bien sûr, cette entraide n’est pas toujours désintéressée !
- le risque encouru pour aider les Juifs qui est « peu, voire pas du tout sanctionné par les polices française et allemande » (p.521).
- l’intégration des « Israélites » en France qui a été le premier pays en Europe à les émanciper. Au XIXe s., ils se sont intégrés et ont crée des réseaux de sociabilité. Cette situation n’est pas la même aux Pays-Bas où les Juifs avaient les mêmes droits mais avaient tendance à vivre entre eux. En France, les Juifs étrangers sont beaucoup plus vulnérables et ils seront la première cible des mesures antisémites.
- les facteurs culturels qui expliquent l’aide apportée aux Juifs à partir de l’été 1942 au moment où la persécution des enfants débute, enfants perçus comme des victimes innocentes de la brutalité du pouvoir.
- le christianisme (voir chapitre 6) et notamment la portée des interventions des évêques et archevêques.
- l’héritage républicain qui peut expliquer le rôle joué par certains instituteurs laïcs et l’accueil dans les internats des lycées comme lieux de refuge.
- l’esprit patriotique qui a poussé certains Français à aider les Juifs non pas parce qu’ils les aimaient mais par hostilité à l’occupant allemand.
- les facteurs structurels comme les conditions de l’armistice (zone libre plus propice à la survie des Juifs), l’existence d’une politique sociale et le maintien d’un Etat français disposant d’une relative autonomie.
- l’évolution des rapports entre Allemands et le gouvernement de Vichy. Ce dernier, la défaite approchant, se montre plus réticent à procéder à des arrestations de masse.
Cet ouvrage, dirigé par Laurent Joly, propose une analyse extrêmement complète et profondément renouvelée de la Shoah en France. Ainsi, à différentes échelles (nationale et locale) et au travers des multiples acteurs, les auteurs démontrent que Vichy a bien eu les moyens « de faire obstacle aux déportations après avoir mis toute la puissance de son administration au service de la politique nazie lors de la terrible année 1942. Dans un premier temps, ce gouvernement a servi de relais efficace aux nazis. Par la suite, il est devenu comme un écran passif, en relayant plus ou moins leurs exigences » (p.535). Le lourd bilan humain résulte donc bien d’un choix politique criminel de la part des dirigeants de l’Etat français et non d’une politique du « moindre mal ». Une somme magistrale et indispensable !
Une présentation vidéo de l’ouvrage :
Conférence virtuelle des Clionautes avec Laurent Joly à propos de son livre sur la rafle du Vel d’Hiv :