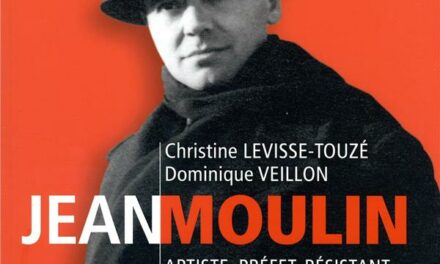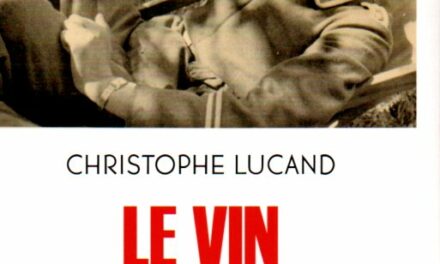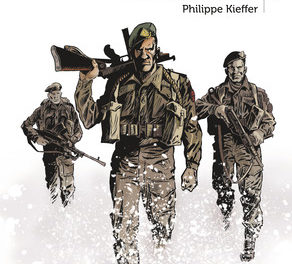Le numéro de mai-juin fait naturellement sa couverture sur l’opération Barbarossa. Quatre articles traitent, comme il se doit, des aspects militaires de l’évolution du conflit. Ils sont dotés d’une riche iconographie ainsi que d’une utile et claire cartographie. Mais ce sont davantage les autres articles, plus inattendus et variés, tout aussi richement illustrés, qui nous ont semblé les plus intéressants.
Envahie par la Wehrmacht le 10 mai 1940, la Belgique capitule après dix jours de combat. Les ministres Hubert Pierlot et Paul-Henri Spaak s’envolent pour Londres, où ils constituent un gouvernement en exil, refusant l’acte de reddition du roi Léopold III. Le 15 novembre, ce gouvernement déclare la guerre à l’Italie ; le Congo belge se rallie, mettant à la disposition des Alliés les ressources de cette immense colonie.
La rubrique « Passeur d’histoire » propose le témoignage de Philippe Brousmich qui combattit les Italiens dans la « Force publique », composée de 18 000 indigènes recrutés par volontariat pour une durée de sept ans. Leurs opérations furent coordonnées avec les Britanniques et eurent pour objectif d’empêcher les Italiens d’Abyssinie de faire leur jonction avec leur armée de Libye. Cette campagne d’Abyssinie a constitué la seule victoire de la Belgique dans la guerre.
François Delpla présente « le Berghof, la maison d’Hitler à Berchtesgaden ». Hitler loue depuis 1927 un chalet, qu’il acquiert en juin 1933 et fait transformer, suivant les plans dessinés par lui-même vers 1935. Eva Braun y séjourne souvent pendant la guerre. Un domaine très vaste est acquis, vidé de ses habitants et clôturé, sous l’autorité de Martin Bormann qui dirige d’importants travaux d’aménagement. La construction la plus célèbre, toujours intacte et toujours en service, est le fameux « nid d’aigle », inauguré dans l’été de 1938 sur le mont Kehlstein, 124 mètres au dessus du Berghof. On y accède par une route en lacets qui conduit à un parking où l’on prend un ascenseur grimpant 80 mètres à travers la roche. Fait pour impressionner les visiteurs, devenu aujourd’hui restaurant panoramique, ce local a assez peu servi à Hitler. L’auteur décrit la vie quotidienne au Berghof et évoque les réunions sur la terrasse filmées par Eva Braun.
Thomas Rabino propose un article intitulé « Variétés, musique et chansons en guerre ». Durant la « drôle de guerre », le grand public est friand de chansons aux « thèmes patriotards » : « On ira pendre notre linge sur la ligne Siegfried » ! Avec l’occupation, certains artistes gagnent Londres ou les États-Unis (Paul Misraki), ou plus simplement la zone Sud (Mireille). Beaucoup se complaisent dans l’idéologie maréchaliste, vichyste, voire, plus rarement, pro allemande, et ne répugnent pas à chanter devant des auditoires allemands ou au micro de Radio Paris (Rina Ketty, Lucienne Boyer, Maurice Chevalier). Charles Trenet, Edith Piaf et Maurice Chevalier chantent en Allemagne devant les prisonniers ou les requis du STO.
Rares sont les résistants actifs et Joséphine Baker, gaulliste convaincue et agent de renseignement fait figure d’exception. Jean Nohain devient résistant sous l’influence d’André Giraud, fondateur du réseau Carte. Avec son frère Claude Dauphin, il gagne Londres et s’engage dans les FFL. Londres, où Maurice Druon et Joseph Kessel composent « Le chant des partisans », à l’été 1943. « Outil de mobilisation, d’éducation, de contrôle des masses, de propagande ou de rassemblement, la chanson des années noires fut, pour son versant « autorisé » le plus populaire, peu victime de l’épuration, très compréhensive à l’égard des artistes ».
Nicolas Anderbegani signe un article intitulé « Les SS au Tibet », « Á la recherche des Aryens perdus ». En 1935, Himmler, Herman Wirth, historien germano-néerlandais des religions et des symboles, et Walther Darré, l’un des principaux théoriciens du nazisme, fondent l’Ahnenerbe, « l’héritage ancestral ». C’est un centre de recherche pluridisciplinaire, à la tête duquel Walther Wust, spécialiste des religions de l’Inde, succède à Wirth. Il compte une cinquantaine de départements dont les plus importants sont ceux de linguistique, d’archéologie et d’anthropologie raciale. Cette institution doit apporter un socle scientifique et historique à la doctrine nazie : trouver des preuves archéologiques, anthropologiques et culturelles du fait que les « Aryens » sont les ancêtres des « Germains ».
L’Ahnenerbe décide de monter une grande expédition vers le Tibet, dont la direction est confiée à Ernst Schöfer, membre du parti nazi et de la SS, mais affirme l’auteur « scientifique avant tout ». Quatre SS l’accompagnent. Partis de Calcutta en mai 1938 avec le soutien du vice-roi des Indes, ils arrivèrent à Lhassa en janvier 1939 et ne furent de retour en Allemagne qu’en août. « Incontestablement, l’expédition SS fut un succès remarquable en ce qui concerne l’étude et la connaissance du monde tibétain. L’équipe SS ramena avec elle 18 000 mètres de film (…), 20 000 photos en noir et blanc et 2000 photos couleur (…), des relevés géologiques (…) L’expédition peut être également considérée comme un succès diplomatique du Reich (…) Toutefois cette expédition ne peut être exemptée de ses finalités propagandistes et surtout de son contenu idéologique. »
En effet Bruno Beger a fait de nombreux relevés anthropométriques qui cherchent à intégrer les populations tibétaines dans la hiérarchie raciale et à leur chercher une parenté aryenne. En tant que spécialiste de mesures anthropométriques, Beger sélectionnera 115 déportés à Auschwitz qui seront gazés au camp du Struthof avant d’être mis à la disposition de Hirt, directeur de l’Institut d’anatomie de l’université de Strasbourg, qui cherchait à constituer une collection de crânes juifs. Schäfer travaillera en 1943 à la sélection de semences rapportées du Tibet, pour les adapter au climat continental européen afin de préparer la colonisation future de la Russie. « Croisement d’une grande aventure scientifique et d’une mission fanatique dont les protagonistes ont été tout à la fois la caution savante et les instruments, la SS-Tibet-Expedition démontre à quel point l’idéologie nazie, totalitaire par essence, a pénétré et gangrené les milieux universitaires allemands. »
François Delpla consacre un second article à faire le point sur « Le vol de Rudolph Hess ». Le 10 mai 1941 à 17h 45, Rudolf Hess, le numéro 3 du régime après Hitler et Göring, s’envole d’Allemagne seul aux commandes d’un Messerschmitt. Peu avant 22 h, il saute en parachute au-dessus de l’Écosse et est immédiatement interné par les autorités britanniques. Hitler le fera passer pour un malade mental ayant agi seul. Transféré à Nuremberg en 1945, il sera condamné à la détention à perpétuité et se suicidera dans sa cellule de la prison de Spandau en 1987, à 93 ans et après 46 années de détention.
Sans encore pouvoir répondre à toutes les questions que pose ce curieux événement, François Delpla affirme cependant que « la présentation de ce voyage comme une initiative personnelle, à l’insu de tout autre dirigeant allemand, est invraisemblable » et que « tout plaide pour une entente préalable entre ces deux vieux complices » que sont Hitler et Hess. Il se serait agi d’une mission visant à prendre contact avec les autorités britanniques afin de leur proposer encore une fois, un mois avant d’attaquer l’URSS, une paix aux conditions avantageuses qui permette à Hitler de ne pas devoir se battre simultanément contre l’URSS et contre le Royaume-Uni. Rudolf Hess avait l’intention de se rendre chez le duc de Hamilton qui avait été avant guerre un chaud partisan d’une entente entre l’Allemagne et la Grande Bretagne et qui avait noué des liens en Allemagne avec l’entourage de Hess. Il n’avait pas l’intention de sauter en parachute, mais de poser son gros avion sur un terrain d’atterrissage situé seulement trente kilomètres au nord du château de Hamilton, terrain qu’il n’a pas trouvé. Il pensait sans doute pouvoir rencontrer des partisans d’une paix avec l’Allemagne qui auraient évincé Churchill.
« Les quelques données disponibles suffisent à prouver que les services secrets britanniques avaient embauché le duc de Hamilton pour intoxiquer l’ennemi sur l’existence d’un parti anglais de la paix, prêt à renverser Churchill ». Le Royaume-Uni pensait éviter ainsi des attaques allemandes dévastatrices dans ses possessions méditerranéennes. « En dépit des limites actuelles de la documentation, il est possible de rompre avec les visions du vol de Hess colportées pendant des décennies. Il n’était ni un dirigeant plus ou moins disgracié qui souhaitait recouvrer son rang, ni un déséquilibré prenant ses désirs pour des réalités, et pas davantage un gentil pacifiste. Il était le représentant d’un régime aux abois, qui doutait à juste titre de l’issue d’une guerre très bien partie, parce que la Grande Bretagne refusait de s’incliner, et qui tentait frénétiquement de faire tomber son opiniâtre Premier ministre avant de passer au point suivant, et final, de ses conquêtes. »
Quatre articles sont consacrés aux événements militaires du printemps 1941. Le principal est consacré par Nicolas Bernard à l’opération Barbarossa d’invasion de l’URSS. Les moyens mis en œuvre sont énormes, 153 divisions, trois millions de soldats, 3500 chars et 3000 avions. La Blitzkrieg se déchaîne sur trois axes : au nord vers Leningrad, au centre vers Moscou, au sud vers Kiev et l’Ukraine. L’Armée rouge est submergée et Staline complètement effondré. Il ne s’adresse à son peuple que le 3 juillet ; il fait appel aux valeurs de la « Sainte Russie », à la guerre des partisans et préconise la politique de la terre brûlée et le déménagement vers l’Est des infrastructures industrielles. A l’automne, Leningrad est encerclée, Kiev est prise, trois millions de soldats sont morts ou prisonniers, mais Moscou n’est pas prise. L’objectif d’en finir avec la Russie en huit semaines n’est pas atteint.
Yannis Kadaré propose un article consacré à l’invasion de la Crète par les parachutistes allemands : « Une désastreuse victoire ». L’opération « Merkur » s’achève en effet par une victoire allemande en mai 1941, mais les troupes aéroportées ont subi des pertes énormes. Pour les Britanniques, c’est un désastre, sur le plan humain, matériel et stratégique.
Yann Mahé présente « la rébellion irakienne de 1941 ». Le 3 avril 1941, l’ancien Premier ministre irakien Rachid Ali, pourtant évincé par les Britanniques en janvier, revient aux affaires à Bagdad. Churchill décide d’intervenir car Rachid Ali est un pro allemand déterminé. Hitler entame des pourparlers avec Darlan qui aboutiront à la signature des Protocoles de Paris, accord qui met à disposition du Reich des ports et des aérodromes syriens devant permettre d’acheminer de l’aide aux Irakiens. Le 23 mai, l’Italie entre dans le conflit. Début juin, l’Irak tout entier est repassé sous le contrôle des Britanniques. « Obnubilé par l’invasion imminente de l’URSS, Hitler n’a pas su saisir cette occasion de s’emparer des riches puits de pétrole irakien et de conforter solidement la position de l’Allemagne au Moyen Orient« .
Xavier Tracol s’intéresse pour sa part au développement de la Bataille de l’Atlantique : « Guerre à outrance contre le commerce britannique ». Avant d’attaquer l’URSS, la Kriegsmarine est chargée d’asphyxier économiquement le Royaume-Uni en s’en prenant à sa flotte de commerce. Elle n’y parviendra pas, en partie parce que les Britanniques ont réussi à décrypter les communications radio de la Marine ennemie au printemps 1943.
© Joël Drogland