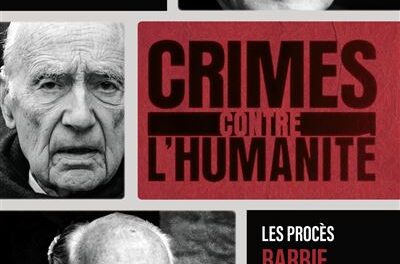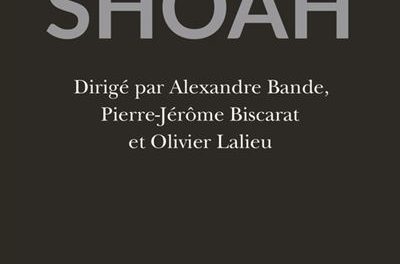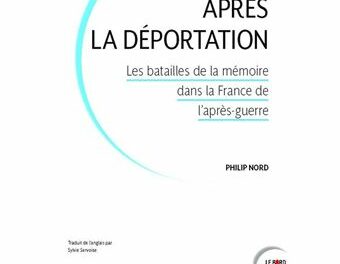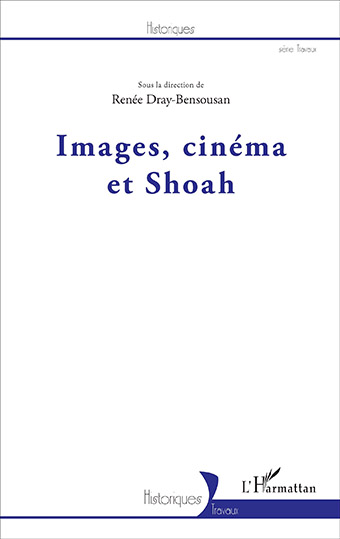
Introduction
Penser les rapports de l’image fixe ou mobile et de la vérité dans la représentation de la Shoah. Renée Dray-Bensousan
Première Partie : Images fixes ou mobiles
Chapitre 1 : Images mobiles
. La perception des Juifs dans le cinéma français d’avant-guerre, Jérôme Bimbenet
. Le cinéma à Marseille pendant l’Occupation, Renée Dray-BensousanChapitre 2 : Images fixes et images mentales
. La bande dessinée et la Shoah : l’iconotexte au srvice de l’indicible, Sylvie Dardaillon et Christophe Meunier
. Les peintures murales des Milles sont-elles une réplique d’une BD de K. Bodek à Gurs ? , Anglika Gaussmann
Deuxième partie : Images et Vérité
Chapitre 1 : Des archives à la fiction, la vérité en questions
. De l’usage de la notion d’authenticité au cinéma : le cas de la réalisation et de la réception de « Shoah », Rèmy Besson
. « Holocauste » : la shoah entre fiction hollywoodienne et histoire, Claude Loufrani
. Hollywodd et la Shoah, Jérôme Bimbenet
. Quand le Manga parle de la Shoah. « L’histoire des 3 Adolf » d’Osamu Tezuka, Sylvie Dardaillon et Christophe Meunier
Chapitre 2 : Quête de vérité par l’image
. « Le Juif Süss » : une falsification et un détournement, Claude Loufrani
. Théâtre documentaire et génocide : entre éclairage de la réalité et subjectivités partagées, Claire Audhuy
. La Shoah dans les manuels solaires, Bertrand Lécureur
Chapitre 3 : Recherche de l’image/vérité dans la création littéraire
. De l’écriture au tableau : la vérité du corps du détenu, Lucie Bertrand-Luthereau
. Artistes contemporains et « esthétique du retrait », Jérôme Moreno
. Le petit fantôme d’Auschwitz, Willy Paillé
Conclusion : Le cinéma change t-il la perception de la Shoah ?
. La survivance de l’image déportée dans « Kamp » de la compagnie Hôtel modern, Virginie Vincent.
. Le cinéma allemand d’avant-guerre annonça-t-il la catastrophe ?, Renée Dray-Bensousan
Troisième partie Témoignages d’artistes et d’enseignants
. L’écrivain témoin, Anika Thor
. L’album d’Auschwitz, Judith Martin-Razi
. Enseigner le film au collège. Le document fiction en histoire : le procès de Klaus Barbie, Laurie Corso
Introduction
Quels sont l’intérêt et le rôle des images dans la représentation du Génocide ? La question centrale demeure : l’image (cinéma, BD, littérature) peut-elle rendre la « Vérité » du meurtre de masse ? Et, en l’occurrence, qu’en est-il de la « Vérité »?
L’image constitue-t-elle une preuve évidente ou bien n’est-elle qu’une interprétation ? Le débat existe certainement depuis les premiers films montrant la libération des camps. A titre d’exemples les « reconstitutions » concernant Auschwitz ou Mauthausen. Ainsi, «image-vérité» ou «image-écran», désincarnée ? L’image en soi est une production artistique, un choix. Le cinéma pose la question de la représentation de la Shoah tout en reflétant l’évolution des approches du génocide Michel Jacquet, Travelling sur les Années noires, éditions Alvik, 2004 . Dans le cas français, Le Chagrin et la Pitié (Marcel Ophüls, 1971) mais aussi Monsieur Klein (Joseph Losey, 1976) constituent une rupture. Le cinéma est très rapidement confronté à cette question cruciale : peut-on représenter, « reconstituer » l’extermination ? Question à laquelle Claude Lanzmann apportera la réponse que l’on connaît. Alain Resnais avec Nuit et Brouillard avait apporté une pierre, importante, à l’édifice, avec toutes les réserves que l’on peut émettre Entre autres le fait que le film présente l’horreur du système concentrationnaire nazi dans son ensemble et n’accorde aucune place à la spécificité de la Shoah et censure (dans version originelle) la participation de la France à celle-ci. En cela, il témoigne d’une époque. . Si aux Etats-Unis de nombreux films ont évoqué le nazisme (Le Dictateur, To be or not to be…), il faut attendre le feuilleton Holocauste (1977) pour que soit évoquée la Shoah de façon directe et auquel sera reproché son approche trop « fictive », jouant plus sur l’émotion que sur la compréhension. En réalité dès 1945 des images des camps, filmées par les cameramen attachés aux armées, ont été diffusées Le producteur britannique Sidney Bernstein entame à partir de ces images (essentiellement filmées à Bergen-Belsen), et avec la contribution d’Alfred Hitchcock pour le montage, un véritable documentaire (Mémoire meurtrie) qui reste inédit jusqu’en 1985. Il revient à Alfred Singer de redonner vie à ce film, diffué sur Arte en janvier 2015. .
Le problème pour la fiction semble insurmontable : s’agit-il de montrer, d’évoquer ou de recréer ? En 1947, La dernière étape de Wanda Jakuboswka (rescapée d’Auschwitz-Birkenau) est le premier film dont l’action se situe à Auschwitz avec d’autres survivantes dans leur propre « rôle » mais il insiste sur le calvaire polonais et est teinté d’idéologie communiste. De fait, rapidement, la visualisation de la Shoah a été considérée comme impossible. Jacques Rivette a fait part de son ulcération à propos du film Kapo de Gillo Ponteconvro (1961) en soulignant l’aspect abject de l’esthétisation et ses relents pornographiques. Accusations auxquelles s’associera d’ailleurs Primo Levi. En France les œuvres cinématographiques n’évoquent la Shoah que de façon allusive Le producteur britannique Sidney Bernstein entame à partir de ces images (essentiellement filmées à Bergen-Belsen), et avec la contribution d’Alfred Hitchcock pour le montage, un véritable documentaire (Mémoire meurtrie) qui reste inédit jusqu’en 1985. Il revient à Alfred Singer de redonner vie à ce film, diffué sur Arte en janvier 2015.. La rupture totale survient en 1985 avec Claude Lanzmann et son œuvre monumentale, Shoah, où l’auteur, dans ses choix, prétend à l’impossibilité de « montrer ». Pourquoi ? Parce que les images n’existent pas. Ce qui est exact si l’on se restreint à la réalité d’une chambre à gaz vue de l’intérieur. De fait, Claude Lanzmann, par son imprécation, rend difficile toute autre forme d’approche. Et, on l’aura compris, la controverse va rebondir avec La Liste de Schindler de Steven Spielberg (1993) qui, avec les moyens hollywoodiens, tente une représentation directe de la vie dans les ghettos et les camps. L’illusion créée est saisissante et le film conserve par ailleurs une certaine retenue si ce n’est la scène sur-dramatisée de la « douche ». Pour Lanzmann c’en est trop et il déclare que Spielberg a osé dépasser « la limite à ne pas franchir parce qu’un certain absolu d’horreur est intransmissible : prétendre le faire c’est se rendre coupable de la transgression la plus grave. La fiction est une transgression, je pense profondément qu’il y a un interdit de la représentation… » (p. 11). L’argument est tout à fait recevable mais la position dogmatique de Claude Lanzmann quant à l’impossibilité de l’image peut sembler excessive Il n’est pas sans intérêt de rappeler que lors de sa sortie Simone Veil avait défendu le film ainsi que de nombreux autres survivants. D’un point de vue pédagogique l’utilisation de La Liste de Schindler pose problème de par sa « trivialisation » de la Shoah. Cependant, comme le rappelait Annette Wieviorka, le film a au moins le mérite de sensibiliser et d’ouvrir le débat. Quant à utiliser Shoah de Claude Lanzmann (540 mn) cela relève de la mission impossible, ce qui n’enlève en rien la puissance de l’œuvre.. En outre, la volonté affirmée de vouloir s’en tenir à une histoire orale, donc, a priori dénuée de toute subjectivité ou d’intervention incongrue de la fiction, n’enlève en rien des choix de « montage » qui, eux, sont soumis à des chois historiographiques, artistiques et philosophiques.
En-dehors des fictions il faut également accorder une place particulière aux très nombreux documentaires qui traitent de la Shoah depuis les années 80 et qui ont un impact tout particulier sur notre « imaginaire des camps ».
Image fixes et images mobiles
images mobiles
La perception des Juifs dans le cinéma français d’avant-guerre Jérôme Bimbenet, IHTP
Un film correspond à l’état d’une société, répond à une attente inconsciente et les images reçues s’immiscent dans cet « horizon d’attente Marc Ferro, « Le film, une contre-analyse de la société », Cinéma et histoire, Gallimard, 1993 » . Le cinéma français n’échappe pas à la règle et décline dans les années 30 des clichés xénophobes et antisémites. Il n’y a pas de films ouvertement antisémites mais le cinéma français est coloré par l’imaginaire antisémite. Or, progressivement, l’image du Juif disparaît des écrans parallèlement à la montée des dangers. Néanmoins les films populaires français de l’entre-deux guerres reflètent la puissance des thèmes de droite et d’extrême-droite, si l’on excepte la parenthèse du Front populaire et son cinéma « engagé ». Aussi trouve-t-on dans la production d’époque les thèmes de la décadence, de la corruption, des relents maurrassiens, le nationalisme, la stigmatisation des « métèques ». Le cinéma montre alors à voir des stéréotypes (la figure du « Juif », l’imagerie coloniale…) qui révèlent un état d’esprit, un « air du temps » et non une adhésion idéologique. A partir de 1935-1936, et les dates sont importantes, « le cinéma français […] donne l’impression d’éviter de présenter un Juif comme tel Rémy Pithon, « Le Juif à l’écran en France vers la fin des années trente », Vingtième siècle, Revue d’Histoire, n° 18, avril-juin 1988 » . De nombreux films sont toutefois teintés par une xénophobie latente. Cela correspond aussi à une crainte du milieu du cinéma qui se sent menacé par une « invasion » étrangère, russe notamment.
Alors que l’antisémitisme prospère en Europe le cinéma français semble gommer l’image du Juif. Est-ce dû à la présence de nombreux juifs dans le monde du 7e Art ? C’est en tout cas ce que semble signifier la fronde interne qui traverse le cinéma français dès 1933 mais qui prend l’aspect d’une réaction plus corporatiste qu’idéologique et qui dénonce pêle-mêle les Juifs, les étrangers, les exilés, les immigrants sous le terme générique, alors très en vogue, de « cosmopolitisme ». Marcel l’Herbier dénonce un cinéma « judéo-bolchevique » aux mains des « métèques » et Fernandel devient beaucoup moins drôle et sympathique lorsqu’il déclare : « Que l’on débarrasse l’industrie du cinéma des étrangers ». Toutefois il ne faut pas se méprendre et céder à l’erreur anachronique car « chez certains, l’antisémitisme relève davantage d’un conformisme idéologique que d’une véritable conviction Alain Weber, La Bataille du film, 1933-1945. Le cinéma français entre allégeance et résistance, Ramsey, 2007. » . Le décret du 23 avril 1933 stipulant que le quota des étrangers dans la profession ne devait pas dépasser 50 % est jugé comme défavorable aux Français et alimente un climat nauséabond, d’autant plus que nombre de producteurs sont juifs. Or deux images du « Juif » se dégagent. L’une peut paraître suspecte mais est dépourvue de réelle volonté de nuire : le Juif est l’équivalent du Marseillais du Vieux-Port, les blagues juives sont les blagues belges actuelles Jean-Pierre Jeancolas, Le cinéma des Français, quinze ans d’années trente, Nouveau Monde, 2005. Ici on se trouve plutôt dans le domaine de la caricature outrancière et de nombreux films relèvent de ce genre (l’histoire de la famille Lévy par exemple, déclinée en plusieurs productions) et proposent à voir des personnages ridicules et vulgaires incitant à un « antisémitisme rigolard ». Il faut savoir que souvent ces films sont réalisés et produits par des Juifs, comme s’il s’agissait de se presser de rire de soi avant que d’autres ne s’en chargent, de façon moins « bonhommeFrançois Garçon, De Blum à Pétain, Le Cerf, 1984 » .
La seconde image présentée du « Juif » est plus nettement antisémite. Le vecteur essentiel de cet antisémitisme est fondé sur l’association « juif-argent » et reprend des images héritées du Moyen-âge : le « Juif » est inquiétant, sournois, obséquieux, obsédé par l’argent et il est usurier, banquier, tailleur… Ces stéréotypes structurent l’univers mental des spectateurs des années 30. Toutefois, l’amalgame des nationalités représentées nous laissent plutôt entrevoir une xénophobie générale qu’un antisémitisme ciblé et relaie en cela la prégnance d’un état d’esprit colonialiste, réactionnaire, « droitier » que prouve le succès de certains journaux (« Je Suis Partout », « Gringoire », « Candide »…). Juif ou pas, peu importe, la cible est le « métèque ». Cependant le Juif, ou supposé tel, est le « sur-métèque » (et il n’y a alors qu’un pas vers l’« untermensch »…) : par définition il reste l’Autre, le « Juif errant De nombreux films participent à ce processus sans que l’on puisse taxer leurs auteurs et leurs intentions d’antisémites. Ainsi Abel Gance avec « La fin du monde » et « La Dame aux camélias », Pierre Colombier avec « Ces messieurs de la santé » ou encore « L’Argent » de Pierre Billon.» . A ce titre le destin de l’acteur Harry Baur est édifiant. Celui-ci, non juif, a campé pour le cinéma des années 30 de nombreux rôles de juifs et son talent d’acteur persuade les Allemands de sa judéité Harry Baur a notamment joué dans « David Golder » et « Le Golem » de Julien Duvivier ou encore « Le Juif polonais » de Jean Kemm et « Rothschild » de de Gastyne. . Ayant accepté d’aller travailler en Allemagne il est traité de « collabo » tandis que Goebbels donne l’ordre de l’arrêter ! Emprisonné, torturé puis libéré, il meurt en 1943. Enfin, le cas de Marcel Pagnol est également intéressant. S’il n’est pas question de taxer l’auteur de « La Gloire de mon père » d’antisémitisme, force est de constater qu’à travers ses films l’affirmation des valeurs de la France rurale, parfois opposées au « parisianisme cosmopolite » (« Le Schpountz »), dégage un certain « maréchalisme » (« La Fille du puisatier ») et l’on ne peut s’empêcher de faire ce parallèle:

On l’a vu la figure du « Juif » tend à disparaître au fur et à mesure de la montée des dangers, à l’exception de deux chefs-d’œuvre de Jean Renoir : « La grande illusion » et « La règle du jeu ».
– L’image du Juif dans « La grande illusion » et « La règle du jeu »
Dans ces deux films Marcel Dalio tient le rôle du Juif. Juif lui-même, sa physionomie est, quelque soit le rôle interprété, associée à celle du « métèque ». L’acteur a d’ailleurs joué sur cette image jusqu’à la fin de sa carrière (« Les aventures de Rabbi Jacob »). Jean Renoir reprend en toute conscience les clichés véhiculés par l’acteur afin de les combattre. Ainsi dans « La grande illusion » Marcel Dalio est Rosenthal –Ferdinand Céline, Bagatelles pour un massacre. Le livre de Céline et le film de Renoir sont tous les deux de…1937, riche, fils de banquier mais sympathique, généreux, courageux et exemplaire pour ses camarades de détention. La volonté d’inversion de sens de Jean Renoir n’est certainement pas saisie par l’ensemble des spectateurs. Un au moins, et non des moindres, a tout à fait compris : « Forte de ses succès politiques, la propagande juive débusque ses batteries […] pas abject du tout ce petit Rosenthal » . Ces propos sont, de fait, un voyage au bout de la nuit. De la nuit et du brouillard. La nuit d’Elie Wiesel… Céline se fait l’écho d’une crainte répandue : rendre le « Juif » sympathique. Or les intentions pacifistes du film, autre reflet de l’époque, vont reléguer la figure du Juif au second plan. Dans « La règle du jeu » le propos n’est plus aussi clair et le film semble renvoyer les Français, après les Accords de Munich, à eux-mêmes « égoïstes et individualistes, prisonniers des apparences, enclins à la dénégation et à la fuite des réalités ainsi qu’à l’antisémitisme, lâches ou impuissants Francis Vanoye, La Règle du jeu, Jean Renoir, étude critique, Nathan, 1995. » . Inacceptable moralement dans la France d’avant-guerre (le personnage juif du film traçant la route de la décadence), victime des attaques de Bardèche et Brasillach, l’œuvre de Renoir est un échec.
Le cinéma comme sujet d’histoire impose donc de ne pas commettre l’erreur fatale, celle de l’anachronisme. Analyser le cinéma français d’avant-guerre ne peut se faire à travers le prisme de la Shoah. Certains films peuvent à nos yeux de contemporains paraitre choquants alors qu’ils ont été réalisés « sans intention de nuire ». La Shoah a modifié les codes moraux mais ceux-ci ne sont pas adaptables à un antisémitisme latent qui participait alors d’une culture populaire (ce qui ne suppose point de l’absoudre) et non d’une idéologie génocidaire. Entre 1940 et 1944 le cinéma français ne produit aucun film antisémite, à l’exception de quelques courts-métrages de propagande. Certes les productions allemandes (« Le Juif Süss », Veil Harlan, 1940 ou « Le Péril juif », Fritz Hippler, 1942) connaissent un succès certain mais le comportement des Français, dans leur majorité, prouve, face à la réalité, une certaine imperméabilité à cette propagande.
« Le cinéma expose la trame mentale de son époque et il a saisi le climat délétère, la crise, le pacifisme, la quête des racines, la xénophobie et cet antisémitisme « bonasse » et vague qui ont peut-être contribué à l’attentisme de l’an quarante mais certainement pas à une complicité dans la Shoah (….) » (p. 29).
Le cinéma à Marseille pendant l’Occupation Renée Dray-Bensousan, AMU
2 septembre 1939 : le cinéma est paralysé. Artistes, techniciens, spectateurs potentiels sont mobilisés et la fréquentation des salles est en baisse. Cette situation est aggravée par la censure (films pacifistes ou immoraux sont visés). Le Service Cinématographique des Armées (SCA) reprend son activité en utilisant des gens comme Jean Renoir par exemple. 14 juin 1940 : parmi les troupes allemandes qui entrent dans Paris se trouve le Dr Dietrich, chef de la section de propagande et chargé de la cinématographie française. Dans un premier temps le public français boude les œuvres importées du Reich.
Le sujet du cinéma sous l’Occupation dérange (l’évidente compromission de certaines vedettes avec l’occupant par exemple) et demeure compliqué car les sources sont rares ou difficiles d’accès En ce qui concerne la Shoah le principal centre d’archives audiovisuelles est constitué par l’Institut Fritz Bauer de Francfort. Fritz Bauer était un procureur qui joua un rôle important dans le procès de Francfort et la traque d’Eichmann. Le film « Le Labyrinthe du silence (2014) retrace son parcours.. De nombreux réalisateurs et acteurs français se sont exilés, aux Etats-Unis en particulier (Jean Renoir, René Clair, Max Ophüls, Julien Duvivier, Jean Gabin, Michèle Morgan…). En France seuls les studios de la zone libre fonctionnent (Studios de la Victorine à Nice et Studios Marcel Pagnol) mais de nouveaux noms apparaissent (Robert Bresson, Jacques Becker, Henri-Georges Clouzot) et la profession reste active. Si il convient de ne pas tomber dans une catégorisation simpliste (« résistants » / « collabos ») néanmoins des réalités ne peuvent être occultées : les milliers de spectateurs qui assistent à la projection du film « Le Juif Süss » ; les propos de Sacha Guitry en 1941 (« Je suis aryen cent pour cent ») ; le voyage à Berlin des acteurs et actrices français en mars 1942. Cependant, selon Jacques Siclier, critique de cinéma, « on ne peut pas comprendre ce que fut le « cinéma de France » entre 1940 et 1944 si l’on ne tient pas compte de la psychologie des spectateurs (on pourrait y associer acteurs et réalisateurs) d’alors. La France continuait. Il fallait vivre, il fallait survivre (…) ». La vie continue et « the show must go on »… Dans l’ensemble les productions germaniques sont volontairement ignorées par les Français à l’exception notable de quelques films qui connaissent un fort succès : « Le Maître de poste » (1940), « La ville dorée » (1942), « Les Aventures du baron de Münchhausen » (1943).
En 1940 est créée la Continentale Films, société de production française fonctionnant avec des capitaux allemands et dirigée par Alfred Greven, un Allemand francophile. Le marché est clair : soit le cinéma français travaille pour la Continentale, soit il disparaît ! Les films réalisés visent non à l’endoctrinement (refusé par Greven) mais plutôt à l’endormissement des consciences et la propagande se fait pernicieuse et non outrancière. Cette propagande n’ « idéologise » pas le cinéma mais offre à voir des vérités considérées comme acquises et indiscutables (le travail, la famille, la patrie, la terre). Seuls deux ou trois films, dont « L’Inconnu dans la maison » (1942) d’Henri Decoin avec Raimu, sont ouvertement vichystes. De façon générale la propagande incessante de la presse ou de Radio-Paris n’est pas reprise par le 7e Art. Il s’agit de vendre du rêve. Qu’en est-il de ce « rêve » à Marseille ?
Des mémoires, les Fonds Albert Kahn et les archives départementales permettent de se faire une idée du cinéma à Marseille, qui se donne des airs d’ « Hollywood méditerranéen » (Studios Pagnol), à cette époque. On le sait, dès qu’il s’agit de Marseille tout devient particulier, original et le cinéma, dans la cité phocéenne, n’échappe pas à la règle. Les salles de cinéma marseillaises, conçues dans les années Trente, sont nombreuses, grandes et luxueuses. Curieusement « La France des années noires » est une période intense pour le cinéma français : environ 220 films sont produits et Marseille constitue un centre cinématographique important. Sur les bords de la Méditerranée c’est la grande période « Pagnol-Fernandel ». Marcel Pagnol a créé ses propres studios situés dans le voisinage du Prado. « Pendant toute l’Occupation, tous les plus grands réalisateurs et les plus grands comédiens s’y retrouveront. Les Services photographiques de l’armée y trouvent refuge » (p. 38). Fernandel est l’acteur et le « personnage marseillais » le plus en vogue. Il déclare qu’il doit tout à Marseille : sa naissance, sa gloire, « son » Pagnol. Mais il faudrait être simple d’esprit pour ne point y regarder de plus près : « Simplet » (1942) de et avec Fernandel est financé par des capitaux allemands et correspond au souhait de Joseph Goebbels selon lequel les Français « ne produisent que des films légers, vides et, si possible, stupides ». Dont acte.
« La fille du puisatier » est emblématique. Sans s’attarder sur une histoire qui a peu d’importance, il est plus intéressant de replacer le film dans son contexte. Le film est en fait à l’origine une commande du Service Cinématographie des armées qui espère se rapprocher de l’Italie du Duce ! Le film est tourné, difficilement, en 1940 et en raison des évènements Pagnol va gommer toute référence à un rapprochement franco-italien (si ce n’est le nom d’ « Amoretti » pour le personnage incarné par Raimu). Il est par ailleurs contraint de revoir la scène finale du film, qui prévoyait la victoire française, pour conclure sur le discours de Pétain constatant la défaite mais relevé par la phrase de « Patricia » qui déclare que les morts donnent leur raison de vivre aux vaincus. La Kommandatur interdit le film jusqu’à ce que Pagnol cède pour retirer cette dernière réplique… Pagnol ne tournera plus pendant la guerre. De fait, « La fille du puisatier » reste « un témoignage unique de la France rurale au moment de la capitulation » (p.41). Par ailleurs, et cela est très important, l’évolution du personnage de Raimu au cours du film, qui accepte de donner son pardon mais surtout de le demander pour lui-même, est bien loin de la propagande maréchaliste.
Images fixes et images mentales
La bande dessinée et la Shoah : l’iconotexte au service de l’indicible Sylvie Dardaillon, Christhope Meunier, Université d’Orléans
Des images malgré Auschwitz ? A cette question, résumée de façon générale, Georges Didi-Huberman, historien de l’art, répondait en 2004, dans son livre « Images malgré tout », par l’affirmative au nom, précisément, de l’éthique. La BD, en juxtaposant texte, image et support, met l’iconotexte au service de l’impensable. Cet iconotexte n’a pas de prétention au témoignage mais offre une perception qui ne peut être, en soi, qu’une parcelle de vérité.
Ici, les auteurs ont développé leur étude à partir d’un corpus de 38 BD publiées entre 1945 et 2012. Il est à noter qu’il y a une multiplication de parution à partir de 2000 même si le sujet entre dans le monde de la bande dessinée de façon importante dès les années 70. La rupture s’opère au début des années 80 avec les premières planches de « Maus » d’Art Spiegelman puis au début des années 2000 avec l’album « Auschwitz » de Pascal Croci. Si de nombreux dessins de déportés existaient déjà, la première mention « officielle » de la Shoah se trouve sans doute dans « La Bête est morte » de Calvo dont la première publication date de la fin 1944. Toutefois c’est « The Master Race » qui est la première BD à vouloir faire acte de témoignage. Il ne s’agit pas d’un témoignage direct puisque son auteur, Bernard Krigstein, est un immigré juif russe vivant aux Etats-Unis mais d’un « récit testimonial » car ce dernier, vivant dans la communauté juive de New-York, est sensible aux rares témoignages des rares rescapés auxquels il veut donner un écho en 1955. Les qualités scénaristiques de Krigstein lui permettent de ne pas sombrer dans la trivialité qui est la marque d’EC Comics. Pour Art Spiegelman « The Master Race » est un chef-d’œuvre.
Les nombreux procès des années 60, à la suite de celui d’Eichmann, vont permettre d’obtenir de nombreux, et douloureux, témoignages de survivants. C’est ce contexte qui imprègne l’œuvre d’Art Spiegelman ainsi que le suicide de sa mère rescapée de Birkenau (voir « Prisonnier sur la planète Enfer »). La question en filigrane est claire : « Qui est responsable ? ». Dans « Maus », Spiegelman est tout à la fois auteur et acteur et cela renforce l’ambivalence. La création, les éditions et les traductions de « Maus » couvrent une période qui s’étend de 1978 à 1991. Dans le même temps deux BD provocatrices génèrent un débat mémoriel : « Hitler=SS » de Gouriot et Vuillemin et « La Patrouille des Libellules » de Yann et Hardy. Ces deux œuvres veulent dénoncer la « commémoration obsessive » mais leur parti pris artistique fait scandale dans un contexte où l’extrême-droite tient des propos inqualifiables.
Une enquête suédoise de 1997 montrait que 34% des jeunes (12-18 ans) doutaient de la réalité de la Shoah. En 2000 le Troisième Forum International sur la Shoah, réuni à Stockholm, se demandait par conséquent : « Avons-nous assez raconté à nos enfants ? ». En France la BD va être considérée dans le milieu scolaire comme un vecteur important de la connaissance de la Shoah et en 2001 l’album de Croci, cité plus haut, va être primé par l’Assemblée nationale car il a pour objectif de « sensibiliser les nouvelles générations » (p. 50) en dépit de la violence des choix artistiques de l’auteur. A partir de 2005 une quinzaine d’ouvrages sont publiés. On peut citer, parmi tant d’autres, « Yossel » de Kubert (2005). Cette multiplication des publications n’est, bien sûr, pas sans rapport avec l’angoisse de voir disparaître les derniers témoins. Il faut donc devenir « témoins des témoins ». C’est le rôle que semble s’assigner, non sans douleur, Michel Kichka dans son album « Deuxième Génération » (2012). Deux autres BD semblent relever davantage d’un véritable travail de mémoire : « Drançy-Berlin-Oswiecim » de Ponchard et Squarzoni (2005) et « Nous n’irons pas voir Auschwitz » de Jérémie Dres (2011) à propos duquel Pascal Ory écrit que l’ « on pourrait parler de BD « mémorielle » (L’Histoire, n°372, 2012).
Ainsi deux problématiques restent omniprésentes : celle de l’image et celle du témoignage. Pour Claude Lanzman, on le sait, « toute image du crime est une substitution, donc un adoucissement, donc une trahison et aussi un oubli » (p. 54). On peut, à l’inverse, envisager la nécessité impérative de l’image. Si l’on repense aux propos d’Adorno signifiant l’impossibilité d’écrire de la poésie après Auschwitz alors, effectivement, toute tentative « artistique » est vaine, voire malsaine. Mais si l’on suit Paul Ricoeur et que l’on envisage le travail de mémoire non simplement comme une épistémologie mais aussi comme une phénoménologie, alors des portes s’ouvrent…
Les peintures murales des Milles sont-elles une réplique d’une BD de K.Bodek à Gurs ? Angelika Gaussmann
Les peintures murales des Milles ont force de chefs-d’œuvre. Toutefois en identifier l’origine est difficile. La cohérence des dessins de Karl Bodek et de son ami Kurt Löw est mise à jour grâce à la collection dont ils ont fait l’objet (dessins du camp de Gurs et des Milles). Le dessin en question (« La Cène des Milles ») décrit « l’utopie d’une humanité unie en mangeant » (p. 59) : six hommes se partagent du pain. Autre réplique des Milles : les scènes subaquatiques qui montrent le roi des sardines et fait allusion à un célèbre livre pour enfants allemand. Karl Bodek finira assassiné à Auschwitz non sans avoir démontré auparavant que « L’art est plus important qu’on ne le pense, parce que sa portée est bien plus étendue qu’il n’y paraît de prime abord. Mais l’art est moins important qu’on ne le pense, parce qu’étant purement humain, il n’est pas nécessairement extraordinaire » (Rein Wolfs, cité p. 60-61).
Images et Vérité
Des archives à la fiction, la vérité en questions
De l’usage de la notion d’authenticité au cinéma : le cas de la réalisation et de la réception de « Shoah ». Rémy Besson
Dès sa sortie en salle en 1985 « Shoah » est immédiatement considéré comme un chef-d’œuvre. Cela repose sur deux arguments hagiographiques : « Shoah » est à la fois un document exceptionnel et une œuvre d’art. Le premier argument est le plus souvent développé par des commentateurs issus des sciences sociales qui soulignent la qualité documentaire du film. Le second argument, lui, souligne l’ingéniosité des choix filmiques (et techniques : cadrage, son…) de Claude Lanzmann. On peut résumer en disant que certains s’attachent plus au fond tandis que d’autres privilégient la forme. Ses deux dimensions sont toutefois présentes dans nombre d’analyses ce qui s’explique par un présupposé : l’importance du critère d’authenticité. Comme le rappelle Laurence Marconnet dans les « Cahiers du cinéma » un documentaire est « un film didactique présentant des documents authentiques » (cité p. 68). Dans le cas de la Shoah, sujet particulièrement sensible, cela suppose, ou plutôt impose, que le documentaire s’appuie sur des documents authentifiés et validés par les connaissances historiques. La subjectivité et les choix « artistiques » du réalisateur doivent alors être réduits au minimum acceptable. Madeleine Rebérioux avait même proposé qu’un historien soit associé systématiquement à toute réalisation concernant l’Histoire (p. 68).
L’authenticité est donc conçue comme une norme de représentation dont il convient de ne pas s’écarter. Cette norme repose sur trois critères : le respect de l’intégrité du témoignage original (base de l’histoire orale) ; le réalisateur doit être quasiment absent en tant que narrateur ; la transparence du média (rôle mineur du montage). Si l’on applique ces trois critères à « Shoah », le film semble totalement les respecter. Pour Robert M. Webster dans le film de Lanzmann « il n’y a pas de narration, pas de chronologie, très peu d’explication » (cité p. 69). Patricia Erens précise pour sa part que « tout au long de « Shoah », Lanzmann ne met jamais au défi, jamais il ne moralise. Il écoute tout. Aucune voix ne tente jamais de mettre les choses en perspective. Cela n’est pas nécessaire. Les protagonistes (Allemands et Polonais) se condamnent eux-mêmes » (cité p. 70). Le psychanalyste et philosophe Daniel Sibony précise que « les images de « Shoah », pleines d’un vide si parlant, tablent sur un réalisme extrême de l’image » (cité p. 70). Enfin, une brochure pédagogique de la Paramount de 1986 prévenait les spectateurs : « Ces personnes vont vous parler directement ». La caméra devient le seul intermédiaire. Et Shoshana Felman de conclure que dans « Shoah » : « la narration est alors essentiellement une narration du silence, l’histoire de l’écoute du réalisateur » (cité p. 71). « Shoah » serait donc un film intrinsèquement authentique.
Cependant cette interprétation dominante de l’œuvre de Lanzmann n’est pas partagée par tous. Aaron Kerner, spécialiste du cinéma documentaire sur la Shoah ou encore le sémiologue Matteo Treleani dénient à « Shoah » le respect des trois critères d’authenticité, en particulier du fait qu’une image est toujours pensée et « fabriquée » et que par ailleurs il convient de prendre en compte la perception de celle-ci par le public. Les principes de l’archéologie des images pratiquée par les historiens travaillant avec des sources audiovisuelles sont ici précieux. En ce qui concerne directement la Shoah, le travail de restauration des images, effectué depuis la fin des années 90 par le Musée Mémorial de l’Holocauste de Washington, est remarquable. Ainsi l’auteur a-t-il pu, dans le cadre de sa thèse (« La mise en récit de « Shoah », 2012), comparer systématiquement le contenu des entretiens originaux et celui qui ressort de leur intégration dans le film. Il en arrive à la conclusion que « Shoah » est une œuvre dont le montage est extrêmement élaboré » et que le principe d’une intervention minimum du réalisateur n’est pas respecté. Cela remet en cause l’authenticité dont se prévaut le film.
Cette critique du film, pour être recevable, n’en est pas moins discutable dès lors que l’on considère que ce sont les yeux des spectateurs et, plus particulièrement des critiques de cinéma, qui ont apposé ce critère d’authenticité à l’œuvre de Claude Lanzmann. La réception et l’interprétation du film semblent avoir alors plus d’importance que le film lui-même. Claude Lanzmann a immédiatement concédé et revendiqué le caractère construit de « Shoah », notamment en qualifiant son film de « fiction sur le réel ». Il y a donc un décalage entre la réalisation du film (tournage, montage) et sa perception par le public : le réalisateur réfutant le terme de documentaire que les spectateurs et les critiques lui attribuent. En conclusion, « Shoah » établit un rapport authentique avec le passé tout en faisant fi des trois critères d’authenticité et en valorisant la dimension culturelle et artistique.
« Holocauste » : la Shoah entre fiction hollywoodienne et histoire Claude Loufrani, AMU
La série télévisée « Holocauste » a fait découvrir aux États-Unis puis en Europe la réalité de la Shoah à des millions de téléspectateurs. La Shoah pénètre alors dans les foyers. Tout à coup elle n’est plus un sujet limité aux spécialistes, aux victimes et à leurs familles, sans oublier les bourreaux. En France elle est diffusée en 1979 sur Antenne 2. Le dessein de Martin J. Chomsky n’était pas de réaliser un film historico-pédagogique mais de montrer toutes les étapes et toute l’horreur de l’extermination vue à la fois par les victimes et par les bourreaux. En effet, le téléspectateur découvre la période nazie à travers le destin croisé de deux familles : les Weiss, juifs allemands, et les Dorf, allemands nazis. Le téléfilm couvre une période qui s’étend de la Nuit de Cristal (9 novembre 1938) jusqu’à l’arrivée des rescapés en Palestine.
« Holocauste » décrit dans ses moindres détails, y compris ceux des camps, l’histoire de la Shoah et joue sur les mécanismes d’identification entre les victimes et les téléspectateurs établissant ainsi une complicité émotionnelle. C’est un pari risqué… La série est une réussite, notamment grâce aux interprétations de Meryl Streep et de James Wood, mais il fait l’objet de nombreuses critiques qu’elles soient d’ordre historiques, esthétiques ou encore déontologiques (« commercialisation » et banalisation du nazisme et de la Shoah). Or, se demande l’auteur, « Holocauste » n’a-t-il pas permis une prise de conscience de la spécificité du judéocide ? Reste cependant posée cette question essentielle : la Shoah passée à la moulinette hollywoodienne est-ce acceptable ? Si l’on considère que connaître la Shoah est fondamental alors, estime le réalisateur d’ « Holocauste », il faut lui donner corps par des visages, des images, des paroles, des supports et des représentations. On l’aura compris ce parti-pris est l’antithèse de la position « lanzmannienne ».
Il ne s’agit pas ici bien entendu de raconter l’histoire de cette série télévisée de 9 heures. Toutefois il est intéressant de s’attarder un instant sur le personnage d’Erich Dorf. Chômeur, celui-ci rejoint le parti nazi au sein duquel il va faire une fulgurante carrière (cela renvoie à l’explication par certains historiens des convictions nazies, ou plutôt de l’absence de convictions, par la notion de « carriérisme »). « Erich Dorf s’inscrit alors dans la froide cruauté du système : il invente l’émeute civile de la « Nuit de Cristal » ; il dit « territoires juifs autonomes » pour ghetto ; participe au massacre de « Babi Yar » ; est présent à « Wannsee » ; met au point le gazage au « Zyklon B » « (p.83). Certes on peut comprendre la volonté de créer une sorte de « personnage-synthèse », toutefois ça fait beaucoup pour un seul homme ! Quant à la crédibilité historique…
« Holocauste » pose la question du rôle de la fiction quand il s’agit d’aborder la Shoah et le mélange entre imagination et réalité. A cette question, on le sait, Claude Lanzmann a apporté sa réponse : il y a un interdit de la représentation. Martin J. Chomsky a fait l’inverse et le succès rencontré par « Holocauste » laisse penser qu’il a gagné son pari : faire prendre conscience au plus grand nombre de ce que fût la Shoah, même au prix d’une série commerciale. Libre à chacun de se faire son opinion…
Hollywood et la Shoah Jérôme Bimbenet,IHTP
Quel regard a porté Hollywood sur la Shoah après la guerre et comment Hollywood a représenté les camps ?
Dès le début de la Seconde Guerre mondiale Hollywood a pris position contre le nazisme tout en ignorant, le plus souvent, le sort réservé aux Juifs. Il y a certes le barbier du ghetto dans « Le Dictateur » (1940) mais le ghetto de Chaplin reste éloigné de la triste réalité. En revanche « Lune de miel mouvementée » (1942) de Léo Mac Carey offre une reconstitution très réaliste du ghetto de Varsovie. Cependant il manque de toute évidence des informations sur le sujet au cinéma américain durant la guerre. D’où le choc provoqué par les images de la libération des camps.
On le sait, plusieurs cinéastes font partie des troupes de libération qui pénètrent dans les camps. Les images qu’ils y filment provoquent un véritable traumatisme. Le cinéma doit être repensé, notamment dans son esthétisation de la violence, et, comme le souligne Antoine de Baecque, cette réflexion va conduire à un cinéma de suggestion plus que de reconstitution. Pour paraphraser Adorno, comment faire du cinéma après Auschwitz ? Cette question torture les cinéastes témoins, ceux qui les premiers ont reçu le choc (John Ford, George Stevens, Samuel Fuller, Sidney Bernstein). Un montage des images filmées par George Stevens est montré à Nuremberg (« Nazi concentration camps »). Les images dévoilées trouvent leur fonction : avoir un rôle de témoignage et servir l’Histoire. Quant à la fiction comment peut-elle se confronter aux camps ? Alfred Hitchcock, de son côté, monte les images filmées par Bernstein à Bergen-Belsen et réalise ainsi « le premier processus narratif destiné à un large public » (p. 90). Plus tard, Samuel Fuller racontera son expérience de l’ouverture des camps dans « The Big red one ». Il est clair que c’est par petites touches successives que le cinéma américain va aborder la Shoah et se décider à montrer l’in-montrable.
« Le premier film de fiction qui évoque de manière explicite les camps d’extermination est « Le Criminel » (Orson Welles, 1946). Il est le premier film de fiction à utiliser des images des camps » (p. 91). Dans ce film Orson Welles interprète « Charles Rankin », un paisible enseignant qui se révèle être en réalité un ancien responsable nazi et qui est traqué à ce titre par un agent fédéral. Ce dernier révèle à la fiancée de Rankin la véritable nature de son futur époux en lui faisant visionner des images des camps. Après ce premier film, le cinéma américain, plus préoccupé par la Guerre froide, va mettre la Shoah entre parenthèse jusqu’à la fin des années 50 et l’adaptation du « Journal d’Anne Frank » par George Stevens (1959) qui connaît un réel succès. La même année paraît « Jugement à Nuremberg » de Stanley Kramer. Celui-ci insère dans son film une longue séquence des images tournées lors de l’ouverture des camps, utilisant le même procédé que lors du Procès et avec le même objectif : que l’horreur frontale imposée aux spectateurs fasse œuvre historique. Ce film est « le premier grand choc cinématographique sur le génocide » (p.92) même si, en réalité, la spécificité juive de celui-ci n’est pas explicite.
On le sait c’est par « Holocaust », téléfilm produit par la NBC, que la Shoah entre dans les foyers : 220 millions de spectateurs entre 1977 et 1979. « Holocaust » transforme la vision des camps d’extermination. S’il s’agit d’une représentation « fictive » des camps, elle permet néanmoins de faire enfin prendre conscience de la spécificité juive du Génocide et aide aussi à la construction d’une identité juive autour de ce qui sera dès lors plus fréquemment appelé la Shoah (terme hébreu signifiant « catastrophe »). Les critiques toutefois sont nombreuses et, par exemple, pour Elie Wiesel « Holocaust transforme un évènement ontologique en mélo » (cité p. 94). Pour d’autres, le téléfilm n’est autre chose que « la transformation de l’extermination des Juifs en produit de marketing » (p. 95). Il n’en reste pas moins vrai qu’ « Holocaust » a donné accès à des millions de gens à la Shoah par la puissance évocatrice et émotionnelle de la fiction, réussissant là où des études documentaires avaient échoué. On peut résumer en disant que la trivialisation hollywoodienne de l’évènement a permis sa connaissance. Et on peut le regretter…Toutefois les historiens sont intervenus après « Holocaust » pour resituer les choses.
Il restait un tabou qu’ « Holocaust » n’avait pas brisé : pénétrer à l’intérieur d’une chambre à gaz lors d’un gazage. Cela est fait en 1988 dans un autre feuilleton, « Les orages de la guerre », tourné à Auschwitz et qui ne semble pas avoir suscité de réactions. Cinq ans plus tard il n’en va pas de même pour Steven Spielberg et « La liste de Schindler ». Spielberg ne brise aucun tabou dans sa représentation des camps mais déclenche surtout la polémique à cause de la fameuse scène sur dramatisée et esthétisée de « la douche ». En réalité « la force du film réside dans sa retenue » (p. 96) ce qui n’empêche pas Claude Lanzmann, pour critiquer le film, de réitérer son dogme absolu de la non-représentation (ce qui est une référence, même laïcisée, à un principe religieux). « La Liste de Schindler » a d’ailleurs souvent été présenté comme l’exact opposé de « Shoah ». Or finalement, dans son ensemble, le film de Spielberg préfère suggérer que montrer et le fait que le réalisateur soit lui-même fils de victimes de la Shoah a plutôt crédibilisé le film.
La question de Lanzmann demeure : peut-on montrer l’in-montrable ? A cette question Hollywood semble plutôt avoir répondu « oui », non sans une retenue certaine. Toutefois « Hollywood n’est peut être pas compatible avec la Shoah, le cinéma hollywoodien est un spectacle. La Shoah n’en est pas un et ne pourra jamais en être un » (p. 98)…
Quand le manga parle de la Shoah. L’ « Histoire des 3 Adolf » d’Osamu Tezuka Sylvie Dardaillon, Christophe Meunier, Université d’Orléans
« Que connaissent les Japonais de la Shoah ? Essentiellement le « Journal d’Anne Frank » » (p.99). Livre étranger par excellence, Anne est devenue depuis 2001 l’héroïne d’un manga. Or il n’y pas de regard critique sur les crimes nazis et l’alliance germano-japonaise dans cette publication. Au Japon les victimes d’Hiroshima ou d’Auschwitz sont confondues dans la notion large de « victimes de guerre ». C’est en cela que le cas de « L’Histoire des 3 Adolf » d’Osamu Tezuka est intéressant. Par ailleurs il est le seul exemple connu d’un récit narratif de la Shoah, sous forme de BD, de la part d’un Japonais et qui offre à ce titre une autre version que celle des Occidentaux.
La jeunesse d’Osamu Tezuka a été marquée par différents éléments importants. La famille Tezuka s’installe à Takarazuka, non loin de Kobe, en 1932 où son père, ingénieur, travaille pour un complexe militaro-industriel. Ainsi, fils d’une famille aisée, le futur auteur des « 3 Adolf » a accès à la culture occidentale (son père est féru de manga et de cinéma américain). Par ailleurs son adolescence se déroule durant la Seconde Guerre mondiale et l’adolescent participe à l’effort de guerre en usine et est témoin des bombardements (faits relatés dans la BD ici étudiée). Le dessinateur attendra la fin de sa vie (il meurt en 1989) pour réaliser « L’Histoire des 3 Adolf » qui paraît entre 1983 et 1985. Tezuka passe pour être le « dieu du manga ». Il publie sa première œuvre, « La nouvelle île au trésor », en 1946 et en dépit de son jeune âge (17 ans) son style déjà particulier et très affirmé va servir de modèle à des générations de « mangaka ». Comment définir ce style ? « Le trait, le découpage tabulaire, la narration par épisodes » (p. 100). Très inspiré par les « comics » et les « strips » américains vendus au Japon après 1945, Tezuka introduit de plus un regard cinématographique qui rend la BD moins figée. Enfin, dessinateur mais aussi scénariste, il développe son récit et « L’Histoire des 3 Adolf » atteint ainsi 1 800 pages !
Bien plus que la guerre le thème qui est le fil conducteur de l’œuvre de Tezuka est, pour résumer hâtivement, celui de l’humanisme. En effet, pour lui il s’agit de « dénoncer l’endoctrinement, la folie meurtrière qui s’emparent d’un Etat en situation de « guerre » contre des entités extérieures ou intérieures qu’il considère comme ennemies » (p. 102). Il dénonce également le nationalisme et l’ « idéologisation ». Pour cette dénonciation il utilise bien entendu les codes du manga mais également ceux du Kabuki (forme théâtrale japonaise particulière). Le Kabuki dans sa forme guerrière (« l’aragoto ») montre des acteurs au jeu outré, des scènes violentes et des costumes et maquillages outranciers. Quant à l’intrigue des « 3 Adolf » elle respecte la tradition du « Jo-ha-Kyu » qu’utilisent toutes les grandes formes théâtrales japonaises. Pour les Occidentaux cela correspond aux exigences aristotéliciennes (un début, une péripétie centrale, une fin) ou encore aux cinq actes de la tragédie classique. Ainsi « L’Histoire des 3 Adolf » « inscrite dans les codes du Kabuki relève donc également du tragique : les protagonistes y sont en effet pris dans un destin collectif qui les dépasse » (p. 105). L’auteur propose donc une œuvre théâtrale et tragique.
« L’Histoire des 3 Adolf » est également inspirée par la tradition du « jidai mono » (pièces de théâtre ou mangas historiquement connotés) et par l’épopée : ampleur du récit, multiplication des personnages. De fait Tekuza témoigne de son imprégnation personnelle par deux cultures en apparence irréductibles : culture asiatique et culture occidentale. D’un point de vue strictement artistique, c’est-à-dire concernant la BD en elle-même et sa relation à l’Histoire, Pascal Ory a défini deux types de BD : une BD « historique » qui a des préoccupations quasi scientifiques et une BD « historienne » qui a une visée pédagogique (cité p. 107). Duquel de ces deux types ressort l’œuvre de Tezuka ? Sans conteste sa BD est un récit iconotextuel historique. Cependant l’auteur fait également œuvre d’historien et de pédagogue en dépoussiérant des fragments de l’histoire japonaise : le rappel de la présence de communautés juives importantes au Japon (4 600 Juifs à Kobe en 1942 par exemple) ; l’évocation de la Shoah, inconnue dans les écoles nipponnes ; l’explication de l’idéologie nazie ; la responsabilité du Japon impérial dans la Seconde Guerre mondiale (évocation de la guerre sino-japonaise et du massacre de Nankin).
Pour conclure, « Les 3 Adolf » est aussi une œuvre « philosophique » qui dénonce avec un certain pessimisme les méfaits des idéologies et du totalitarisme. Cette œuvre, initialement conçue pour les adultes, a vocation à éveiller les consciences adolescentes nipponnes voire celles de leurs…enseignants.
Quête de vérité par l’image
« Le Juif Süss » : une falsification et un détournement Claude Loufrani, Docteur en Sciences du Langage
Lion Feuchtwanger est né dans une famille juive aisée et « émancipée » à Munich en 1884. Il poursuit des études de littérature et de philosophie et en 1925 publie un roman historique, « Le Juif Süss », qui devient un best-seller. Lion Feuchtwanger, dans les années 20, est perçu comme pacifiste et antimilitariste et travaille notamment avec Bertolt Brecht. En 1933 il est déclaré « ennemi du peuple allemand » et déchu de sa nationalité. Il s’installe alors dans le Sud de la France où il reçoit les intellectuels allemands en exil (Bertolt Brecht, Thomas Mann, Walter Benjamin…). Interné par deux fois au camp des Milles, il parvient à gagner les Etats-Unis où il meurt en 1958.
Dans « Le Juif Süss » l’auteur tente de recréer l’atmosphère antisémite du XVIIIe siècle. Son personnage, Joseph Süss Oppenheimer, n’est pas un « juif du ghetto » mais un de ces « Juifs de Cour » dont les princes allemands ont besoin en raison de leurs capacités intellectuelles et financières. Descendant d’une famille de banquiers, Joseph Süss entre au service du prince Charles-Alexandre en 1732. Son ascension est fulgurante mais se termine tragiquement : il est pendu dans une cage de fer. Joseph Süss concentre tous les stéréotypes du Juif que le peuple exècre : riche, entretenant des relations sexuelles avec des chrétiennes et se livrant à la magie noire. A travers ce personnage, et c’était l’intention de l’auteur, apparaît la figure du « bouc-émissaire juif » dont la mise à mort sert d’exutoire aux problèmes sociaux du temps.
En 1939-1940, le roman de Lion Feuchtwanger est récupéré par Joseph Goebbels qui souhaite en faire un film de propagande, dont la réalisation est confiée à Veit Harlan, pour montrer le vrai visage de la « juiverie ». Goebbels est totalement impliqué dans le tournage et visionne les « rushes » tous les soirs. Le film de Veit Harlan est d’un antisémitisme paroxystique, du moins dans la mise en scène de tous les « clichés » liés aux Juifs : les caractéristiques physiques, l’immoralité, la perversion, l’aspect repoussant et angoissant. Il s’agit de montrer comment la « juiverie » pervertit et souille la race aryenne. Par ailleurs, « Le Juif Süss » se veut aussi une réponse au « Dictateur » de Chaplin. Sorti en 1940, le film comptabilise en 1943 plus de 20 millions de spectateurs ! Après-guerre, Veit Harlan a été acquitté suite à deux procès. Il n’avait pas participé à la « Solution finale »…
Théâtre documentaire et génocide : entre éclairage de la réalité et subjectivités partagées Dr Claire Audhuy, Université de Strasbourg et Freie Universität Berlin
L’article s’intéresse au théâtre documentaire qui tente de représenter le génocide. L’adjectif « documentaire » étant utilisé afin de surpasser la phrase d’Adorno concernant la poésie, l’interdit de fiction d’Elie Wiesel et l’interdit de représentation de Claude Lanzmann. Et, de fait, comme l’a constaté Herbert Sandberg, il y a une « infériorité de toutes les images possibles par rapport à la réalité des souffrances vécues » (cité p. 119). Dans l’opinion persiste cette idée insidieuse à propos de la représentation de la Shoah : on ne peut pas et/ou on ne doit pas. On retrouve ici le paradigme « lanzmannien » et l’on se heurte à sa posture de « Gardien du Temple ». Le théâtre « documentaire » est lui aussi soumis à cette injonction. Or ce théâtre « puise dans les souvenirs des rescapés du génocide, conviant les témoins sur le plateau et obligeant à une redéfinition du « théâtre » (p.121) dans le respect des survivants. Il s’agit donc d’une « création documentaire » même si, de prime abord, les deux termes peuvent sembler antinomiques.
Le cas de Sami Feder est édifiant. Né en 1909, il s’engage tôt dans des mouvements sionistes et est parallèlement homme de théâtre. Prenant vite conscience de la menace nazie il déclare : « Nous avons besoin d’un théâtre juif antihitlérien, car c’est la seule façon de survivre, de ne pas se soumettre » (cité p. 121). Sami Feder sera déporté dans douze camps où il décide de poursuivre son obsession théâtrale. Son propos théâtral est une satire politique fondée sur des textes métaphoriques. Il confiera dans son journal que 52 personnes ont participé à son théâtre concentrationnaire. Sa démarche est un défi et un exploit : « Dans chaque camp, j’ai essayé de préparer des évènements culturels » (cité p. 121). Dire que cela force le respect semble presque dérisoire… Sami Feder a un objectif précis : faire un théâtre juif, s’adressant aux Juifs et en Yiddish afin que ceux-ci ne disparaissent pas totalement dans la nuit et le brouillard.
A la libération Sami Feder crée le Kazet Théâtre à Bergen-Belsen pour les Juifs qui ne veulent ou peuvent rentrer étant, ou se sentant, « indésirables » (Juifs polonais ou hongrois). Le Kazet Théâtre met en scène, sur les lieux mêmes, l’histoire de la Shoah et celle-ci est « jouée » par des Juifs dont certains endossent le rôle de SS. Lorsque le camp ferme en 1950, environ un millier de Juifs y vivaient encore. Le théâtre de Feder est d’une crudité absolue dans sa volonté de faire prendre conscience de ce qu’il vient de se passer. Ce théâtre est tellement réaliste que l’accueil qui lui est réservé dans les proches années d’après-guerre est parfois très réservé (c’est le cas aux Etats-Unis, tandis qu’il rencontre plus de succès en France et en Belgique). Ces représentations révèlent d’une volonté de témoigner et d’un désir de revanche.
Sami Feder « a su aider ses frères pendant la Shoah, en leur proposant un théâtre identitaire et communautaire, il a aussi réussi, après-guerre, à réécrire leur Histoire et à la diffuser par le biais du théâtre » (p. 124). A ce titre il revendique, pour son théâtre, une « parole vraie » mais celle-ci doit aussi avoir une vertu « cicatrisante » (drama therapy) et un objectif de résilience. Le Kazet théâtre donne la parole aux rescapés. De fait la notion de « théâtre » est elle-même redéfinie en gommant l’art du faux-semblant : les témoins se font acteurs de leur propre drame. Cependant, art oblige, lorsque les rescapés de Bergen-Belsen mettent en scène la Shoah, tout est vrai mais rien ne s’est passé de cette façon. La Shoah, en tant qu’évènement du passé, en dépit de l’immédiateté du théâtre de Feder, ne peut être que « reconstituée » même de façon formelle.
Sami Feder partit s’installer en Israël en 1947. Il ne fit plus jamais de théâtre…
La Shoah dans les manuels scolaires Bertrand Lécureur, Université Paul Valéry, Montpellier III
Le manuel scolaire, en soi, pose problème, de par sa nature. Selon Alain Choppin le manuel scolaire est une « autobiographie nationale » (cité p. 127). Vous voyez jusqu’où nous entraîne cette musique. Un vrai roman…. Un manuel scolaire est le « reflet de l’image qu’une société veut donner d’elle-même et de son passé, en particulier à sa jeunesse » (p. 127). Des adultes, professeurs émérites, dont l’intelligence ne saurait être mise en doute, conçoivent des manuels sensés transmettre un patrimoine. Examiner un manuel scolaire revient donc à analyser une mentalité collective. Or quelle réelle utilisation fait-on d’un manuel (professeurs et élèves confondus) et quel impact a-t-il ? Le manuel, objet éducatif, n’est pas dépourvu d’enjeu commercial. Ceci étant dit venons-en au cœur du sujet.
Bertrand Lécureur a analysé un peu plus d’une centaine de manuels d’Histoire (français, belges, allemands, anglais) en concentrant son expertise sur le traitement de la Shoah par ces manuels (plus spécifiquement sur le niveau « 3e » car c’est celui qui concerne une majorité d’élèves avant le « tri sélectif »). Il a constaté, du fait d’une analyse à la fois quantitative et qualitative, une diminution de la seconde dimension (leçon) au bénéfice de la première (documents, exercices). Le thème de la Shoah est, depuis les années 50, toujours présent mais son importance est plus ou moins relative.
Depuis les années 50 la part de la Shoah dans les manuels est croissante, en écho aux interrogations de la société (cela est surtout prégnant pour les manuels allemands, ce qui est à mettre en relation avec la « bataille historique » des années 80). En France cela est très net avec l’accroissement de documents sur le sujet. En comparaison, la Grande-Bretagne reste assez loin derrière quant à la production pédagogique concernant la Shoah. Dans les manuels des pays ici considérés, à partir des années 90 « apparaissent des documents écrits et iconographiques inédits, des démarches novatrices » (p. 130). Une part importante est accordée à l’idéologie antisémite nazie (notamment par le biais d’exercices basés sur l’analyse d’extraits de « Mein Kampf »).
Trois évènements sont régulièrement convoqués comme pour synthétiser : le « Boycott » (1933), Les Lois de Nuremberg (1935), la « Nuit de Cristal » (1938). Les images utilisées pour mettre en exergue ces évènements se retrouvent dans tous les manuels européens. En ce qui concerne le processus génocidaire ce sont les manuels français et allemands qui paraissent être les plus complets. Le plus surprenant reste la précision précoce des manuels allemands : 6 millions de victimes recensées, le rôle des « Einsatzgruppen », la chronologie précise du processus d’extermination (juillet-août 1941). Dans les manuels français des années 80 l’on peut constater une disparité : certains demeurent très allusifs, d’autres sont beaucoup plus précis (spécificité du judéocide mis en lumière, différenciation entre les différents types de camps, exploitation de témoignages essentiels).
De nos jours les manuels français tentent de donner une réelle dimension à la Shoah (textes, témoignages, images…). De plus, contrairement aux manuels non-français, la production pédagogique hexagonale fait une large place au rôle de Vichy sous les effets des avancées historiographiques depuis les années 80. En conclusion, la Shoah a toujours été présente dans les manuels scolaires depuis les années 50 mais avec une présence de plus en plus forte depuis les années 80. Cette évolution générale est confirmée par l’ouvrage de François Azouvi, « Le Mythe du grand silence » (Fayard, 2012). Il reste une question essentielle : que font les enseignants de toute cette matière ?…
Recherches de l’image/vérité dans la création littéraire
De l’écriture au tableau : la vérité du corps du détenu Lucie Bertrand-Luthereau, IEP, Aix-en-Provence
Question récurrente : « qu’en est-il de la « Vérité ? » » à propos de la Shoah. Lucie Bertrand-Luthereau est spécialiste de l’œuvre de Robert Antelme et se pose donc la question de la « Vérité » chez « l’espèce humaine », celle qui se cache derrière le « masque concentrationnaire ». Une seule semble approchable, celle du corps meurtri.
Robert Antelme utilise la « poétique » pour conduire une réflexion sur l’homme dans le camp. Ce bref extrait en dit long : « La dernière fois que j’ai eu le miroir, il y avait longtemps que ne m’étais pas regardé. C’était un dimanche, j’étais assis sur la paillasse, j’ai pris mon temps. Je n’ai pas examiné tout de suite le teint jaune ou grisâtre, ni comment étaient mon nez et mes dents. D’abord, j’ai vu apparaître une figure » (R. Antelme, cité p. 140). Se regardant ainsi dans le miroir, Robert Antelme cherche « la vérité de l’homme », celle qui est déformée par le camp. La vérité concentrationnaire en effet est inversée : les nazis traitent les détenus en sous-hommes du fait de leur apparence, or c’est ce « traitement » qui donne de fait cette apparence aux « untermenschen ». Or ce que voit tout d’abord Robert Antelme c’est « une figure », un visage, une apparence humaine. Celle pour qui les nazis n’ont aucun regard différent d’un détenu à l’autre, niant de ce fait toute individualité. Pour Robert Antelme c’est une sorte de revanche car « niée, deux fois niée (…) la figure avait fini pour nous-mêmes à s’absenter de nos vies » (cité p. 141). Le miroir lui prouve la réalité de cette figure, partant, son humanité. Ce miroir est « l’envers du miroir de l’œil SS » (p. 141). En soi il est une « œuvre d’art » : un portrait qui ne contente pas des traits du visage mais peint la « vérité » de la figure humaine, une vérité ontologique.
Vers la fin de son récit Robert Antelme, dans une partie intitulée « La Route », raconte « les marches de la mort ». Un SS choisit qui doit être mis à mort sans délai. Un étudiant italien est désigné et sa figure devient rose et l’auteur de nous dire : « J’ai encore ce rose dans les yeux » (cité p. 142). Procédé pictural : dans un ensemble fait de gris un condamné apporte une touche de rose alors que nous voyons toujours la mort de couleur noire ! Le rose qui teinte le visage de l’étudiant italien, prêt à mourir, lui prête vie parmi ceux qui ont l’allure de morts-vivants. Le choix artistique de Robert Antelme (« hapax colorimétrique », p. 144) indique l’inversion des valeurs dans les camps : l’oubli de « la vie en rose », la réalité de « la mort en noir » et pourtant, une « mort rose ». Le rosissement de l’Italien le « rend » à la vie. C’est un phénomène connu des médecins qu’ils appellent « le printemps de la mort ».
Robert Antelme développe un véritable vocabulaire esthétique codifié dans sa narration qui offre une vision très picturale des faits. Il s’agit d’un travail d’épure rappelant celui des Suprématistes. Par exemple cette description de la place d’appel : « On encadre la place du camp, couverte de neige (…). Quand le SS est arrivé devant ma file, il n’avait plus rien devant lui que des raies mauves et grises et il a compté jusqu’à cinq » (cité p. 146). Tout y est : les couleurs et les formes géométriques, toutes « déshumanisées ». Ce procédé nous permet d’approcher la sensibilité antelmienne : Robert ne fait pas un simple compte-rendu, il « révèle ». Depuis son lieu de convalescence, Robert Antelme écrira : « il me semble que je vis à l’envers le « Portrait de Dorian Gray » » (cité p. 150)…
Artistes contemporains et « esthétique du retrait » Jérôme Moreno, Université de Toulouse
L’ « esthétique du retrait » peut ainsi se traduire : un parti pris par les photographes des camps. C’est ce qu’a voulu montrer une exposition en 2001 à Paris intitulée « Mémoires des camps. Photographies des camps de concentration et d’extermination nazis (1933-1999 ) ». Exposition qui avait provoqué la désapprobation de… Claude Lanzmann, pour qui, on l’aura compris, la représentation de la shoah est impossible voire interdite. Il soulignait ainsi, et une fois de plus, « le tabou de l’image ». Il est vrai que la photographie, malgré son apport évident à la compréhension de l’univers concentrationnaire, a été refoulée au profit du sacro-saint témoignage. Tout simplement parce que l’image peut paraître antinomique avec ce que l’on juge indicible. Or, le témoignage, dont il ne saurait être question de contester l’importance, n’est qu’une des composantes, bien entendu essentielle, de l’histoire de la Shoah. La photographie, même si elle installe une « pédagogie par l’horreur » (cité p. 152) est nécessaire à la connaissance et cela implique de dépasser l’interdit de l’image.
Les témoins, hélas, peu à peu disparaissent et leur parole avec eux, d’où la nécessité de supports visuels. On peut le regretter, on peut s’en offusquer, il en est ainsi. Toutefois les images posent un problème à ne pas négliger : quelles sont leurs origines ? ainsi « la question centrale n’est plus en effet de savoir s’il est possible ou permis d’opérer une telle transformation esthétique, mais de se demander avec quelle esthétique il convient de traduire la réalité des images, et comment celles-ci seront perçues par la société » (Arno Gisinger, cité p. 153). C’est ce que se propose de faire ici Jérôme Moreno. Dans les années 80, Christian Gattinoni, critique et photographe, hanté par la détention de son père à Mauthausen, entreprend un large travail pour transmettre à « la seconde génération ». Ce travail lui a été « imposé » par le bruit d’un train de marchandises à Arles qui a provoqué un « choc mémoriel ». Son appareil photographique lui a alors servi de barrière de protection en regard de l’inimaginable. Par ailleurs le « flou » photographique protège aussi celui qui regarde l’image. Mais, paradoxalement, ce « flou artistique » engendre des « fulgurances mémorielles » : un train de marchandises est automatiquement associé à un train de déportés (p. 155). Ainsi, l’image ne saurait être qu’une « interprétation » mémorielle de la Shoah. Par son travail, Christian Gattinoni pose la question de la « vérité » de l’image. Cette interrogation est particulièrement prégnante dans une photographie prise à… Mauthausen (« Autoportrait à Mauthausen ») et qui est une véritable « mise en scène ».
Le cas du photographe américain David Levinthal est lui aussi édifiant. En 1993-1994 il entreprend une série intitulée « Mein Kampf ». Sa technique est particulière : il met en scène, par des maquettes, des actions inscrites dans la mémoire collective. Ainsi sont mis en photographies des défilés militaires nazis, des exécutions commises par les Einsatzgruppen ou encore un mirador et un four crématoire. Il ne s’agit pas de lieux précis mais ces images renvoient à l’imaginaire collectif et sont réinvesties dans l’art contemporain. Lui aussi utilise par ailleurs un « flou intentionnel » (p.156). Ce « flou » est volontaire. « Il inscrit au cœur de la photographie l’idée d’une image prise sur le vif, presque volée… » (p. 157). La photo devient une résurgence mémorielle jouant avec les limites de l’Indicible et contournant volontairement l’interdit de la représentation.
Les photographes contemporains (Gattinoni, Levinthal, Pruszkowski) utilisent les « archétypes de l’horreur » en tant que choix artistique. Cela crée une force émotionnelle certaine tout en créant une mise à distance par l’utilisation du « flou ». Cela s’appelle « l’esthétique du retrait » qui a pour objectif non de montrer une réalité historique mais de provoquer une vérité mémorielle basée sur l’émotion.
Le petit fantôme d’Auschwitz Willy Paillé, Université de Bordeaux
« Odradek », personnage de Kafka, est, d’après Walter Benjamin la personnification même des choses tombées dans l’oubli. Pour une seule phrase cela fait déjà deux références de poids ! Odradek est donc une personnification mentale, une image séminale. Une trace. Celle d’un « ego » replié sur lui-même, c’est-à-dire l’enfance. Un adulte resté « fantôme », celui qu’on ne voit pas mais que l’on est certain d’avoir vu. Odradek ente en résonnance avec le Hurbinek de Primo Levi, cet enfant d’Auschwitz dont le bras était tatoué et qui mourut en mars 1945. Celui qui était le plus petit et le « plus désarmé d’entre nous » mais dont le regard était difficilement soutenable (cité p. 163). Oui, car Hurbinek porte en lui toute la folie du système concentrationnaire. Il a compris. Sans pouvoir le dire.
L’auteur se demande s’il ne reste vraiment rien de cet enfant comme l’affirme Levi. Il convient donc, propose-t-il, de partir à la recherche de son « identité ». Willy Paillé avoue d’emblée l’inutilité de sa « recherche ». A moins qu’elle permette de comprendre Hurbinek comme un exemple du génocide. En effet, « sur cette page, pour n’importe qui devant un livre d’histoire ou sur le territoire d’Auschwitz, c’est la nécessité de n’en pas rester à cette impasse de l’imagination, cette impasse qui fut précisément l’une des grandes forces stratégiques, via les mensonges et les brutalités, du système d’extermination nazi » (Georges Didi-Huberman, cité p. 166). Au final, l’enfant meurt libre car il a acquis le langage et « accède à la réalité à travers une impuissance de dire et une impossibilité qui accède à l’existence à travers la possibilité de parler » (p. 169).
Conclusion
Le cinéma change-t-il la perception de la Shoah ? La survivance de l’image déportée dans « Kamp » de la compagnie Hôtel Modern Virginie Vincent, Université Paris I Panthéon-Sorbonne
Virginie Vincent se propose d’analyser un spectacle de la compagnie « Hôtel Modern » intitulé « Kamp » et ayant une vocation tout à la fois esthétique, documentaire et pédagogique. Il s’agit d’un « spectacle » mettant en jeu des déportés d’Auschwitz. Mais des déportés en carton-pâte…. Dans ce spectacle il n’y a point de narration mais une mise en scène des représentations que l’on a de l’univers concentrationnaire. Particularité du spectacle, une vidéo tournée « in vivo » est projetée en direct. Cette vidéo est construite sur des images connues des camps tandis que sur scène s’animent de petites figurines. Ou comment créer de la distance… En l’occurrence il s’agit du choix artistique de la compagnie («Live animation»).
Le spectateur, troublé, ne sait plus si « il est au Auschwitz » ou si on lui en propose une représentation. De fait il s’agit d’une « mise en scène feuilletée » (p. 179) qui propose trois étages d’observation. Donc d’interprétation…, avec pour objet central le camp reconstitué. Une esthétique « étagée » telle que la mémoire peut en créer. Cependant, à ce jeu là l’ambivalence s’impose : Auschwitz, Birkenau, la rampe… Rien de la réalité « vraie » n’est proposé. Il s’agit donc d’un simulacre (la maquette, la vidéo, les figurines). L’espace de « Kamp » est tridimensionnel et polymorphe, où le spectateur se trouve à la fois immergé et « mis à distance ». La technique utilisée crée des « effets de camps » (p. 181), visuels et sonores qui font écho aux témoignages des survivants et résonnent dans la mémoire collective. L’intention est de créer une « image complète » car celle des témoins, de par leur vécu, n’est que partielle. Le spectateur a alors l’impression d’accéder à une « authenticité », renforcée par les images de l’horreur (fours, chambres à gaz, corps…). L’expérience peut toutefois se révéler insoutenable.
Le cinéma allemand d’avant-guerre annonce-t-il la catastrophe ? Renée Dray-Bensousan, AMU
Les explications de la ferveur nazie ont été multiples (le « Diktat », la crise, la démocratie mal acceptée…) mais elles ont souvent oublié les mécanismes psychologiques profonds. Or, Siegfried Kracauer, critique de cinéma, prend en compte cette dimension dès 1945. Ecoutons le un instant : « Je suis persuadé que, par une analyse des films allemands, on peut parvenir aux dispositions psychologiques profondes qui dominaient en Allemagne de 1919 à 1933 » (cité p. 191). De même pour Lotte H Eisner, historienne « Mysticisme, imagerie, forces obscures auxquelles de tout temps les Allemands se sont abandonnés avec complaisance, avaient fleuri devant la mort sur les champs de bataille » (cité p. 192). Ainsi Renée Dray-Bensousan se propose d’analyser en quoi le cinéma allemand peut aider à comprendre le phénomène nazi et comment il en fut une « prémonition ». Ou, le nazisme par la caméra…
L’UFA, l’un des plus grands groupes cinématographiques allemand, réponse à Hollywood, est fondé en 1917 par des militaires et des industriels. Le lien entre l’armée, l’autorité, l’ordre et le Capital sont déjà évidents (l’UFA est un Konzern). Tiens donc… L’UFA est ainsi une usine de propagande et une entreprise économique. Après 1918, les productions de l’UFA sont imprégnées de l’expressionnisme issu du théâtre et de la peinture. Or, « Les films d’une nation reflètent sa mentalité de manière plus directe que tout autre moyen d’expression artistique » (p. 194). En effet, un film fait appel à des dispositions psychologiques, à une mentalité collective. En Allemagne, c’est la mentalité de la classe moyenne qui prévaut dans l’effet miroir du grand écran durant l’entre deux-guerres. Un exemple (film aujourd’hui disparu) : « Le Cabinet du Dr Caligari » qui, comme le dit si bien Kracauer « exprime l’âme allemande, macabre, sinistre, morbide » (cité p. 194).
La production cinématographique, après 1924, est très « américanisée » mais la particularité du cinéma allemand lui permet de garder une forte influence. Or, ce cinéma porte en lui les signes avant-coureurs du nazisme. Il est permis de distinguer trois « périodes » : avant et après 14-18 ; les années de crise ; l’arrivée des nazis au pouvoir. Envisageons tout d’abord la première de ces périodes. Le cinéma allemand est alors un cinéma nihiliste qui peut laisser entrevoir le développement probable du nazisme en cela qu’il exprime une grande souffrance. Face à la souffrance, il faut une croyance, une promesse, une utopie. Ce que sera le nazisme (voir les travaux de Christian Ingrao). Ainsi en va-t-il pour le film « L’Etudiant de Prague » de Stellan Rye qui sonde les profondeurs de l’être et dont la fin est un…suicide ! Vous avez dis « prémonition » ? Deux autres films peuvent également être vus à travers un prisme prémonitoire : « Le Golem » et « Homonculus ». Ces deux films sont le reflet d’une angoisse collective. « Le Golem », réalisé par Paul Wegener en 1914, reprend une vieille légende juive que la version de Julien Duvivier en 1934 inversera. « Homonculus » de Albert Neuss et Otto Rippert (1916) présente un personnage qui est un dictateur, déclenche une guerre mondiale et finit tué par un éclair ! Kracauer souligne qu’au moment de la parution du film, le philosophe Max Sheller expliquait les causes de la haine que l’Allemagne pouvait susciter et l’échec démocratique interne. Il entendait dénoncer ainsi l’attitude réactionnaire des classes moyennes allemandes qui ne pouvait déboucher que sur une Apocalypse…. Prémonitoire ?
Suite à la Grande Guerre la naissance du cinéma allemand s’est faite dans un climat d’effervescence intellectuelle. En ce qui concerne le cinéma allemand des années 20, Renée Dray-Bensousan s’appuie sur deux exemples : « Le Cabinet du Dr Caligari » (R. Wiene) et « La rue sans joie » (Pabst). Initialement « Caligari » était prévu pour dénoncer la toute-puissance de l’Etat et l’autorité illimitée, faisant implicitement référence à la guerre. Le résultat final fût quelque peu différent. Toutefois l’histoire de Caligari et de sa créature « Cesare » trouve aujourd’hui un écho particulier si nous lisons le livre, certes controversé, de Daniel Goldhagen (« Les Bourreaux volontaires de Hitler. Les Allemands ordinaires et l’Holocauste », Seuil, 1997). Par ailleurs, il y a le cas particulier de « Metropolis » (1927) de Fritz Lang. Les moyens mis en œuvre par la UFA pour ce film ont été colossaux. L’intérêt de ce film, en relation avec notre sujet, est qu’il apparaît comme étant le plus prémonitoire et comme le dit Renée Dray-Bensousan : « on ne peut s’empêcher de superposer, à la marche des ouvriers la nuque baissée, la marche des déportés » (p. 203). Une preuve ? Les déportés de Mauthausen appelaient leur camp… « Metropolis » ! 3Metropolis » est à ranger, de par sa vision prémonitoire du totalitarisme, aux côtés de Georges Orwell.
« Le cinéma allemand des années 1930 était devenu, comme après la guerre, un champ de bataille où s’affrontaient de nouveau les tendances intérieures en conflit » (p. 205). Ainsi, le cinéma allemand a pressenti, à défaut de pouvoir l’analyser, la catastrophe à venir…
Témoignages d’artistes et d’enseignants
L’écrivain témoin Anika Thor
Anika Thor nous livre ici un témoignage personnel. Sa mère a fêté son douzième anniversaire le 9 novembre 1938, c’est-à-dire, vous l’aurez compris, lors de « La Nuit de Cristal ». Fort heureusement elle n’était plus en Allemagne mais en Suède, là où est née Anika cinq ans après la guerre. Juive d’origine, Anika a vite compris sa chance : être née en Suède et non dans l’un des pays occupés auparavant par le IIIe Reich, d’autant plus que sa famille a pu bénéficier, en dépit d’une politique d’immigration restrictive, de pouvoir résider en ce pays scandinave…
A travers ses lectures Anika prend conscience du destin des enfants juifs réfugiés en Suède. Pour résumer, ce n’est pas le paradis mais c’est toujours mieux que les wagons plombés. Cela la conduit à inventer un personnage, un petit témoin : une fillette de 12 ans, prénommée Steffi, qui donne lieu à un premier ouvrage qu’elle intitule « Une île trop loin » ». Ce livre est écrit à la troisième personne pour éviter l’outrecuidance de s’approprier la mémoire des survivants. Une Anne Frank qui n’aurait pas eu d’existence… Il y a donc une volonté de respect et de mise à distance. Cela n’en reste pas pour le moins intense.
Profondément touchée par son sujet, Anika décide d’écrire un autre livre : « L’étang aux nénuphars ». Livre dans lequel elle reprend le personnage de Steffi, qui entre-temps a grandi, et expose ses difficultés d’intégration en tant que juive réfugiée. Cela rappelle certaines attitudes et certains propos (on pourra ici penser à Emannuel Berl, par exemple). Sollicitée pour intervenir auprès des adolescents, Anika décide, afin de mieux répondre à leurs questions, d’écrire un troisième livre. Ce sera : « Les profondeurs de la mer » et l’expérience se révèle douloureuse. L’action, en partie, se déroule à Therensienstadt, le « camp modèle » mais qui n’empêche ni la nuit, ni le brouillard.
Finalement pour ne pas enfermer son personnage dans cette seule sombre période, Anika écrit un autre ouvrage qui se déroule au moment de la Libération. Le premier livre d’Anika a reçu le Prix August en tant que meilleur livre pour enfants et adolescents en 1996. Cela correspond à la période où le gouvernement suèdois décide d’aborder officiellement l’histoire de la Shoah. Les enseignants se sont alors servis des livres d’Anika pour enseigner le Génocide. De l’intérêt de la littérature fictive… C’est une bagatelle ? Oui, mais il s’agit d’un massacre…
L’Album d’Auschwitz Judith Martin-Razi, Photographe
Judith Martin-Razi porte sur « L’Album D’Auschwitz » son œil de photographe, ce qui n’empêche en rien, bien au contraire, une approche historienne. Les photos de l’ « Album » racontent le processus d’extermination jusqu’au seuil, non franchi, de la chambre à gaz. Ces photos possèdent une telle force, un tel réalisme qu’elles sont en elles-mêmes un rempart au négationnisme. Le regard, qui ne peut être celui de Lili, suppose une distanciation. Il n’empêche, comme le disait Simone Veil, ces photos montrent des vivants non des morts.
L’histoire de « L’Album d’Auschwitz » est complexe. C’est Serge Klarsfeld qui a d’abord utilisé ces photos comme preuves pour un additif de procès mais c’est en août 1980 que Lili Jacob a fait don de l’album à Yad Vashem et l’a présenté à Menahem Begin. Cet album provient donc d’une ancienne déportée, Lili Jacob, qui, à la libération des camps l’a récupéré et l’a ensuite transmis au Musée juif d’Etat de Prague en 1949. En 1964 lors des Procès de Francfort, Lili présente cet album aux procureurs.
Les photos ont été prises, pour l’essentiel, par deux responsables SS d’Auschwitz (Bernhard Walter et Ernst Hoffman) pour le service politique du camp. Walter a dirigé le service d’identification des déportés (photos anthropométriques) au « camp mère » (Auschwitz I) de novembre 1940 à janvier 1945. Une question essentielle demeure et reste mystérieuse : pourquoi avoir pris ces photos alors que le Génocide était censé être un secret ?
En ce qui concerne Lili Jacob il convient de présenter rapidement son histoire. En mai 1944 elle est déportée avec toute sa famille : 22 personnes dont 12 enfants. Elle sera la seule survivante. Transférée à Dora-Nordhausen, elle est soignée à « l’infirmerie » car elle a contracté le typhus. C’est là, à la libération, qu’elle trouve « L’Album » dans une commode. Parmi ces photos elle reconnaît des gens de sa famille et « L’Album » devient dès lors son bien le plus précieux. En 1946, elle vend une reproduction de « L’Album » au Conseil juif. L’argent qu’elle en retire lui permet d’immigrer avec son mari et son bébé aux Etats-Unis.
Serge Klarsfeld, avec l’aide de Jean-Claude Pressac (un ancien négationniste auteur d’une thèse précieuse), qui comprend l’importance de ces photos et tient à les faire publier. L’album officiel aujourd’hui disponible (5e édition) contient 183 photos. Il en manque environ 80 dont 60 montrant la visite de Himmler à Auschwitz le 18 juillet 1942. Dans la mémoire collective « L’Album de Lili » a incrusté la photo de la rampe et de la sélection.
Enseigner le film au Collège. Le document fiction en Histoire : le procès de Klaus Barbie Laurie Corso
Laurie Corso, afin d’aborder la Shoah dans une perspective pédagogique a choisi de proposer à ses élèves : « Un Jour, Une Histoire : Klaus Barbie, sur les traces d’un criminel nazi ». Pour un enseignant ce type de choix est toujours délicat, d’un point de vue éducatif, mais il lui faut également tenir compte de la sacro-sainte « programmation » et des heures « octroyées ». Par ailleurs le choix de ce film ne se fait pas sans difficulté car il relève de ce nouveau genre que l’on nomme « docu-fiction ». Dans cette conception et présentation de l’Histoire on trouve un peu de tout (d’ « Apocalypse Hitler » à « Secrets d’Histoire de Stéphane Bern. Je m’abstiendrais de tout commentaire…). Pour le sujet nous concernant, l’idée d’un docu-fiction sur Klaus Barbie provenait de Laurent Delahousse qui voulait toucher, sur un sujet sensible, un large public…
Pour Laurie Corso se pose alors le problème de la nature du document à diffuser. De quoi s’agit-il exactement : un documentaire, un docu-fiction, un docu-info ? C’est sous ces différents aspects que le programme est présenté par les magazines spécialisés (spécialisés en TV, cela s’entend…). Or, il convient de s’entendre sur les définitions. Un film documentaire repose sur des évènements et des personnages réels. Un docu-fiction introduit, de par sa définition même, une large part de fiction (mensonge ?). Quant au docu-info il procède encore d’un autre genre. En ce qui concerne le film consacré à Barbie le mélange est étrange. Il s’agit d’un récit documentaire agrémenté d’interventions du présentateur. Celui-ci met tout à la fois cause le Vatican, les Etats-Unis et le gouvernement de la France de Pompidou à Mitterrand. Cela peut certes montrer la prise de conscience des multiples responsabilités dans la spécificité de la Shoah et de ses suites mais pose cette question problématique pour les élèves : pourquoi a-t-on mis aussi longtemps pour arrêter Barbie ? Question puérile ? Peut être, mais utile.
Le « reportage » montre les différentes étapes de la vie de Barbie de la Seconde Guerre mondiale jusqu’à 1987. Barbie est tout d’abord recruté par les Américains dans le cadre de la lutte anticommuniste. Face au rappel de son rôle, en particulier pour ce qui concerne Jean Moulin, il est exfiltré, via le Vatican et atterrit en Bolivie où il devient Klaus Altman. Très vite il devient conseiller des dictateurs en place. La France, en vain, réclame son extradition. Serge Klarsfeld, aidé par Régis Debray, organise sa traque. Finalement, sous Mitterrand et avec l’arrivée d’un Président bolivien socialiste (Siles Suazo), la demande d’extradition au nom de « crimes contre l’humanité » est acceptée. Il s’ensuit alors le fameux procès.
En classe, il revient à l’enseignant de décrypter pour ses élèves toutes ces informations, multiples et complexes. Le « docu-fiction » utilise de plus des documents à foison pour légitimer sa démarche « scientifique » et met en scène de nombreux témoins (victimes, complices, « traqueurs », acteurs du procès…). En-dehors de son aspect qui se veut « historien » on ne saurait négliger le fait que ce docu-fiction cherche surtout à faire de l’audience. Donc, de l’argent…ce qui suppose une réelle « mise en scène » apte à captiver le téléspectateur. Ainsi s’explique l’intégration dans le « documentaire » d’images reconstituées et l’utilisation abondante des procédés techniques cinématographiques qui ont pour but de pallier la rareté de certaines archives. Cette « manipulation » fait entrer en jeu l’imaginaire du téléspectateur. Toutefois le terme de « Shoah » n’est pas utilisé, il sert de fil conducteur mais de manière implicite.
On l’aura compris ce film pose une nouvelle fois la question de la frontière entre objectivité et subjectivité. Au final, Laurie Corso estime que la diffusion de ce film en classe dans son intégralité n’est pas forcément une bonne idée. On ne saurait en douter…