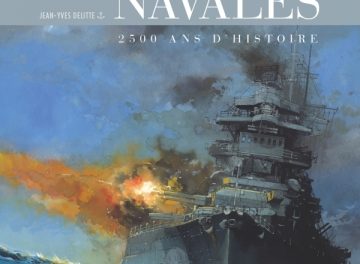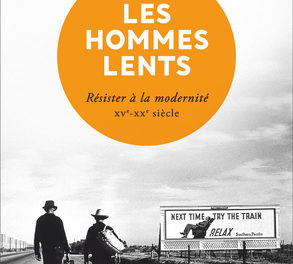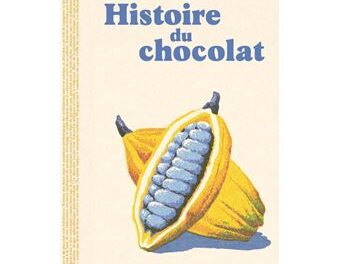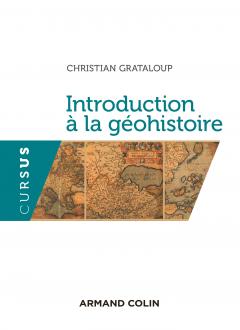
Pourtant, l’association du temps (qui n’est pas le passé) et de l’espace peut justement permettre de mieux comprendre le réel, qui repose sur ces deux dimensions. C’est le projet que poursuit Christian Grataloup depuis une vingtaine d’annéesChristian Grataloup, Lieux d’histoire. Essai de géohistoire systématique, GIP-Reclus, Montpellier, 1996, 200 p., 20,73 €. La présentation de l’ouvrage précise : «Lieux d’histoire propose des pistes à partir de l’idée que les positions relatives des civilisations ne sont pas sans rapport avec leurs devenirs. En s’affrontant, se défiant, se détruisant ou en coopérant, cavaliers et paysans, citadins et nomades, marchands et capitaines ont produit leur espace et leur histoire, leur temps et leur géographie. L’ouvrage tire un parti systématique de l’emploi et de l’analyse des modèles spatiaux».. L’idée est que l’on peut ainsi mieux voir comment fonctionne le temps social, qui articule à la fois la reproduction des caractères d’une société (associée au temps long) et les changements qui peuvent l’affecter (associés à une temporalité plus courte) : le couple permanences et mutations, pour le dire autrement. Christian Grataloup utilise le mot d’historité pour désigner la combinaison entre reproduction et transformation.
Mais une société vit dans un espace donné, c’est-à-dire une portion de la surface terrestre, à un moment donné (que le groupe peut quitter, en raison d’une migration ou d’une extinction), doté de lieux complémentaires pour en assurer l’existence. Il peut être un territoire, continu ou non (une même société peut être en différents lieux, comme une métropole et un outre-mer, au risque d’une dissociation), si on lui reconnaît le caractère d’une appropriation par cette même société. Il s’appuie enfin sur des facteurs non sociaux, le milieu (qui a sa propre temporalité), et sur quoi l’homme peut agir (et de plus en plus). Ce territoire possède également une dimension matérielle (ressources, etc.) mais aussi idéelle, puisque c’est là que peut se faire la reproduction de la société, en tant qu’il est associé à des caractères telles que la langue, la structure sociale, la représentation collective de ce même territoire (en posant le problème de l’identité nationale), etc. Le tout peut former un système, et l’ensemble de ces logiques qui permettent de concevoir une société comme un système spatial est la géographicité. Cette dernière notion intègre également les interactions avec les autres sociétés (qui ont leur propre temporalité), dont le voisinage influe sur l’histoire du groupe considéré (parce qu’on a aussi l’histoire de ses voisins).
Autrement dit, toute histoire est située spatialement, tout comme le territoire occupé par telle ou telle société est situé dans le temps.
Voilà présentée la base du livre, que Christian Grataloup approfondit ensuite. Il analyse par exemple la question de la variabilité d’un groupe dans le temps et l’espace, à quoi il voit plusieurs facteurs d’explication. Il s’agit de la diffusion humaine, qui tient à la mobilité à des fins de survie ou au fait de vouloir tirer partie d’autres milieux. Le deuxième est la nécessité liée à la proximité : faire société, c’est créer un groupe parcouru par des liens sociaux, tout en assurant leur transmission pour qu’ils se reproduisent, sans exclure qu’ils changent peu à peu (sous l’effet d’éléments internes ou externes). La distance (et les moyens de la maîtriser) sera donc à considérer, selon qu’elle rapproche ou sépare. La proximité évolue elle-même selon l’histoire de la maîtrise des distances.
On voit ainsi que la mobilité, en s’effectuant sur de grandes distances, un large espace, est associée à une temporalité de la transformation relativement brève. Au contraire, la proximité repose sur la reproduction des caractères sociaux, ce qui suppose un territoire et une temporalité longue. Espace et territoire ont donc leur propre rythme, leur propre historité, mais on comprend que les transformations sont apportées de façon externe, par l’espace ; pour autant, la proximité n’exclue pas des ruptures brutales (des événements) qui peuvent induire des changements rapides.
La géohistoire a donc pour démarche d’utiliser les mots et les outils de la géographie (espace, territoire, milieu, système, réseau, échelle, modélisation, etc.) pour comprendre les dynamiques des sociétés. En même temps, elle cherche à analyser ce qui tient aux permanences et à la reproduction, mais aussi ce qui tient aux transformations (avec leurs temporalités respectives), à partir des ensembles territoriaux, des relations au milieu (notamment les contraintes environnementales), des positions relatives par rapport aux autres groupes humains (centre, périphérie, marge).
D’autres questions sont abordées, pour le détail desquelles on ne peut que renvoyer au livre, qui propose des exemples parfois récurrents (ce qui permet de les voir sous différents angles d’explication) et une riche cartographie d’une trentaine de figurés. Sur beaucoup de points, l’approche géohistorique permet de reconsidérer la compréhension que l’on peut avoir de ce que l’on croyait savoir, en approchant des espaces géographiques qui nous sont peu familiers (les îles de la Sonde, Madagascar, etc.). Extrêmement stimulante, la démonstration est très convaincante, d’autant que Ch. Grataloup expose les précautions à prendre pour entrer dans ce type de démarche : déterminer un domaine de validité, par exemple, qui propose un découpage temporel et spatial de façon à isoler un ensemble social relativement autonome (un peuple, etc.). Car c’est bien l’objectif de ce livre que d’expliciter ce qu’est la géohistoire et en quoi consiste sa démarche.
La lecture de cet ouvrage assez dense (ce que le format éditorial impose) exige une rigueur particulière, au moins pour deux raisons. La première tient au caractère novateur de la proposition qui est faite : entrer en géopolitique, c’est changer ses lunettes pour pouvoir aborder le monde sous d’autres angles. Et pour les 80 % des historiens qui exercent notre profession, les notions et concepts géographiques utilisés doivent être maîtrisés (on est d’ailleurs bien aidé par un glossaire heureusement très bien fait) : il serait illusoire de tirer profit du livre en en faisant une simple lecture.
La collection «Cursus» se propose de rassembler des ouvrages de base, ce qui s’apparente plutôt à des manuels, avec l’aspect relativement sommaire que cela suppose. L’éditeur peut ainsi paraître assez présomptueux en proposant le livre à des étudiants en licence de géographie ou d’histoire, car le niveau exigé est tout de même assez relevé, et il mobilise des connaissances précises pour en tirer le maximum de profit. Il s’agit peut-être là d’un a priori négatif, qui cache bien mal le fait qu’on aimerait surtout être de ces étudiants, et partir sur d’aussi bonnes bases.
S’agissant justement d’un ouvrage qui s’adresse à des étudiants (et quel que soit le public, d’ailleurs), on a beaucoup de peine à regretter les fautes vraiment trop nombreuses, indignes d’une maison d’édition comme Armand Colin, qui, surtout, gênent parfois la bonne compréhension de ce qui écrit. Cela n’enlève heureusement rien à la qualité de cette Introduction à la géohistoire, dont la lecture doit être vivement recommandée, ne serait-ce que pour reconsidérer des termes comme mondialisation, identité. On la recommandera d’autant plus à tous les enseignants d’histoire-géographie, parce qu’elle leur permettra de renouveler leur enseignement sur bien des points, malgré les contraintes des programmes. Peut-être leur donnera-t-elle l’envie d’aller plus loin encore et d’entrevoir une autre façon de faire, en imaginant un véritable programme de géohistoire…