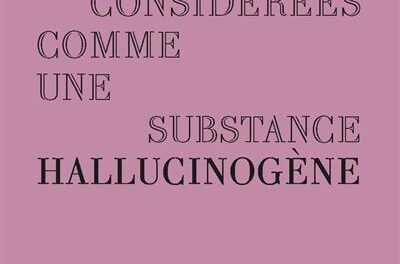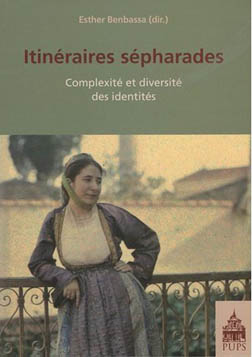
Qui sont les juifs sépharades, et suffit-il de les opposer aux ashkénazes pour les identifier ? Le terme « Sefarad », en hébreu médiéval, désigne bien les juifs originaires d’Espagne, descendants des expulsés de 1492, et ils ont toujours conservé leur « mythologie ibérique », cette « mémoire d’une Espagne à la fois honnie et mythifiée », comme le souligne Esther Benbassa. Mais leurs traditions, leurs rites, leurs itinéraires et leurs lieux d’exil, de l’ouest de l’Europe à l’empire ottoman, du Maghreb à l’est balkanique, sont irréductibles à une simplification abusive : tel est le propos de cet ouvrage, qui réunit les actes d’un colloque organisé en 2007 par le Centre Alberto Benveniste de l’EPHE et l’université de Stanford en Californie. Chercheurs européens et nord-américains se sont donc penchés sur la diversité des itinéraires, du XVe au XXe siècles, sur les traces d’une culture anéantie par l’holocauste et d’un univers « désormais plongé dans le silence ».
Il y a d’abord l’histoire de ce « converso », Pedro Tullo, qui cherche, juste après les édits des rois catholiques de la fin du XVe siècle, à récupérer des terres de juifs exilés, et accessoirement… son épouse partie vers l’Italie, comme beaucoup, pour ne pas renier sa foi ; ou encore celle du grand poète Léon l’Hébreu, fuyant vers Naples et auteur en 1535 des Dialogues d’amour, grand succès de librairie dans l’Europe du XVIe siècle : il évoque douloureusement dans ses poèmes l’impossibilité de la transmission de l’héritage familial intellectuel à la génération suivante, car son fils, qu’il avait voulu protéger en le cachant au Portugal, y fut finalement baptisé de force quelques années plus tard, et n’eut plus de contact avec lui.
Le lecteur découvre aussi les difficultés de compréhension entre diaspora orientale (Afrique du nord et empire ottoman) et diaspora occidentale (celle d’Amsterdam, Hambourg, Londres, les villes d’Italie, la France ou l’Amérique, plus tard) dont témoignent les problèmes rencontrés dans l’Amsterdam de la fin du XVIIe siècle par les « belogrados » : ces réfugiés des Balkans, de Belgrade ou Sarajevo, fuyant la guerre entre les Turcs et la Sainte Ligue, espéraient trouver accueil et nouvel avenir chez leurs frères de la « Jérusalem du Nord ». Mais leur pauvreté entraîne leur marginalisation : une partie enseigne l’hébreu ou travaille comme correcteurs de livres, mais beaucoup, ne pouvant avoir accès à l’artisanat interdit aux juifs à Amsterdam, doivent repartir sans avoir réussi leur intégration.
Salonique ou l’Espagne, dilemme des juifs américains
Mais la plupart des contributions concernent les périodes plus tardives : au début de XXe siècle, aux Etats-Unis, les sépharades d’Orient sont soucieux de se forger une identité positive face à celle, déjà très lisible, des ashkénazes. Très attachés à la « mère patrie » Salonique, et au souvenir de l’empire ottoman dont cette ville fait partie (jusqu’en 1912), ils doivent progressivement se construire, notamment à travers leur presse très vivante, une image espagnole, sépharade donc, pour se soustraire aux préjugés touchant les orientaux à cette époque.
Dans l’Espagne des années 1920 et 1930, les juifs disparus depuis des siècles, sont redécouverts par les libéraux comme Angel Pulido, à la fois désireux de dissiper la « légende noire » de l’Espagne des Rois Catholiques et persuadés que la pensée espagnole s’est asséchée, privée de la confrontation avec l’altérité. De l’autre côté du Détroit de Gibraltar, ils se passionnent pour ces juifs parlant le judéo-espagnol, et s’attachent laborieusement à déconstruire les clichés de l’antijudaïsme. Mais ces « philosépharades » ont peu de succès dans leur campagne, auprès des Espagnols comme des juifs d’Afrique du Nord qui n’ont plus guère de liens avec l’Espagne ; leur courant, le « séphardisme », porté par des revues et une « alianza hispano-hebrea », disparaît pratiquement avec l’avénement du franquisme. Mais en 1924, Primo de Rivera a accordé la nationalité espagnole aux « anciens protégés espagnols ou à leurs descendants », décret qui permettra le sauvetage des juifs espagnols pendant la guerre, même si l’attitude de Franco fut ambivalente, entre sauvetages réels mais aussi spoliations de biens juifs. Enfin, en 1992, lors du 5e centenaire de l’expulsion des juifs d’Espagne, la présence solennelle du roi Juan Carlos dans la synagogue de Madrid marquait une triple normalisation des relations avec le peuple juif : avec les juifs d’Espagne, Israël et le monde sépharade. Aujourd’hui, 16 villes espagnoles au moins sont réunies dans les « caminos de sefarad » qui marquent la réappropriation d’un passé et d’un patrimoine longtemps oublié, ainsi qu’une redécouverte des victimes sépharades de la shoah, et l’enseignement à l’école de l’extermination des juifs,jusqu’ici absent des programmes, y a été introduit en 2008.
une « turquification » qui nie la langue et l’identité séfarade
D’autres regards, portés sur les séfarades d’orient, ponctuent ce livre. Dans l’empire ottoman, un « patriotisme juif ottoman » s’était développé, tant les dirigeants juifs étaient soucieux de montrer une image de loyauté. Dans la jeune République turque après 1923, les juifs s’efforcent de s’adapter aux règles de « turquification » que leur imposait le nouveau régime, (« turquiser » leur nom, à l’instar de Moïse Cohen, fervent partisan de l’assimilation, qui devint « Munis Tekinalp », apprendre le turc alors que beaucoup parlaient le français ou le judéo-espagnol, abandonner leur structure communautaire..) malgré l’hostilité de la population et de la presse populaire, et la persistance de discriminations, dans l’éducation et le système fiscal mis en place pendant la guerre.
Particulièrement intéressante est la « visite critique », menée par une des jeunes chercheuses présentes au colloque, du musée juif d’Istanbul, ouvert en 1992 pour le 5e centenaire de 1492 dans une synagogue désaffectée. Cette étude met le doigt sur une muséographie qui met en scène de façon récurrente et presque obsessionnelle la « tolérance » des Ottomans et les prétendues « coexistence » et « harmonie » judéo-turques. Mais elle occulte en même temps certains événements obscurs de l’histoire, comme les pogromes de 1934, et les inquiétudes des juifs turcs aujourd’hui : la baisse de la démographie, l’assimilation, la forte montée de la rhétorique antisémite dans la presse turque, le terrorisme (attaques de 2003 contre des synagogues) ou les relations avec Israël. Destiné d’abord à un public de touristes et d’étrangers, le musée pourrait bien être d’abord une pièce importante dans les efforts de la Turquie pour présenter une image acceptable auprès des Occidentaux, et en particulier des Européens, dans la perspective de la candidature turque à l’entrée dans l’UE.
Enfin, des « trajets individuels » d’intellectuels ou artistes séfarades, complètent le tableau d’une communauté très éclatée. Parmi ceux-ci, on retiendra plus particulièrement celui de Sam Lévy, grand journaliste de Salonique au tournant des XIXe et Xxe siècles. Rédacteur en chef des deux principaux journaux de la ville, il incarna une nouvelle figure de l’intellectuel, croisant la tradition du « maskil », l’adepte des lumières juives (la Haskalah) et celle de l’intellectuel engagé qu’il était devenu après son séjour en France comme étudiant, à l’époque de l’affaire Dreyfus. Mais déçu par la montée du nationalisme après la révolution de 1908, il choisit l’exil. Le dernier portrait, le plus contemporain, est sans doute aussi le plus émouvant, qui présente une autre habitante de Salonique, mais de la génération suivante, née après l’annexion de la ville par la Grèce : c’est celui de Bouena Sarfatty, résistante sous le nom de Maritsa et une des rares survivantes des juifs de Salonique exterminés par les nazis, qui a laissé des Mémoires précieuses. Elle y retrace l’occupation, l’arrestation des juifs à laquelle elle échappe presque miraculeusement, le sauvetage de nombreux enfants qu’elle conduit en Palestine. Après la guerre, elle tente de vivre dans un kibboutz avec son époux, puis s’installe pour le Canada où la richesse de sa culture séfarade, qu’elle s’efforçait de reconstituer en notant des chants et des poèmes, n’avait aucune reconnaissance, y compris aux yeux des Ashkénazes de sa belle-famille.
« Où passent exactement les frontières de Sefarad ? », interroge Jean-Christophe Attias en conclusion ; peut-être sont-elles celles de la Méditerranée, appelée « mer de Sefarad », mais peut-être bien plus larges : « Sefarad se transportera fianlement partout où se transporteront ses fils, Orient ottoman, Europe du Nord, France du Sud-ouest, Nouveau Monde, lieux de reconstitution de tant de métropoles et périphéries sépharades ».
Ce recueil, composé de monographies pour la plupart très pointues, s’adresse avant tout à ceux qui connaissent déjà en partie l’histoire du judaïsme. Inégales, tant en qualité que dans leur couverture de la longue durée (de 1492 à nos jours), les contributions qui le composent permettent cependant de se forger une idée de la variété et de la richesse du judaïsme « oriental » au sens large.
Pour les novices sur la question, il serait bon de lire auparavant la réédition de l’ouvrage d’Esther Benbassa et Aron Rodrigue : Histoire des Juifs sépharades. De Tolède à Salonique, le Seuil, coll. Points-Histoire, 2002, ou le plus récent Dictionnaire des mondes juifs, Larousse, 2008 (Esther Benbassa et Jean-Christophe Attias).