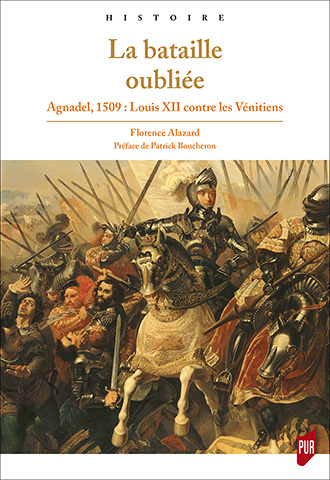
C’est principalement ce qui fait la force première de ce livre et de son auteur, qui « sait prêter l’oreille aux temps faibles de l’histoire, loin de la fanfare des grands événements » (pour reprendre les mots de Patrick Boucheron, auteur de la préface de ce livre). En travaillant sur un vieil objet historique – cette bataille oubliée qu’est Agnadel -, Florence Alazard revisite cet événement avec un regard nouveau. D’une part, elle prend ses distances avec les principales sources contemporaines qui ont cristallisé notre vision de cette bataille et nous ont enfermé dans leurs propres récits de l’événement (loin d’en être la réalité). et explore de nouvelles sources. D’autre part, elle prend ses distances avec la tentation qu’ont les historiens de faire de leur objet d’étude un événement révolutionnaire ou précurseur d’une certaine modernité, au point d’en occulter l’événement lui-même. Elle s’intéresse également à d’autres objets historiques, jusqu’à maintenant très peu étudiés (la violence de guerre subie par le soldat par exemple).
Bien sûr, Florence Alazard nous retrace au plus près les principaux épisodes de la bataille en elle-même.Pour une description minutieuse de la bataille, se référer à l’ouvrage (en italien) de Marco Meschini, La battaglia di Agnadello : Ghiaradadda, 14 maggio 1509, Bolis, 2009. Elle nous dresse également un panorama des tensions qui cristallisent l’Italie et l’Europe de ce début de XVIe siècle et nous décrit – dans le détail – l’intense jeu diplomatique qui entoure la bataille. Néanmoins, ce sont les enseignements, loin d’une histoire purement chronologique et militaire, qui sont les plus bénéfiques à l’historiographie de la période. Je partage ici les trois principaux enseignements de l’ouvrage de Florence Alazard à l’usage des Clionautes.
Les premières décennies du XVIe siècle sont un véritable moment de cohabitation entre les vestiges du passé et les modernités de la guerre nouvelle. On assiste à Agnadel à un authentique spectacle hybride, illustré par de nombreux exemples dans l’ouvrage. Par exemple, la déclaration de guerre est l’objet d’une mise en scène ritualisée. Le héraut français est envoyé lancer le « défi » au Sénat de Venise. Or, les escarmouches, pillages et autres dévastations ont commencé bien avant que la guerre ne soit officiellement déclarée. De sorte que Venise se trouve déjà en guerre – mais ne le sait pas encore – lorsque le héraut français arrive enfin à Venise pour dire la sommation. Autre illustration de ce tableau composite : les listes dont ont recours les deux armées, et qui servent d’ordres de bataille avant et après. Elles mettent en avant la valeur individuelle de chaque capitaine de compagnie et relatent leurs exploits chevaleresques ; mais tout ceci finit noyé dans un amoncellement de chiffres et dans la taille des armées. De même, la « guerre mortelle » menée par la France contre Venise est une première contre un État chrétien et constitue la véritable nouveauté d’Agnadel. Ainsi, ordre est donné dans le camp français de ne pas faire de prisonniers et a pour conséquence de laisser une boucherie s’opérer après la bataille. Mais là encore, ce massacre contraste avec la capture d’Alviano – l’un des deux commandants des troupes vénitiennes – qui de tous les Vénitiens fait prisonnier est le seul épargné, dans le strict respect des traditions chevaleresques et avec la bienveillance de Louis XII à son égard. Enfin, on assiste à une cohabitation jusque dans les récits qui sont fait de la bataille. D’une part, la volonté de rendre compte d’un récit réaliste et rationnel de la bataille. L’ambassadeur florentin Pandolfini rend ainsi un récit consciencieux et détaillé à l’adresse du Conseil des Dix de Florence. De l’autre, la littérature chevaleresque qui reprend les comptes-rendus de bataille à son compte et l’agrémente à son goût pour en faire des bons moments de lecture auprès du feu. Le retour en force du concept de la chevalerie et de ses codes rehausse les vestiges d’un passé en butte aux modernités qui émergent au XVIe siècle et rassure « une noblesse préoccupée par son statut social, ses privilèges et son ethos. » Voir Benjamin Deruelle, De papier, de fer et de sang : chevaliers et chevalerie à l’épreuve du XVIe siècle (ca. 1460 – ca. 1620), Paris, Publications de la Sorbonne, 2015. .
La deuxième thématique mise en lumière par Florence Alazard dans cet ouvrage concerne tout ce qui a trait à la communication politique et l’espace public. Celui-ci est le lieu d’un « combat de parolles » qui se déroule avant, pendant et après la bataille. La communication politique de Louis XII prend la forme d’une littérature engagée pour défendre le dessein italien du roi de France. Au moment de la Ligue de Cambrai, il s’agit, dans un premier temps, d’un travail de justification des motifs du traité et de la légitimité de la guerre contre Venise. Si cette guerre est juste, c’est parce qu’elle s’inscrit dans un projet commun de croisade contre les Turcs (ex : L’Union des Princes de Pierre Gringore – avril 1509) ; Venise étant ici le dernier obstacle à abattre avant la réalisation de la guerre sainte. Cette guerre est présentée comme une promenade militaire tant Venise paraît isolée sur la scène européenne (L’Entreprise de Venise de Pierre Gringore – avril 1509). Puis, dans un second temps, c’est tout une opération de mobilisation qui prend le relais pour convaincre d’adhérer à un projet gagné d’avance. Pour plus d’efficacité, on fait se lamenter Venise sur son sort prochain, par le biais de lamenti. À mesure que l’échéance de la guerre approche, le discours qui doit légitimer celle-ci est relégué à l’arrière-plan au profit d’un discours plus direct, martial et guerrier (en d’autres termes : Venise va se faire écraser ! Qui veut en être ?). Cette littérature anti-vénitienne n’est pas uniquement l’objet d’une production française. Il en existe une également de l’autre côté des Alpes. Venise est isolée face à cette offensive des imprimés contre elle. Si bien qu’avant même qu’un seul coup de canon ne soit tiré, la Sérénissime semble accepter l’idée de devoir assister avec un peu d’avance à ses propres obsèques (décrites malicieusement et de façon burlesque par un auteur anonyme de Mantoue). Après la bataille, les auteurs français façonnent les événements des dernières semaines pour justifier l’intervention française contre Venise (ex : La Victoire de Seyssel 1510).
Cependant, la communication politique de Louis XII répond également à un besoin de « faire faire » (Florence Alazard). Autrement dit, il est nécessaire au monarque de mobiliser ses populations à son choix de faire la guerre en Italie, et en priorité aux hommes qui viendront s’enrôler dans son armée. Le personnage allégorique de « Je-ne-scay-qui », représentant le sens commun sous la plume d’André de La Vigne, milite contre l’engagement français dans la Péninsule. Preuve qu’il existe des voix discordantes qui s’élèvent contre la guerre. D’autres arguments, mis en évidence par Florence Alazard, viennent corroborer ce rejet de la guerre. D’une part, des indices dénotent la réalité de la bataille et de la guerre vécues par le soldat et la prise en compte de sa souffrance au quotidien sur ou en-dehors du champ de bataille. Florence Alazard remarque une présence féminine importante (environ 1500, au nombre d’une fille pour 20 hommes…) à proximité du champ de bataille. Véritable « prostitution de guerre » à l’usage du soldat pour le « consoler des maulx et tourmens que tous les iours un chascun soustenoit. » Cette réalité de la guerre nécessite pour le pouvoir de développer des techniques pour contraindre les populations à la mobilisation. D’autant plus si la guerre devient « feste mortelle » (Jean Marot) ! Cette bellum romanum, archétype de la bataille nouvelle et du carnage qui l’accompagne, le personnage de Ruzzante, paysan-soldat de Padoue enrôlée dans l’armée vénitienne, l’a approché de près. De retour à Venise, il raconte toutes les ruses qui étaient les siennes pour éviter le combat et survivre à la boucherie, devant un public qui balance entre bienveillance et consternation.
La dernière thématique concerne la dépendance des historiens par rapport aux sources de l’époque du début du XVIe siècle. Le manque cruel des sources traduit une dépendance aux seules sources disponibles et explique que notre vision des guerres d’Italie soit modelée par les grandes sources contemporains de la période (Guichardin, Machiavel, Sanudo, da Porto, etc.). Ces auteurs, précieux certes, nous enferment néanmoins dans leur récit de l’histoire. Il en est de même pour la bataille d’Agnadel et de Venise où l’historien est dépendant principalement de deux sources : les diarii (journaux) de Marino Sanudo et de Girolamo Priuli. Lorsqu’ils écrivent sur la bataille, la plupart de ces auteurs connaissent la fin de l’histoire et cherchent à accentuer le drame d’Agnadel pour faire mieux apparaître le sursaut victorieux de Venise. C’est le cas avec Luigi da Porto, qui écrit 15 ans après les faits, et nous raconte l’incendie de l’Arsenal, survenu à Venise le 14 mars 1509. Il nous en peint une véritable scène de guerre dans Venise intra-muros qu’il place, à bon escient, juste avant la bataille d’Agnadel pour en faire la manifestation de mauvais présages pour la Sérénissime. La difficulté de l’historien pour atteindre le vrai est sérieuse tant il navigue dans les flots sinueux des constructions et reconstructions de l’événement. Des décennies après la bataille, les autorités vénitiennes construisent, en images, le mythe de la résilience vénitienne après Agnadel, pour montrer la capacité de la République de Venise à s’extraire des pires calamités. En omettant de revenir sur la débâcle en elle-même et sur le climat de panique et de désarroi qui ont caractérisé les semaines suivant la bataille. Difficulté de l’historien qui louvoie également entre les versions arrangées des faits et les omissions. En particulier, le discours que tient d’Alviano au Sénat de Venise à son retour de captivité (mai 1513), où il se dédouane de la défaite en ne manquant pas de faire porter toute la responsabilité de la débâcle sur Pitigliano, l’autre commandant des troupes vénitiennes. Enfin, les exagérations de l’ennemi qui instrumentalise la plainte des vaincus empêchent d’établir le climat effectif dans lequel est plongé Venise au mois de mai 1509, sans tomber dans un extrême ni dans l’autre.
En dernier lieu, le témoignage de Priuli sur la situation de Padoue (en Terre Ferme) à l’été 1509 est essentiel. Il y explique les raisons de la chute de Venise sont à rechercher dans la politique qu’elle a conduite en Terre Ferme et dans les modalités de sa domination. Pour lui, la chute de Venise n’est qu’une punition (bien méritée) car les Vénitiens ont perdu leur identité dans cette expansion territoriale. Cette affirmation est essentielle car elle a été à l’origine d’une lecture des événements et d’une vision de l’impérialisme vénitien qui a profondément dominé l’historiographie sur Venise jusque dans les années 1980. La critique abondante et récente, à travers de nombreux travaux historiens en langue anglaise, a permis de revenir sur cette affirmation James Grubb à travers l’exemple de Vicence (1988), Edward Muir par son étude sur le Frioul (1993), Stephen Bowd par son enquête sur Brescia (2010).

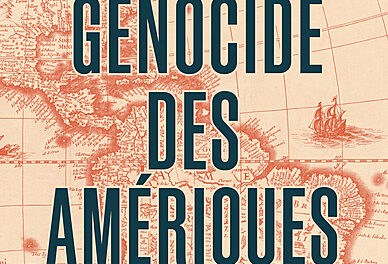
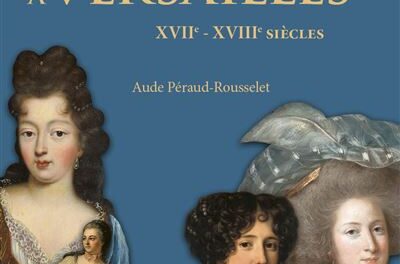

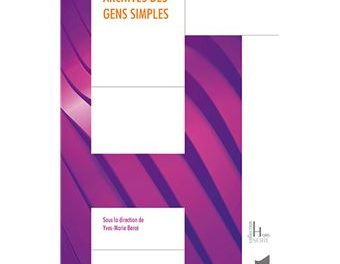









Trackbacks / Pingbacks