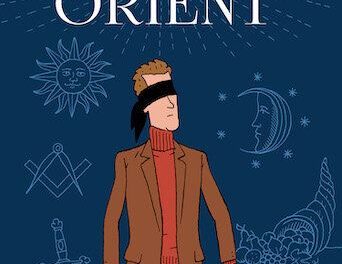Eva est une jeune ingénieure brillante. Elle travaille dans une boîte branchée où les open spaces comportent des appels à la « green » attitude et où l’on gare sa voiture électrique près d’espaces arborés. Mais le confinement est passé par là et, à son retour « physique » dans son entreprise, Eva se heurte à une quête de sens. Elle veut une vie plus authentique. Elle opte ainsi pour une mission, sur une île française perdue au milieu du Pacifique Sud, où elle aura la charge de remettre en service la station météorologique du morceau de caillou, en en assurant l’alimentation « par des énergies renouvelables ».
De manière officieuse, Eva se voit confier que son expérience doit aussi permettre d’assurer le maintien, en plein contexte de crise, de la gestion de l’îlot par l’état français.
Située à plus de 4000 km de tout continent, la petite bande de terre sur laquelle arrive ainsi Eva est vierge de tout habitant. Elle dispose d’un modeste abris qu’elle se charge de remettre en fonction et a pour seuls compagnons un chien et des gallinacés. Les débuts sont prometteurs et l’aspect paradisiaque de l’île et de ses abords (avec notamment la découverte d’une « cathédrale de corail), l’emporte sur toute autre considération. Las, la vie en autarcie est bien difficile et plonge bien vite Eva dans un grand désarroi qui se transforme progressivement en folie. La jeune femme ne doit son salut qu’à l’intervention d’ubruten navire du groupe Alphamet. Ce dernier dispose d’une exclusivité d’exploration minière pour la recherche d’oxyde et de terres rares. Mais que l’on se rassure, toute forme de dégradation liée au forage ou à l’extraction fera l’objet d’une compensation : nous ne sommes plus dans « l’ère du pétrole » mais dans celle « des métaux »…
Reste que, sans grande surprise, les conséquences de l’exploration minière se révèlent désastreuses. Débute alors la geste d’Eva contre l’ogre extracteur…
L’île du roman graphique est une « u-topia », un lieu qui n’existe pas. Léonard Chemineau précise que cette dernière « fait 1,7 hectare au total, ce qui correspond à ce que l’on appelle la « biocapacité » par habitant de notre planète. C’est la surface théorique à disposition de chaque être humain pour qu’il puisse y puiser des ressources, et éliminer ses déchets, sans la détruire. Bien évidemment, ce chiffre est aujourd’hui largement dépassé, et nous avons une empreinte écologique de 2,8 hectares par habitant, à l’échelle mondiale ».
L’auteur cite parmi ses références le Walden de Henry Thoreau. On pense également au superbe film de Sean Penn, Into the Wild, lors de la lecture de la première partie de la bande dessinée.
La brute et le divin est un beau conte environnemental, au graphisme de grande qualité et qui parvient à nous interpeler sur les conséquences plus que fâcheuses de nos modes de consommation. On pourrait le résumer selon l’axiome suivant : « et c’est à ce prix que vous disposez de portables à l’échelle du monde ».