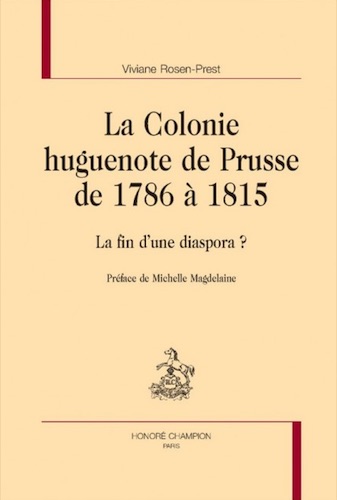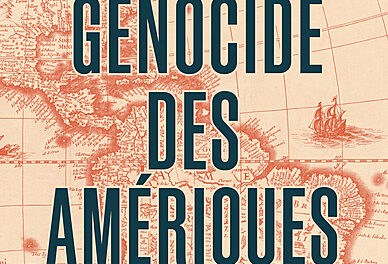L’exode des huguenots vers les terres protestantes consécutif à la révocation de l’Édit de Nantes est un champ historique fascinant que l’on étudie déjà de longue date. Moins dense en revanche est l’historiographie consacrée à la destinée ultérieure des exilés, que l’on présume irrésistiblement absorbés par un processus d’assimilation à leurs nouvelles patries. C’est ce territoire méconnu qu’a le mérite d’explorer la synthèse dédiée au cas prussien par Viviane Rosen-Prest. Agrégée d’Allemand, l’auteure est une spécialiste des Huguenots de Prusse auxquels elle a déjà consacré antérieurement sa thèse de doctorat. Porter le regard sur les dernières décennies de l’existence en groupe constitué des descendants des premiers réfugiés français permet d’apprécier la manière dont ils se sont insérés dans la société prussienne d’une manière compatible avec la perpétuation d’une forme de particularisme.
Ultime étape d’un long processus de contrainte, Sa Majesté le Roi Soleil avait aboli, en l’an de grâce 1685, l’édit de tolérance consenti autrefois par son aïeul Henri IV pour garantir les droits de la minorité protestante. Refusant de se soumettre à la violence spirituelle du catholicisme imposé par l’État, une partie des opprimés de la foi réformée prit alors le chemin de l’exil pour retrouver hors du royaume la liberté de conscience dont Louis XIV les avait spoliés. Parmi ces terres protestantes du « Refuge », le royaume de Prusse se montra un lieu d’accueil particulièrement hospitalier en mettant en place une véritable politique d’immigration.
Dès octobre 1685, l’Édit de Potsdam définit ainsi un cadre juridique généreux pour attirer les réfugiés français. Si la solidarité confessionnelle qui le motivait était sincère, elle n’était pas exclusive. L’État prussien espérait grâce à cela dynamiser son essor économique et démographique en attirant une population apte à coloniser et développer son territoire sous-peuplé. Au total, quelque 20.000 Huguenots y firent souche, implantés dans une cinquantaine de colonies. Une série d’évolutions juridiques ultérieures accordées au fil du XVIIIe siècle (la dernière promulguée en 1787) consolida le statut de ce qui devint la « Colonie française » de Prusse et les privilèges consentis à ses ressortissants, tout en élargissant la possibilité de s’y agréger à d’autres réfugiés religieux même s’ils étaient d’une origine différente. La somme de ce dispositif avantageux fit des huguenots enracinés en Prusse des « enfants adoptifs » des souverains Hohenzollern.
Grâce à un impressionnant travail de dépouillement de sources, Viviane Rosen-Prest restitue les principales caractéristiques de ce groupe resté encore cohérent à la quatrième génération. Il doit sa perpétuation notamment à son particularisme institutionnel, qui constitue la Colonie française de Prusse en entité juridique distincte assise sur un certain nombre de privilèges. Pendant 124 ans, elle peut ainsi entretenir une cohésion suffisante, fondée sur une autonomie religieuse, judiciaire, caritative et éducative, et par ce dernier biais également linguistique. Le tableau qui en résulte est néanmoins contrasté. D’une part par effet de source, la colonie de Berlin étant plus visible parce que mieux documentée, tandis que les colonies urbaines de moindre volume (Magdebourg, Stettin, Halle, etc) et les colonies rurales sont par la force des choses moins précisément connues. D’autre part en raison de la non équivalence entre colonies et Églises, l’appartenance aux unes n’impliquant pas forcément la fréquentation des autres. La diversité économique et sociale est également importante, de l’aristocrate de haut rang à l’humble travailleur manuel. On sait gré à l’auteure de proposer un tour d’horizon détaillé et individualisé des élites françaises de Prusse à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, qui fait mieux connaître des personnalités de valeur. On découvre avec intérêt le caractère composite de la communauté française, dû non seulement à des mariages « bigarrés » avec les Allemands mais aussi à la faculté donnée aux étrangers de différents horizons de s’agréger à la Colonie, opportunité qui concerne des Allemands non prussiens (notamment des Palatins) et permet d’incorporer de nouveaux Français dont l’expatriation n’est pas motivée par la foi, y compris des émigrés fuyant la Révolution française, parmi lesquels des prêtres catholiques ! Le tableau socio-économique permet de préciser en le nuançant le rôle de force motrice prêté aux Huguenots dans la montée en puissance de l’industrie textile en Prusse. Enfin, on relève avec curiosité les particularismes qui expriment l’héritage résiduel des origines française, notamment le goût du pain, ainsi que certaines vocations professionnelles préférentielles (métiers de la soierie, perruquiers et jardiniers).
Même si l’assimilation n’est pas encore pleinement acquise, les indices d’une forte acculturation sont manifestes à la fin du XVIIIe siècle. Une germanisation des patronymes s’amorce, et la pratique du Français comme langue maternelle est en recul sensible, hormis au sein de l’élite de la Colonie. L’école et le culte en sont le dernier bastion, même s’il faut sans doute envisager que, pour nombre de paroissiens, l’office en Français prenne le caractère d’un nouveau latin. De fait, c’est le corps pastoral qui se montre le plus attaché à l’identité francophone. Mais si un particularisme français réformé se maintient encore dans une partie de la communauté, dont la visibilité dans le corps social et la topographie de la capitale prussienne sont supérieures à son poids démographique, cela ne remet pas en cause l’adhésion commune au patriotisme prussien. Malgré la mémoire de certains liens de parenté, la relation avec la lointaine terre des origines est clairement distanciée. Les guerres contre la France napoléonienne le confirment sans équivoque. Même si l’occupation subie par Berlin en 1806-1807 place les francophones en position de médiateurs dans les instances administratives locales, cela se fait sans compromission caractérisée ni conflit de loyauté, et n’entraîne aucun dommage symbolique. Leur enthousiasme à participer à la guerre de libération de 1813 ne diffère pas de celui de leurs compatriotes germanophones. Pourtant, la débâcle prussienne de 1807 n’en est pas moins à l’origine de la fin de la Colonie française. Celle-ci est victime, comme l’ensemble des institutions de l’Ancien Régime prussien, du vaste programme de réformes modernisatrices qui relèvent la Prusse et posent les bases de sa future domination sur l’Allemagne. Viviane Rosen-Prest retrace avec beaucoup de finesse les étapes du processus de suppression imposé en 1809 : les intéressés, toujours attachés à leur autonomie institutionnelle, ne s’accommodent pas sans amertume de son démantèlement, même s’il est accompagné d’évidents ménagements. Cette issue ne sonne d’ailleurs pas tout à fait le glas du particularisme français réformé, dont la vitalité confessionnelle, éducative et caritative persiste encore plusieurs décennies durant.
L’intérêt documentaire et l’ampleur de vue du propos sont bonifiés par les perspectives d’approfondissement thématique esquissées par l’auteure, qui livre ainsi une belle étude de référence, très claire dans sa construction et son argumentation, étayée par un appareil critique exemplaire et riche en ressources, pourvu d’annexes documentaires pertinentes et doté d’un indispensable index. En caractérisant un processus d’assimilation original, inachevé ou plus exactement composite où les racines françaises ne contredisent pas l’adhésion au corps national germanique, Viviane Rosen-Prest formule un état des lieux minutieux appelé à faire date. Elle invite à reconsidérer la polysémie de la notion de diaspora, et donne de ce fait à méditer sur la question, éminemment actuelle, des identités hybrides, leur élaboration, leurs contradictions et leurs continuités.