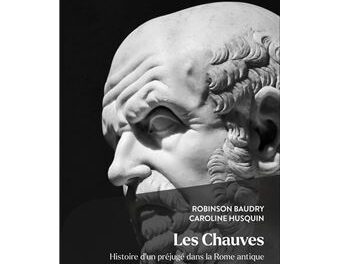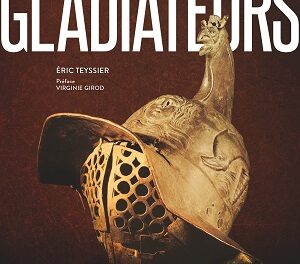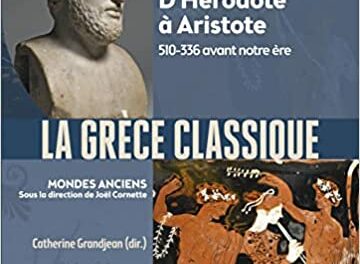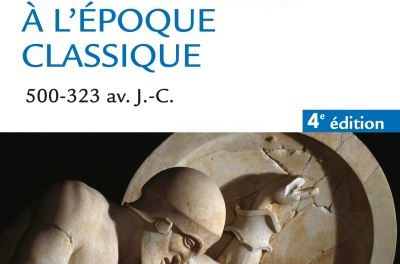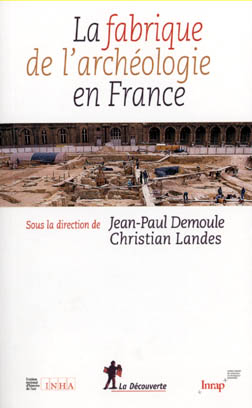
La publication de cet ouvrage aux éditions La Découverte vient très opportunément combler un vide dans la connaissance de l’archéologie en France. Paradoxalement le lien entre les études d’histoire et celle d’archéologie n’est pas très important. Dans les universités, l’archéologie est souvent rattachée à l’histoire de l’art. Rares sont les universités qui incitent leurs étudiants, y compris en histoire ancienne, à fréquenter les champs de fouilles.
C’est dire l’importance de cet ouvrage sur la fabrique de l’archéologie en France qui permet de comprendre comment l’on est passé d’une archéologie d’amateurs éclairés et d’érudits locaux à une démarche scientifique particulièrement éclairante sur l’aménagement du territoire à toutes les époques et sur les implantations de populations.
Cet ouvrage qui réunit les contributions de plusieurs chercheurs rassemblés lors d’un colloque organisé à Paris en février 2008 nous apportent donc des éclairages très particuliers sur tous les aspects du développement de l’archéologie en France. Les premiers contributeurs parlent dans la période antérieure au début du XIXe siècle de découvertes fortuites. Celles-ci viennent enrichir les cabinets de curiosités ou d’antiquités de collectionneurs et amateurs éclairés. Toutefois ces découvertes sont assez rapidement étudiées même si c’est souvent en dehors du contexte.
Des lois Carcopino…
L’archéologie en France a donc longtemps reposé sur la passion privée des « antiquaires » et elle est resté leur apanage jusqu’à la fin du XIXe siècle, tandis que l’État organisait les fouilles à l’étranger – École française d’Athènes (1846), de Rome (1873), Institut français d’archéologie orientale (1880), École française d’Extrême-Orient (1900)…
Il faut attendre le début du XXe siècle pour que l’État s’implique à travers la loi de 1913 et, surtout, à travers celle de 1941 avec la création des directions des Antiquités qui deviendront les services régionaux de l’archéologie.
Une contribution très importante traite de la genèse et de la postérité des lois Carcopino, ancien directeur de l’école française de Rome, secrétaire d’État à l’éducation dans le cadre du gouvernement de Vichy et spécialiste de l’histoire romaine. Il reprend à son compte lors de son exercice entre février 41 et avril 42 les projets de loi conceptualisée dans les années 1930. Dans ces années-là, le parlement s’était souvent opposé à toute législation contraignante.
Cette loi Carcopino a été ensuite présentée par son promoteur lui-même comme un acte de résistance face à des fouilles sauvages que l’occupant aurait voulu organiser. Jean-Pierre Reboul, l’auteur de cet article, doutent de la validité de cet argument. La loi Carcopino n’a pas empêché l’occupant dans la zone qu’il contrôlait d’exporter vers l’Allemagne un grand nombre d’œuvres d’art, et particulièrement les biens juifs saisis. Il semblerait qu’un accord était est signé avec les autorités allemandes qui exemptait les exportations d’œuvres d’art vers le Reich.
Toutefois les dispositions essentielles des lois Carcopino ont été largement validées à la libération et notamment le contrôle du CNRS sur la publication des recherches et des résultats des fouilles archéologiques.
L’après-guerre voit néanmoins la destruction d’un nombre incalculable de sites et l’archéologie livre alors un combat, dont elle sort victorieuse, imposant la pratique avant le droit, puis voyant sa légitimité reconnue dans la Convention européenne de Malte (1992) et dans la loi de 2001 sur l’archéologie préventive.
… À la convention de Malte
C’est cette histoire chaotique qu’entreprend de retracer cet ouvrage – issu d’un colloque organisé en 2008 par l’INHA et l’Inrap -, riche de contributions inédites sur les prémisses de l’archéologie comme sur son passé récent. Au-delà des faits, il s’en dégage une épistémologie de la discipline, où l’on perçoit notamment comment des contextes contingents peuvent induire des avancées conceptuelles, mais aussi, hélas, comment des strates de complexité se sont déposées avec les années, sans que l’on ait toujours pris la peine de leur apporter une solution pérenne.
Cette histoire permet de mieux comprendre les traits particuliers de l’archéologie métropolitaine et ses atouts : un noyau d’archéologues militants constitué dans les années 1970-1980 – héritiers du Victor Hugo de Halte aux démolisseurs -, une « jeune garde » de chercheurs récemment recrutés, une attention portée à l’ensemble des vestiges du passé, même le plus récent, et non aux seuls « chefs d’œuvre » de la préhistoire ou de l’Antiquité, une mosaïque d’institutions – services de l’État et de collectivités territoriales, Université, CNRS, Inrap, opérateurs privés -, une forte pluridisciplinarité, des techniques de pointe…
Elle permet aussi de mesurer les limites de l’archéologie française un paysage réglementaire changeant et mal compris, un éclatement de la communauté des chercheurs, un partage embryonnaire des données, une restitution au public insuffisante, une acceptation fragile par le corps social, élus et aménageurs au premier chef…
Un autre article particulièrement important est celui consacré à l’élaboration de la convention de Malte a rédigé dans le contexte des années 70 marquées par des scandales archéologiques et la montée en puissance de l’archéologie de sauvetage. C’est d’ailleurs dans ce contexte que l’on réunissait des étudiants en histoire et en histoire de l’art volontaires pendant les vacances pour aller gratter le sol avant que les bulldozers et les pelles mécaniques des aménageurs et promoteurs ne viennent détruire des sites. (Exemple de la nécropole grecque du Cap d’Agde.)
L’élaboration de la convention de Malte a demandé huit ans, entre une première réunion internationale tenue à Florence en 1984 et la signature du texte définitif en 1992, à La Valette. Quinze réunions d’experts au Conseil de l’Europe, à Strasbourg, ou dans des colloques organisés à Florence, Nice, Coimbra et La Valette ont permis de passer d’une simple « Recommandation » en 1989, document incitant simplement à mieux respecter les apports de l’archéologie, à une « Convention », en 1992, texte beaucoup plus contraignant pour les pays signataires. Cette évolution traduit aussi un changement profond dans la conception du patrimoine archéologique : d’une archéologie de l’objet, on passe à une archéologie de la connaissance où les fouilles ne sont plus que l’une des activités scientifiques qui constituent la recherche archéologique. Cette convention traduit aussi la prise en compte des menaces induites par les grands projets d’aménagement sur les sites archéologiques qu’ils révèlent et détruisent, alors que, dans les décennies précédentes, les fouilles clandestines étaient considérées comme les pires menaces.
Malgré la création de nombreux services de collectivités territoriales et de l’Inrap, la métamorphose est inachevée, et la discipline ne bénéficie pas encore des conditions d’un exercice serein. Pourtant, lorsque les responsables politiques et économiques prennent la mesure des apports de l’archéologie à la connaissance, ils en perçoivent les enjeux fondamentaux pour la vie dans la Cité et s’en emparent avec enthousiasme. Car l’archéologie n’est pas seulement la science du
passé, c’est aussi le socle de la réflexion sur la société contemporaine, qu’il s’agisse des évolutions du climat, des transformations du paysage, des usages du territoire, des mouvements de population, des conditions de la vie urbaine ou du rapport de l’homme avec l’au-delà…
Pour les auteurs de cet ouvrage et, nous l’espérons aussi pour ses lecteurs, l’archéologie n’est pas un handicap, c’est un atout pour que l’aménagement du territoire ne se fasse pas au prix d’une destruction des sites qui ressemblerait à l’incendie de nos archives publiques.