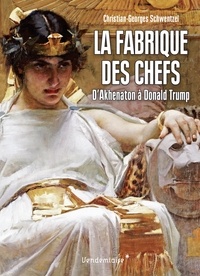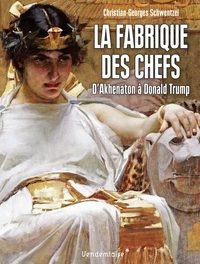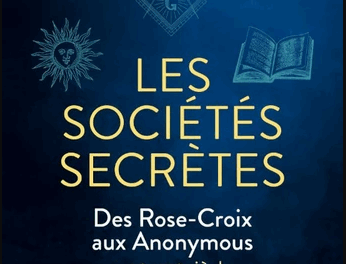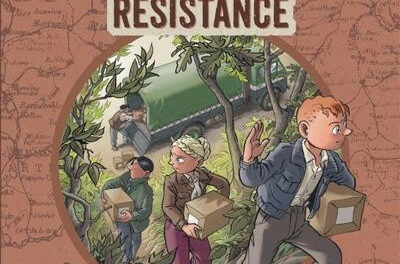Christian-Georges Schwentzel est historien, spécialiste de l’Orient hellénistique et romain. Professeur à l’université de Lorraine (Metz), il a publié plusieurs ouvrages dont un sur Hérode le Grand Christian-Georges Schwentzel, Hérode le Grand, Pygmalion, 2011, 320 p., qu’il définit comme roi de Judée mais aussi sous l’image du « tyran juif ». Dans Juifs et Nabatéens, Christian-Georges Schwentzel, _, Juifs et Nabatéens : les monarchies ethniques du Proche-Orient hellénistique et romain, Presses Universitaires de Rennes, 2013, 306 p., aborde, cette fois-ci, la figure du monarque ethnique, une catégorie de souverains dans laquelle il classe les grands prêtres juifs, le roi Hérode et les souverains nabatéens. Enfin, en 2014, il publie une biographie de Cléopâtre _, Cléopâtre, La déesse-reine, Payot, 2014, 352 p. qui est aussi un essai sur le mythe de cette reine après sa mort. On s’aperçoit donc, au travers de cette bibliographie, l’attrait que représente l’étude, pour Christian-Georges Schwentzel, de la figure tutélaire et charismatique du chef.
D’Akhenaton à Constantin, en passant par Vladimir Poutine ou Donald Trump, on explore, ici, sous ses formes les plus diverses, l’élection d’un homme parmi tous les autres, fondement des pensées politiques de l’Antiquité. De la royauté divine égyptienne au chef romain prétendument démocrate, en passant par le conquérant entraînant ses armées au nom de la lutte du Bien contre le Mal, nombre de pratiques et de théories du pouvoir inventées dans les premiers siècles de notre histoire étaient appelées à une longue postérité : on les retrouve, quasiment identiques, dans les régimes du XXIe siècle jusqu’aux démocraties réputées les plus avancées.
Qu’est-ce qu’un chef ?
Un chef, c’est fait pour cheffer, selon la célèbre petite phrase de Jacques Chirac, alors président de la République. Pour ce dernier, le chef se définit par sa fonction : le chef est celui qui fait le chef. D’un point de vue étymologique, chef vient du latin caput qui signifie tête. Le chef détient autorité, savoir et décide pour l’ensemble du groupe humain qu’il dirige. C’est donc le pouvoir. Il est même le cerveau du corps humain symbolisé par la figure du peuple. Pouvoir et chef sont donc indissociables. Faire le chef équivaut a exercer un pouvoir de coercition. Pour cela, il dispose de moyens : État, armée. Dès lors qu’il y a un chef exerçant le commandant, on trouve une société, un corps social qui obéit à la tête. Aussi, l’État correspond à une société hiérarchisée,organisée, relayée par une administration locale plus ou moins complexe sur laquelle s’appuie le chef pour faire appliquer ses directives. Il s’appuie également sur un système fiscal par lequel il rétribue ses agents. En ce sens, cette forme de gouvernement peut être clairement identifiée en Mésopotamie et en Égypte dès le IVe millénaire avant J.C. Il n’est pourtant pas nécessaire qu’un chef se confonde avec L’État pour que celui-ci fonctionne correctement. C’est l’État, non le monarque, qui est la solution au problème de la sécurité et du bien-être d’une communauté. Mais pourquoi avoir confié la destinée d’un peuple à un seul homme ? La question est peut-être mal posée comme l’indique l’auteur. La norme qui semble s’être imposée est plutôt que le chef se confonde avec L’État. Au XVIIe siècle, Louis XIV personnifie cette tendance de gouvernement. Car le chef n’est pas forcément désigné par le groupe social. Il prend le pouvoir, c’est tout. Mais on peut également supposer que les peuples ont acquiescé. Les origines de la royauté, comme de l’aristocratie, sont en partie magiques : conscient de sa fragilité, l’humain cherche alors protection et sécurité. Le chef est par conséquent chargé de cette fonction protectrice. Mais la guerre n’est pas, cependant, l’unique activité du chef. Les rois sumériens et égyptiens ont fondé une part importante de leur légitimité sur la nécessité de mener d’importants travaux hydrauliques, sur le Nil, le Tigre et l’Euphrate. Le souverain se présente alors comme le perpétuel sauveur de ses sujets auxquels il fournit l’eau, la nourriture et les moyens de leur subsistance. Ainsi le pharaon prétend obtenir des dieux la fertilité annuelle de l’Égypte.
Rois ou monarques ?
Les deux termes sont aujourd’hui confondus, voire synonymes. On parle de monarchie britannique bien qu’Elizabeth II ne possède, dans les faits, qu’un nombre très limité des attributs habituels du monarque : son pouvoir est héréditaire, elle vit dans un palais, sa cour est fastueuse mais le pouvoir politique est entre les mains du Premier ministre et du gouvernement. Son autorité est purement symbolique. Tout roi ou reine ne sont pas obligatoirement des monarques et, inversement, tout monarque ne porte pas forcément le titre royal. En grec, la royauté est dite basileia ; elle est la fonction du roi, le basileus. Ce mot correspond au latin rex qui a donné roi en français, regnum signifiant tout à la fois règne, royauté et royaume. La monarchie se définit comme un régime dans lequel le pouvoir suprême est exercé par un seul homme. Le monarque concentre tout le pouvoir en sa personne. Il définit le bien commun, qu’il confond volontiers avec son bien propre et celui de son entourage. A partir de ces définitions très succinctes, la notion de monarque est étroitement liée à un type de régime politique, en l’occurrence autoritaire, tandis que la royauté correspond avant tout à un titre et à sa transmission héréditaire. La confusion entre les deux termes s’explique dans la mesure où de nombreux souverains, comme les pharaons égyptiens, ont cumulé titre royal, transmission dynastique et pouvoir d’un seul homme. Mais d’autres exemples le prouvent : aujourd’hui encore, à l’inverse d’Elizabeth II, les rois d’Arabie Séoudite, du Maroc ou de Jordanie sont de véritables monarques, comme les Kim, qui se succèdent de père en fils depuis 1948 en Corée du Nord, sans pourtant porter le titre royal.
Des sociétés sans chefs ?
Si les prémices d’une société regroupées autour de chefs sont identifiables à partir des sources iconographiques et écrites en Mésopotamie et en Égypte dès le IVe millénaire, qu’en était-il avant ? L’ethnologue Pierre Clastres Pierre Clastres, Chronique des Indiens Guayaki, Plon, Paris, 1972. avança dans son étude la possibilité d’une société sans hiérarchie. Une telle projection, on s’en doute bien, a ravi un assez large public libertaire et anarchiste. Ainsi, les devises «ni dieu ni maître» et «interdit d’interdire» puisaient leur origine aux racines mêmes de l’humanité. Pour autant, le rêve d’un âge d’or primordial, sorte de société précédent l’irruption des despotes, s’est vite heurté à l’implacable réalité scientifique. Des spécialistes de l’Afrique ont fait remarquer que, sur ce continent, des États fortement hiérarchisés et des rois avaient été partout présents, même en l’absence d’écriture. Il est clair, qu’aujourd’hui, la thèse de l’anarchie originelle ne peut être étendu à l’ensemble de l’humanité. Elle n’est même plus pertinente pour toute l’Amérique, puisque les civilisations du Mexique (Olmèques, Mayas, Aztèques) et du Pérou (Incas) présentent les caractéristiques habituelles des sociétés monarchiques et étatisés.
Idéologie et propagande
On entend par idéologie un ensemble d’idées, plus ou moins systématisé, qu’un groupe social, politique ou religieux applique à la réalité. Depuis le XIXe siècle, le terme idéologie est affublé de connotations négatives. Dans l’idéologie allemande, Marx et Engels y ont vu un système d’idées servant avant tout les intérêts d’un groupe social dominant. Le terme est devenu polémique : il sert à dénoncer les prétentions d’adversaires politiques. En montrant le lien entre idéologie et totalitarisme, Hannah Arendt Hannah Arendt, Le système totalitaire, Seuil, Paris, 1972. n’a fait qu’accroître la défiance à l’égard de ce terme. Comme le souligne l’auteur, on peut différencier deux types de propagandes. La première est actuelle et agressive, elle est caractéristique des situations de conflit ou de crises où le pouvoir est susceptible d’être contesté, comme lors des guerres civiles ou des révolutions de palais. (bataille d’Actium en 31 av. J.-C.) Octavien dépeint Marc Antoine comme un traître et sa maîtresse, la reine Cléopâtre, comme une prostituée. A l’opposé, la propagande de conformisme, diffusée de façon quotidienne et ordinaire ne vise qu’à conforter le pouvoir en place. Certains historiens ont parfois hésité à la qualifier de propagande. Ainsi, Paul Veyne Paul Veyne, «Lisibilité des images, propagande et apparat monarchique dans l’Empire romain», Revue historique, n°621, 2002. préfère parler, dans l’Empire romain, de manifestation du faste monarchique, plutôt que d’actions propagandistes. Les empereurs auraient seulement voulu affirmer leur pouvoir sans éprouver un réel besoin de convaincre les peuples qu’ils dominaient.
Regarder le doigt ?
Pour reprendre l’expression de Régis Debray dans sa Critique de la raison politique Régis Debray, Critique de la Raison politique ou L’inconscient religieux, Gallimard, 1981, 480 p., le philosophe met en évidence la continuité entre les royautés antiques et les États communistes du XXe siècle : Mao, Staline, Kim Il-Sung sont, de fait, l’équivalent de monarques divins. L’embaumement de la dépouille du chef rappelle le culte funéraire des pharaons ou de celui d’Alexandre ; le temple-tombeau du conquérant, à Alexandrie. Le croyant, le militant ou l’adorateur sont en partie aveuglés sur leurs propres pratiques car ils ne semblent pas concevoir certaines réalités qu’ils mettent pourtant en œuvre : par exemple, le culte de la personnalité qui n’a pas sa place dans la théorie marxiste et qui n’est pas non plus, un concept, reste cependant un état de fait. Les faits se moquant, parfois, de la théorie.
Un retour des chefs au XXIe siècle ?
L’outsider revenait de loin. Candidat à la primaire républicaine en juin 2015, les grands titres de la presse internationale n’ont vraiment commencé prendre au sérieux Donald Trump qu’à partir du début de l’année 2016, avec un mélange de sidération et de condescendance, refusant d’imaginer que « le monstre » ou le « bouffon » parvienne réellement à se hisser et s’imposer durablement. On se rend compte, maintenant, que Donald Trump a mené une campagne habile, dont les dérapages verbaux étaient même calculés. Démagogue, opportuniste, volontiers provocateur, il rappelle, par son discours, celui des tyrans grecs, comme Pisistrate – 600 à – 527 av. J.C. à Athènes qui instrumentalisèrent la rancœur populaire afin de s’emparer du pouvoir. Il a atomisé les deux grandes familles aristocratiques qui se sont partagées le pouvoir durant une trentaine d’année : les Bush et les Clinton en dénonçant, tour à tour, leurs mensonges, leurs faillites et, avec misogynie, l’incapacité d’Hillary Clinton à gouverner le pays en tant que femme. Ces soupçons d’incapacité se nourrissent, aussi surprenant que cela puisse paraître, à de lointaines mais efficaces références bibliques : la femme n’est-elle pas pécheresse par essence, comme Eve, Hérodiade ou Salomé ? Trump est aussi l’homme à la chevelure indomptable, improbable, voire léonine, à la teinture jaunâtre et objet de nombreuses moqueries de la part de ses adversaires. Mais, dans la Bible, c’est David qui se distingue par ses cheveux fauves, considérés comme un signe du choix divin qui s’est porté sur le messie ? La chevelure de Trump n’est pas un détail anodin, un caprice ou une faute de goût. C’est un choix parfaitement calculé, assumé, qui s’inscrit dans une stratégie de communication : il en fait une marque de fabrique, sorte de fétiche bien réel. Ses cheveux sont authentiques, de même que sa mission au service de l’Amérique. Et en faisait toucher du doigt sa crinière sur des plateaux de télévision, il prouve aux Américains qu’il ne ment pas et que sa volonté de conquérir le pouvoir est sans faille. Le candidat républicain a su habilement jouer sur une thème fondamental de la culture judéo-chrétienne d’un grand nombre d’Américains : David contre Goliath. Pour cela, Trump a bénéficié du soutien de meneurs évangéliques et catholiques conservateurs : Frankin Graham, le puissant président de l’association évangélique a explicitement comparé Trump à David, de même que Jerry Farewell Jr, président de la prestigieuse université privée de Liberty de Lynchburg.
A l’Est, Poutine, pour sa part, est un grand inventeur de la figure du chef au XXIe siècle. Entouré de photographes, de conseilleurs, de preneurs de son et cameramen, il produit des images de lui-même parfaitement pensées et mises en scène avec un grand souci du détail et l’apparence de la vérité. Il se veut athlétique comme Héraclès, doté de qualités physiques exceptionnelles, comme les pharaons d’Égypte. S’ajoute à ces images une histoire servant de légende légitimatrice : Poutine à commencer à s’adonner au sport avant de s’imposer à la tête d’une meute d’enfants d’ouvriers qui jouaient dans son immeuble communautaire. Il se veut l’homme providentiel, sauveur d’une Russie livrée au chaos au début des années 1990 dirigée par Boris Eltsine, le président indigne : alcoolique, bouffon, traître et coupable d’avoir abandonné le pays à une mafia de milliardaires sans scrupules. Poutine se montre aussi en chef de guerre, prêt à protéger, par la force, les frontières d’une Russie toujours menacée par des puissances étrangères qui rêvent de la dépecer. Poutine a remporter plusieurs succès qui lui ont permis de mettre fin au démantèlement de l’ancien empire soviétique. Il a repris en main des territoires qui risquaient d’échapper à l’emprise russe : Tchétchénie, Abkhazie, Ossétie du Nord, Crimée. Et comme les États-Unis, il s’appuie sur des souverains clients, relais locaux de l’impérialisme russe. Le président russe a aussi compris que la grande faiblesse de l’URSS était l’absence d’un grand dieux protecteur. Il n’y avait rien au-dessus de Staline. Poutine, lui, se veut croyant. Il a conclu une alliance avec le clergé orthodoxe, et le patriarche de toutes les Russies, Cyrille Ier, le soutient sans réserve.
Un livre saisissant qui éclaire, de l’Antiqué au XXe siècle, les phases successives de la personnification du pouvoir, du roi-prêtre au monarque, en passant par les tyrans et les dictateurs pour terminer par la figure du chef qui semble susciter un regain d’intérêt en ce début de XXIe siècle avec l’émergence d’une monde moins multi-polaire qu’auparavant.
Bertrand Lamon – © Les Clionautes