L’attitude et les souffrances de la population française soumise aux rigueurs de l’occupation allemande entre 1940 et 1944 demeurent, encore aujourd’hui, l’enjeu d’une mémoire vive et de débats historiographies acharnés. Or, ce passé qui passe mal a écrasé sous son amertume les tourments d’une autre occupation allemande, antérieure et moins globale, mais qui s’avère un préalable péniblement semblable, par bien des aspects, à celle subie lors de la Seconde Guerre Mondiale. L’Histoire peut-elle se répéter ? La lecture de l’ouvrage de Philippe Nivet conduit à redouter que cela soit possible.
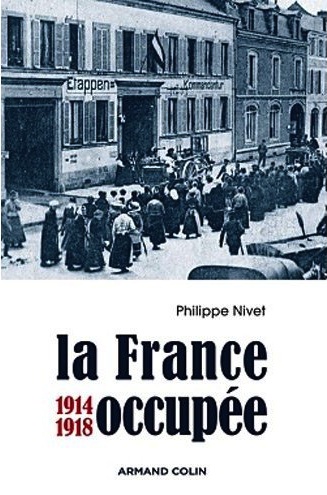
La dure réalité de cette France occupée occultée pèse sur 3,7% du territoire national et 8,2% de la population totale du pays. Elle compte deux millions d’habitants, enfermés dans l’espace de neuf départements du nord et de l’est du pays envahis plus ou moins complètement (les Ardennes sont le seul qui soit intégralement aux mains de l’ennemi). Au-delà des opérations militaires en cours qui font un nombre significatif de victimes civiles, à peu près rien n’a été épargné à ces populations envahies. L’étude parfaitement documentée conduite par l’auteur compile le bottin complet de l’oppression et de l’exploitation des populations et des territoires envahis, victimes d’une logique de guerre totale. En regard, le comportement des habitants soumis à cette domination témoigne d’une large palette de réactions, de la survie à la résistance, de l’animosité à l’accommodation, de la servitude à l’allégeance, en un grand écart qui va du «silence de la mer» à la collaboration.
L’asservissement
Brutalement envahies en 1914, dans un climat d’atrocités et d’exactions sur lequel l’auteur récapitule les conclusions de l’historiographie récente, quelquefois libérées ou réoccupées plus ou moins temporairement selon le ressac du front, les régions concernées ne redeviennent françaises, pour la plupart, qu’en 1918. Dans l’intervalle, elles sont soumises par droit de conquête à l’arbitraire d’une administration d’occupation qui les considère tout à la fois comme un butin, une ressource, un espace de manœuvre, un potentiel à anéantir et l’enjeu d’une éventuelle annexion. Entre «germanisation» et mise en coupe réglée, le sort des habitants y est rude. Ils subissent un régime de réquisition et d’exploitation économique assez impitoyable.
Les ponctions financières épuisent les ressources collectives et les avoirs personnels. Pénuries et privations sont telles qu’elles entraînent des carences alimentaires. Beaucoup de ceux qui échappent aux déportations de travailleurs et d’otages et aux déplacements de population sont astreints à un travail forcé qui est assez fréquemment étendu aux femmes et aux enfants. Les limites des prescriptions de la Convention de La Haye concernant les civils semblent souvent bafouées par les pratiques et les exigences allemandes. Un véritable isolement extérieur et un fort cloisonnement intérieur (dû à de lourdes restrictions de circulation) s’additionnent à une propagande inventive pour entretenir une réelle souffrance psychologique. La mémoire nationale est vandalisée et l’enseignement asservi. Des contraintes symboliques fortes pèsent sur la vie collective, à travers l’accaparement de bâtiments publics et privés par les forces d’occupation, le déploiement d’une signalétique en langue allemande, ou encore l’humiliante obligation de saluer les officiers ennemis croisés dans les rues. Une répression sévère s’abat sur toutes les formes de résistance ou même de simple obstruction. L’intensité affolante de ce flot de contraintes et d’injonctions amène à envisager que leur rigueur fut pire que sous l’occupation nazie…
Survivre, lutter ou se soumettre
Dans ce contexte drastique, le sort et l’attitude des occupés fluctuent selon les lieux, les moments, les besoins, et la qualité des contacts existant avec les forces allemandes. Une partie des autorités civiles françaises est restée sur place pour assumer ses responsabilités. Maintenues ou complétées par l’ennemi de façon à assurer une certaine continuité administrative et à disposer d’interlocuteurs, elles semblent avoir eu une attitude globalement digne, allant parfois jusqu’à une posture de protestation ou d’abstention que peuvent sanctionner destitution ou déportation en Allemagne. Soulagement précieux, le contexte d’extrême pénurie est malgré tout atténué durant une partie de l’occupation par les secours alimentaire et les produits de première nécessité fournis par le truchement de pays neutres. Des rapatriements massifs vers la France non envahie sont organisés via la Suisse. Ils concernent au total 500 000 civils (soit le quart des occupés) de 1915 à 1918. Indocilité, résistance passive et résistance civile constituent les principales formes de rejet de l’occupant.
Une presse clandestine, des filières d’évasion et des réseaux de renseignement s’organisent, tandis que la lutte armée est rare et bornée à quelques actions de sabotage. En sens inverse, les modes d’accommodation n’ont rien de marginal. Liens de sociabilité, de cohabitation et de voisinage se développent. Relations amoureuses et rapprochements sexuels semblent relativement fréquents, d’autant que nombreuses sont les femmes restées seules. Signe infaillible des périodes troublées, le fléau des dénonciations prolifère. Enfin, certains individus s’engagent dans des formes de collaboration active.
Passée la courte euphorie de la libération, la dure réalité de l’ampleur des prélèvements et des destructions rend le quotidien accablant et l’avenir préoccupant. L’après-guerre implique de lourds efforts de reconstruction matérielle et appelle des mesures diverses de réparation morale, mais n’échappe pas aux déconvenues. Si la réprobation stigmatise les «femmes à boches» tandis que la justice atteint les complices français de l’occupant, les responsables allemands échappent quant à eux aux procès que l’on avait rêvé de leur infliger.
1914 et 1940 : l’occupation allemande en miroir
Pour le lecteur d’aujourd’hui, la redécouverte des affres de cette première occupation d’une portion de la France se double immanquablement d’une comparaison permanente avec les caractéristiques de la seconde, en un troublant jeu de miroir. Les analogies sont nombreuses, jusque dans certains châtiments expéditifs accompagnant la libération (les femmes tondues). Mais cela n’exclut pas des différences : en particulier, épargnées par la “brutalisation”, les sanctions judiciaires envers les faits de résistance comme pour les crimes de collaboration semblent avoir été mesurées, sinon modérées. Bien qu’il soit évoqué dans la conclusion, ce rapprochement naturel entre les deux occupations aurait donc peut-être appelé certains approfondissements. On reste par exemple sur sa curiosité s’agissant des échos laissés dans l’historiographie allemande par la mémoire de l’occupation vue du côté de l’envahisseur. On songe en particulier aux protestations contre les compensations exigées au titre des réparations, aux éventuels discours de justification de l’entre-deux-guerres, sans oublier le sort infligé aux monuments commémoratifs français de l’occupation de 1914-1918 durant celle de 1940…
Même si l’effet de catalogue l’emporte parfois sur l’esprit de synthèse, il est agréable et utile de disposer désormais de cette somme de référence tout à la fois copieuse, claire et exhaustive. Elle enrichit l’historiographie de la Grande Guerre d’une contribution notable qui restitue aux civils envahis leur part légitime du panorama d’ensemble. Quant à la confrontation des deux occupations, le débat semble assez clairement tranché. «Quelques décennies plus tard, l’occupation subie pendant la Grande Guerre sera jugée infiniment plus dure que celle de la Seconde Guerre mondiale par ceux qui ont subi les deux» souligne pour conclure Philippe Nivet (p.377). Bégaiement de la fatalité, répétition générale ou éternel recommencement ? On mesure en tout cas avec effarement combien, dans la culture et la pratique de l’Occupation allemande de la Deuxième Guerre mondiale, le poids de l’héritage domine, tout bien pesé, la part des pathologies du nazisme.













